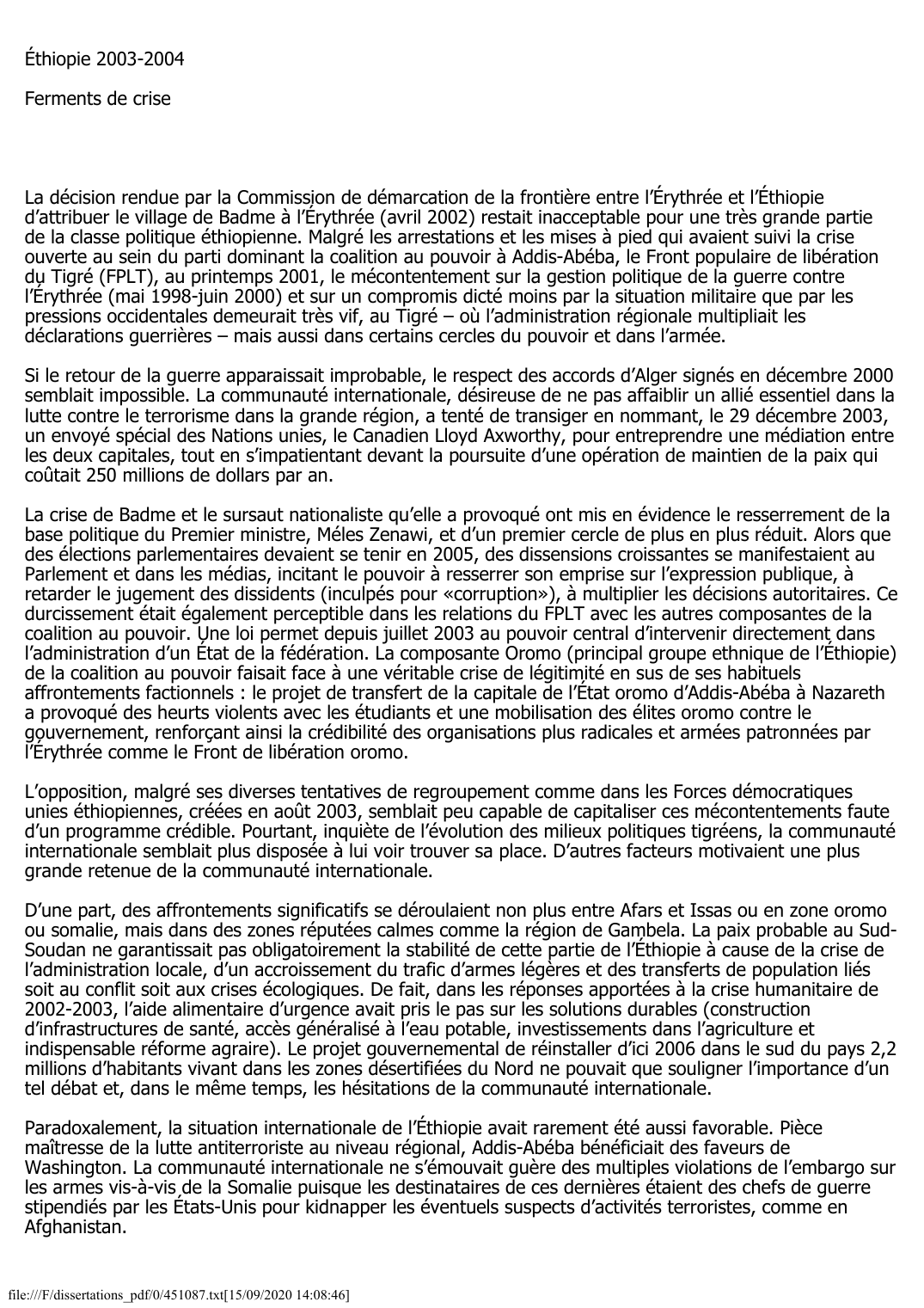Éthiopie (2003-2004): Ferments de crise
Publié le 15/09/2020

Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Éthiopie (2003-2004): Ferments de crise. Ce document contient 822 mots soit 2 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format PDF sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en: Histoire-géographie.
«
file:///F/dissertations_pdf/0/451087.txt[15/09/2020 14:08:46]
Éthiopie 2003-2004
Ferments de crise
La décision rendue par la Commission de démarcation de la frontiè
re entre l’Érythrée et l’Éthiopie
d’attribuer le village de Badme à l’Érythrée (avril 2002
) restait inacceptable pour une très grande partie
de la classe politique éthiopienne.
Malgré les arrestations et les
mises à pied qui avaient suivi la crise
ouverte au sein du parti dominant la coalition au pouvoir à Addis-Abé
ba, le Front populaire de libération
du Tigré (FPLT), au printemps 2001, le mécontentement sur la ges
tion politique de la guerre contre
l’Érythrée (mai 1998-juin 2000) et sur un compromis dicté
moins par la situation militaire que par les
pressions occidentales demeurait très vif, au Tigré – où l’
administration régionale multipliait les
déclarations guerrières – mais aussi dans certains cercles du p
ouvoir et dans l’armée.
Si le retour de la guerre apparaissait improbable, le respect des accord
s d’Alger signés en décembre 2000
semblait impossible.
La communauté internationale, désireuse de ne
pas affaiblir un allié essentiel dans la
lutte contre le terrorisme dans la grande région, a tenté de trans
iger en nommant, le 29 décembre 2003,
un envoyé spécial des Nations unies, le Canadien Lloyd Axworthy, p
our entreprendre une médiation entre
les deux capitales, tout en s’impatientant devant la poursuite d’u
ne opération de maintien de la paix qui
coûtait 250 millions de dollars par an.
La crise de Badme et le sursaut nationaliste qu’elle a provoqué on
t mis en évidence le resserrement de la
base politique du Premier ministre, Méles Zenawi, et d’un premier
cercle de plus en plus réduit.
Alors que
des élections parlementaires devaient se tenir en 2005, des dissensio
ns croissantes se manifestaient au
Parlement et dans les médias, incitant le pouvoir à resserrer son
emprise sur l’expression publique, à
retarder le jugement des dissidents (inculpés pour «corruption»
), à multiplier les décisions autoritaires.
Ce
durcissement était également perceptible dans les relations du FPL
T avec les autres composantes de la
coalition au pouvoir.
Une loi permet depuis juillet 2003 au pouvoir cent
ral d’intervenir directement dans
l’administration d’un État de la fédération.
La composant
e Oromo (principal groupe ethnique de l’Éthiopie)
de la coalition au pouvoir faisait face à une véritable crise de l
égitimité en sus de ses habituels
affrontements factionnels : le projet de transfert de la capitale de l’
État oromo d’Addis-Abéba à Nazareth
a provoqué des heurts violents avec les étudiants et une mobilisat
ion des élites oromo contre le
gouvernement, renforçant ainsi la crédibilité des organisations
plus radicales et armées patronnées par
l’Érythrée comme le Front de libération oromo.
L’opposition, malgré ses diverses tentatives de regroupement comme
dans les Forces démocratiques
unies éthiopiennes, créées en août 2003, semblait peu capabl
e de capitaliser ces mécontentements faute
d’un programme crédible.
Pourtant, inquiète de l’évolutio
n des milieux politiques tigréens, la communauté
internationale semblait plus disposée à lui voir trouver sa place.
D’autres facteurs motivaient une plus
grande retenue de la communauté internationale.
D’une part, des affrontements significatifs se déroulaient non plu
s entre Afars et Issas ou en zone oromo
ou somalie, mais dans des zones réputées calmes comme la région
de Gambela.
La paix probable au Sud-
Soudan ne garantissait pas obligatoirement la stabilité de cette part
ie de l’Éthiopie à cause de la crise de
l’administration locale, d’un accroissement du trafic d’armes l
égères et des transferts de population liés
soit au conflit soit aux crises écologiques.
De fait, dans les rép
onses apportées à la crise humanitaire de
2002-2003, l’aide alimentaire d’urgence avait pris le pas sur les
solutions durables (construction
d’infrastructures de santé, accès généralisé à l’
eau potable, investissements dans l’agriculture et
indispensable réforme agraire).
Le projet gouvernemental de réins
taller d’ici 2006 dans le sud du pays 2,2
millions d’habitants vivant dans les zones désertifiées du Nord
ne pouvait que souligner l’importance d’un
tel débat et, dans le même temps, les hésitations de la communa
uté internationale.
Paradoxalement, la situation internationale de l’Éthiopie avait ra
rement été aussi favorable.
Pièce
maîtresse de la lutte antiterroriste au niveau régional, Addis-Abé
ba bénéficiait des faveurs de
Washington.
La communauté internationale ne s’émouvait guère
des multiples violations de l’embargo sur
les armes vis-à-vis de la Somalie puisque les destinataires de ces de
rnières étaient des chefs de guerre
stipendiés par les États-Unis pour kidnapper les éventuels susp
ects d’activités terroristes, comme en
Afghanistan..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Cambodge (2003-2004): Crise institutionnelle
- Chili 2003-2004: La «crise du gaz»
- Lésotho (2003-2004): Persistance de la crise alimentaire
- Cambodge (2003-2004): Crise institutionnelle
- Bolivie 2003-2004 Enlisement dans la crise politique