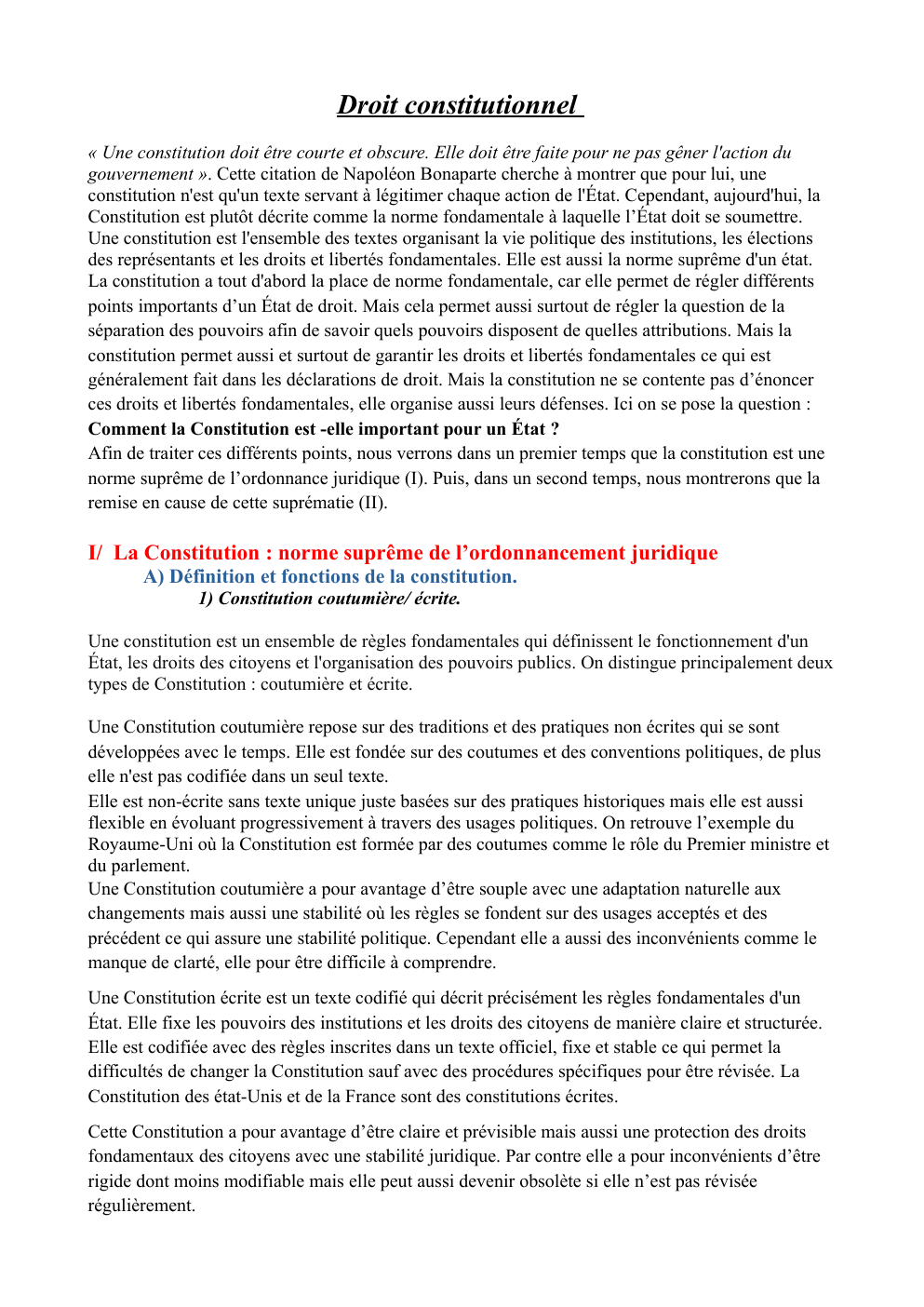Droit constitutionnel: dissertation sur la constitution
Publié le 09/11/2025
Extrait du document
«
Droit constitutionnel
« Une constitution doit être courte et obscure.
Elle doit être faite pour ne pas gêner l'action du
gouvernement ».
Cette citation de Napoléon Bonaparte cherche à montrer que pour lui, une
constitution n'est qu'un texte servant à légitimer chaque action de l'État.
Cependant, aujourd'hui, la
Constitution est plutôt décrite comme la norme fondamentale à laquelle l’État doit se soumettre.
Une constitution est l'ensemble des textes organisant la vie politique des institutions, les élections
des représentants et les droits et libertés fondamentales.
Elle est aussi la norme suprême d'un état.
La constitution a tout d'abord la place de norme fondamentale, car elle permet de régler différents
points importants d’un État de droit.
Mais cela permet aussi surtout de régler la question de la
séparation des pouvoirs afin de savoir quels pouvoirs disposent de quelles attributions.
Mais la
constitution permet aussi et surtout de garantir les droits et libertés fondamentales ce qui est
généralement fait dans les déclarations de droit.
Mais la constitution ne se contente pas d’énoncer
ces droits et libertés fondamentales, elle organise aussi leurs défenses.
Ici on se pose la question :
Comment la Constitution est -elle important pour un État ?
Afin de traiter ces différents points, nous verrons dans un premier temps que la constitution est une
norme suprême de l’ordonnance juridique (I).
Puis, dans un second temps, nous montrerons que la
remise en cause de cette suprématie (II).
I/ La Constitution : norme suprême de l’ordonnancement juridique
A) Définition et fonctions de la constitution.
1) Constitution coutumière/ écrite.
Une constitution est un ensemble de règles fondamentales qui définissent le fonctionnement d'un
État, les droits des citoyens et l'organisation des pouvoirs publics.
On distingue principalement deux
types de Constitution : coutumière et écrite.
Une Constitution coutumière repose sur des traditions et des pratiques non écrites qui se sont
développées avec le temps.
Elle est fondée sur des coutumes et des conventions politiques, de plus
elle n'est pas codifiée dans un seul texte.
Elle est non-écrite sans texte unique juste basées sur des pratiques historiques mais elle est aussi
flexible en évoluant progressivement à travers des usages politiques.
On retrouve l’exemple du
Royaume-Uni où la Constitution est formée par des coutumes comme le rôle du Premier ministre et
du parlement.
Une Constitution coutumière a pour avantage d’être souple avec une adaptation naturelle aux
changements mais aussi une stabilité où les règles se fondent sur des usages acceptés et des
précédent ce qui assure une stabilité politique.
Cependant elle a aussi des inconvénients comme le
manque de clarté, elle pour être difficile à comprendre.
Une Constitution écrite est un texte codifié qui décrit précisément les règles fondamentales d'un
État.
Elle fixe les pouvoirs des institutions et les droits des citoyens de manière claire et structurée.
Elle est codifiée avec des règles inscrites dans un texte officiel, fixe et stable ce qui permet la
difficultés de changer la Constitution sauf avec des procédures spécifiques pour être révisée.
La
Constitution des état-Unis et de la France sont des constitutions écrites.
Cette Constitution a pour avantage d’être claire et prévisible mais aussi une protection des droits
fondamentaux des citoyens avec une stabilité juridique.
Par contre elle a pour inconvénients d’être
rigide dont moins modifiable mais elle peut aussi devenir obsolète si elle n’est pas révisée
régulièrement.
2) Constitution: séparation des pouvoirs et garantie des Droits
Un des rôles principaux de la Constitution est d’organiser le pouvoir au sein de l’État.
Elle définit
les institutions qui exercent le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, en garantissant leur
indépendance respective.
Cette séparation des pouvoirs est un principe fondamental de la plupart
des démocraties modernes, et elle vise à éviter les abus de pouvoir.
Ainsi, la Constitution sert de
cadre à la démocratie, en instaurant un équilibre entre les différents pouvoirs et en prévoyant les
mécanismes de contrôle et de responsabilité.
Elle permet de définit non seulement les grandes lignes de la séparation des pouvoirs, mais elle
précise aussi l'organisation et le fonctionnement de chaque institution.
Elle détermine la structure de
l'exécutif (présidence, gouvernement), la composition et les compétences du législatif (parlement ou
congrès), et le rôle du pouvoir judiciaire.
Chaque institution a une place bien définie dans le
système politique, et la Constitution détermine leurs relations, leurs compétences et les modalités de
leur fonctionnement.
Cette théorie peut prendre deux formes qui se retrouvent dans deux types de constitutions.
Ainsi, la
Constitution américaine prévoit un régime présidentiel, c'est-à-dire que la fonction exécutive est
exercée par un Président disposant de pouvoirs plutôt étendus et la séparation des pouvoirs est une
séparation stricte des pouvoirs.
A contrario, un régime parlementaire comme le régime allemand va
avoir une séparation des pouvoirs moins stricte et plus de coopération entre les pouvoirs.
Lors de la séparation des pouvoirs, la constitution doit aussi réguler les conflits entre les différents
pouvoirs.
Pour cela, la Constitution va créer une institution qui a pour but de trancher les conflits
d'attribution.
Cette institution s'appelle le Conseil constitutionnel en France, elle va permettre de
vérifier si les actions du Gouvernement n’outre passent pas les prérogatives que lui donne la
constitution.
En Allemagne, le Bundesverfassungsgericht, l’équivalent du Conseil constitutionnel de
France, va aussi être amené à trancher donc les conflits d'attribution entre les États fédérés et l'État
fédéral.
B) La constitution en tant que norme fondamentale, contesté aujourd'hui
1) La place de la constitution dans la hiérarchie des normes
La Constitution occupe une place centrale dans l'édifice juridique d'un pays.
Elle se situe au sommet
de la hiérarchie des normes une théorie de Hans Kelsen, dans laquelle chaque norme inférieure doit
se conformer aux normes supérieures c'est-à-dire qu'aucune règle juridique inférieure peut lui être
contraire.
Dans cette pyramide, la constitution fait partie du bloc de constitutionnalité et est la plus
haute norme existante.
On dit donc qu'elle, ainsi que les textes qui lui sont rattachés, sont la norme
fondamentale de l'État.
Hiérarchie des normes est constitué de la Constitution qui est la norme suprême, doit respecter ses
principes, puis des lois, décrets, règlements qui doivent être en accord avec la Constitution.
Si une
loi est contraire à la Constitution, elle peut être annulée.
Et pour finir les traités internationaux car
selon le pays les traités sont inférieurs à la Constitution.
S'ils sont en conflit avec la Constitution,
ils peuvent aussi être annulés ou révisés.
Cette position privilégiée est ce qui fait de la Constitution une norme suprême.
En France, par
exemple, le Conseil constitutionnel veille au respect de cette hiérarchie et peut censurer des lois
contraires à la Constitution.
Cette idée de suprématie constitutionnelle existe aussi dans d’autres
pays, comme les États-Unis où la Cour suprême joue un rôle similaire.
2) Une place remise en cause dû à l’apparition du droit international et
communautaire
La place de la Constitution est parfois remise en question aujourd'hui en raison de l'importance
croissante du droit international....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- dissertation droit constitutionnel: : la cohabitation sous la Vème République
- Droit constitutionnel: la constitution de 1958
- Dissertation TD 3 (droit constitutionnel) Sujet
- Introduction au droit constitutionnel: Le fondement juridique du pouvoir : La Constitution
- Cours droit constitutionnel