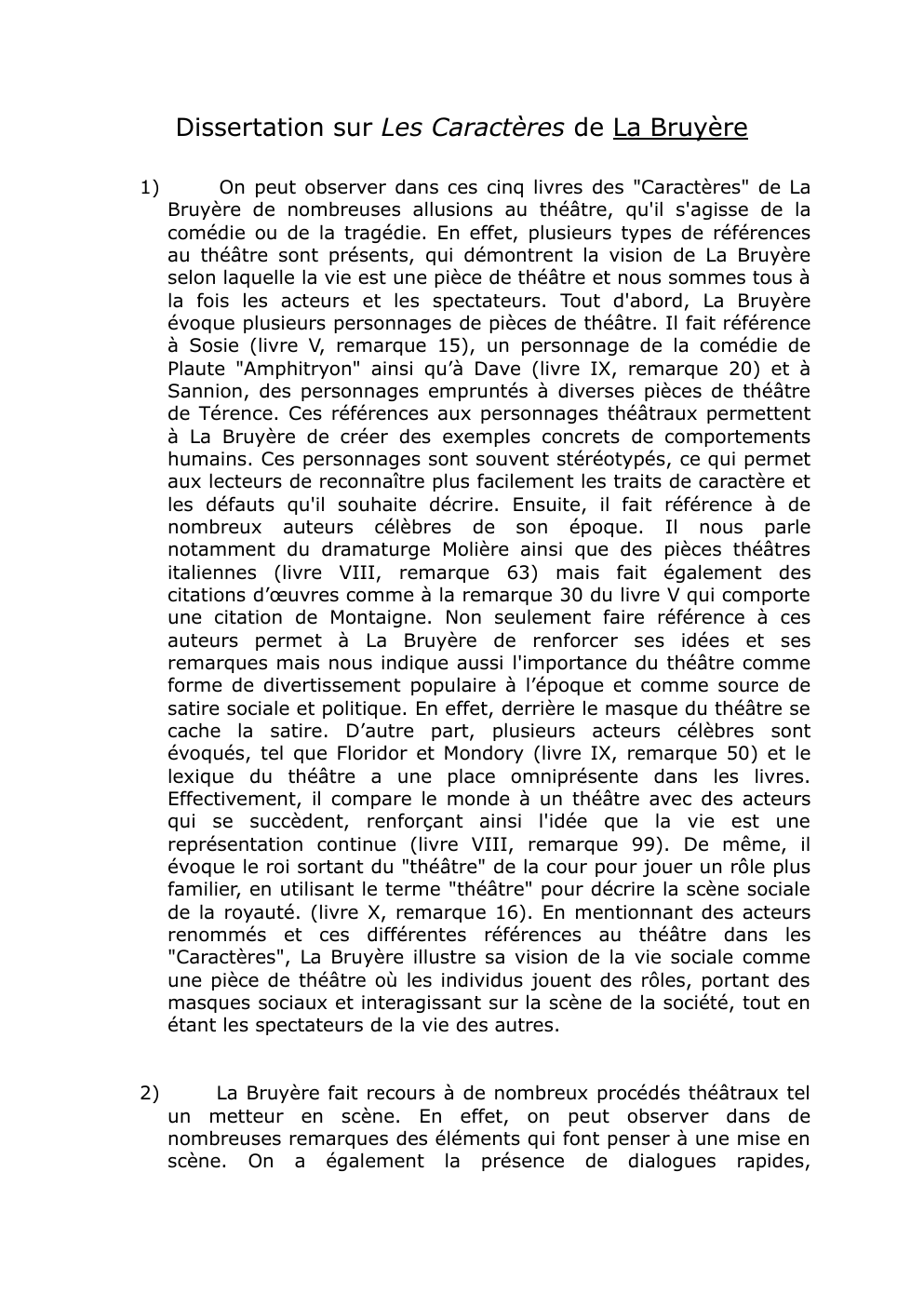Dissertation Les Caractères
Publié le 03/05/2025
Extrait du document
«
Dissertation sur Les Caractères de La Bruyère
1)
On peut observer dans ces cinq livres des "Caractères" de La
Bruyère de nombreuses allusions au théâtre, qu'il s'agisse de la
comédie ou de la tragédie.
En effet, plusieurs types de références
au théâtre sont présents, qui démontrent la vision de La Bruyère
selon laquelle la vie est une pièce de théâtre et nous sommes tous à
la fois les acteurs et les spectateurs.
Tout d'abord, La Bruyère
évoque plusieurs personnages de pièces de théâtre.
Il fait référence
à Sosie (livre V, remarque 15), un personnage de la comédie de
Plaute "Amphitryon" ainsi qu’à Dave (livre IX, remarque 20) et à
Sannion, des personnages empruntés à diverses pièces de théâtre
de Térence.
Ces références aux personnages théâtraux permettent
à La Bruyère de créer des exemples concrets de comportements
humains.
Ces personnages sont souvent stéréotypés, ce qui permet
aux lecteurs de reconnaître plus facilement les traits de caractère et
les défauts qu'il souhaite décrire.
Ensuite, il fait référence à de
nombreux auteurs célèbres de son époque.
Il nous parle
notamment du dramaturge Molière ainsi que des pièces théâtres
italiennes (livre VIII, remarque 63) mais fait également des
citations d’œuvres comme à la remarque 30 du livre V qui comporte
une citation de Montaigne.
Non seulement faire référence à ces
auteurs permet à La Bruyère de renforcer ses idées et ses
remarques mais nous indique aussi l'importance du théâtre comme
forme de divertissement populaire à l’époque et comme source de
satire sociale et politique.
En effet, derrière le masque du théâtre se
cache la satire.
D’autre part, plusieurs acteurs célèbres sont
évoqués, tel que Floridor et Mondory (livre IX, remarque 50) et le
lexique du théâtre a une place omniprésente dans les livres.
Effectivement, il compare le monde à un théâtre avec des acteurs
qui se succèdent, renforçant ainsi l'idée que la vie est une
représentation continue (livre VIII, remarque 99).
De même, il
évoque le roi sortant du "théâtre" de la cour pour jouer un rôle plus
familier, en utilisant le terme "théâtre" pour décrire la scène sociale
de la royauté.
(livre X, remarque 16).
En mentionnant des acteurs
renommés et ces différentes références au théâtre dans les
"Caractères", La Bruyère illustre sa vision de la vie sociale comme
une pièce de théâtre où les individus jouent des rôles, portant des
masques sociaux et interagissant sur la scène de la société, tout en
étant les spectateurs de la vie des autres.
2)
La Bruyère fait recours à de nombreux procédés théâtraux tel
un metteur en scène.
En effet, on peut observer dans de
nombreuses remarques des éléments qui font penser à une mise en
scène.
On a également la présence de dialogues rapides,
notamment (livre V, remarque 82).
Ces échanges nous rappellent le
théâtre et les répliques brèves qu’on appelle stichomythie.
Ces
dernières impliquent le lecteur dans les réflexions qui s'imposent à
lui.
Ces indications peuvent aussi être sur le ton de la voix comme à
la remarque 12 du livre V où un personnage parle de façon très
expressive.
En effet, il est très présent dans les conversations et
perturbe les autres.
Ceci permet de définir la personnalité de ce
personnage.
On peut également retrouver des détails physiques
(livre VI, remarque 11).
Ils étoffent le personnage qui parait ici
comme un homme d’un rang élevé.
De plus, La Bruyère décrit
parfois les décors dans lesquels évoluent les personnages comme à
la remarque 49 du livre V ou encore à la remarque 47 du livre V.
Il
décrit des environnements d’une campagne rurale pour décrire le
calme qui y règne.
L’auteur utilise aussi plusieurs procédés
théâtraux.
On peut retrouver du comique de répétition (livre V,
remarque 7) lorsque le nom du personnage, Acis, est répété à trois
reprises.
De la même façon, il rajoute également de nombreuses
questions pour mettre en valeur l'incompréhension.
Ensuite, on
retrouve un autre type de comique, le comique de mots.
La Bruyère
joue sur les diverses significations d'un même mot afin de donner
plusieurs sens à ses remarques.
Dans le livre V, remarque 46 et le
livre VIII, remarque 10, il utilise le terme « marâtre » qui possède
deux sens, celui d'une nouvelle mère par rapport à des enfants
issus d'un mariage précédent et celui d'une mauvaise mère.
L’expression « polis », qui signifie à la fois usés et élégants, est
aussi utilisée.
Par ailleurs, La Bruyère emploie aussi un comique de
caractère qui consiste à exagérer un défaut d’un personnage,
jusqu'à ce qu'il en devienne ridicule.
L'auteur l'emploie par exemple
pour décrédibiliser les individus qui s'expriment mal, exagérant
leurs manières (livre V, remarque 6).
Ces gens sont à nouveaux
ridiculisées et leur « masque » de société, leur paraître, est mis en
lumière.
On retrouve finalement un dernier comique, le comique de
gestes (livre V, remarque 75).
Effectivement, l’auteur décrit
précisément chaque geste effectué par Cydias pour se moquer du
comportement de ce personnage.
L'auteur manipule ainsi les deux
sens du mot ce qui permet de révéler l'ironie de la phrase.
Il se sert
donc de plusieurs techniques, notamment des indications de mise
en scène, des dialogues vifs, des descriptions de décors, et
l'utilisation de registres comiques, qui renvoient à l’univers théâtral.
3)
L’auteur nous présente une société à la cour du roi caractérisée
par un comportement en grande partie axé sur la mise en scène et
les apparences où le roi occupe une position centrale.
Effectivement, ce dernier utilise en grande partie un champ lexical
lié au regard et à la vue (livre VIII, remarque 4), (livre VIII,
remarque 26), (livre VIII, remarque 30).
Cette focalisation sur le
regard permet d’exprimer une critique sociale en mettant l'accent
sur la manière dont les personnages regardent les autres et les
jugent en fonction de l'apparence, de la classe sociale, etc… L'auteur
critique donc les préjugés et la superficialité de la société de son
époque.
De plus, on peut, observer des descriptions très détaillées
des personnages, comprenant non seulement leur apparence, mais
aussi leur comportement, leurs manières et leurs attitudes (livre
VIII, remarque 61).
Ceci permet de visualiser les détails de ces
personnes et nous attirer l’attention vers leurs défauts et leurs
vices.
C’est cela qui va renforcer l’idée d’un regard constant, d’un
jugement sur les autres et sur soi-même.
En outre, le roi à une
place centrale dans cette société en étant celui que tout le monde
regarde et celui autour duquel tout le monde tourne.
Dans la
remarque 19 du livre VIII, une métaphore qui compare le roi à
Jupiter est utilisée.
C’est ceci qui permet de montrer l’importance du
roi et de son influence telle une planète et les autres, tout comme
des satellites, qui ne font que tourner autour de celui-ci espérant
obtenir des faveurs .
Tous les regards sont donc portés sur lui et ses
actions (livre X, remarque 35) que celles-ci soient bonnes ou
mauvaises.
En effet à la remarque 26 du livre X, la bruyère critique
la manière dont le roi ainsi que le peuple confondent les intérêts de
l’état avec ceux du peuple.
Ceci évoque aussi la fameuse phrase de
Louis XIV « L’état, c’est moi » qui renforce bien la position centrale
du roi.
Cependant il en fait également l’éloge lorsqu’il qualifie le
souverain de Père du peuple (livre X, remarque 27) ou encore que
le roi soit digne de son nom de Grand (livre X, remarque 35).
Enfin
à le remarque 29 du livre X, l’auteur fait recours à une métaphore
en comparant le roi à un berger et le peuple à un troupeau de
moutons.
Le roi est donc mis en valeur comme un protecteur
central du peuple mais La Bruyère met également en garde contre
le faste et le luxe inutiles du souverain comparable au berger habillé
d'or et de pierreries.
Il suggère que ces extravagances n'apportent
aucun avantage au peuple, tout comme un berger paré d'or ne
serait d'aucune utilité pour les brebis.
Cela souligne l'idée que le
souverain devrait plutôt se concentrer sur le bien-être de son
peuple, au lieu de s'encombrer de richesses et d'ornements inutiles.
Malgré ces défauts, c’est ce dernier qui détermine l’apparence des
autres et leurs comportements.
A la remarque 13 du livre VIII, La
Bruyère décrit la manière dont les courtisans changent leur manière
d’être autour du roi.
Sa présence influe sur les courtisan.
Que ce
soient leurs habits ou leur comportement, ils se déguisent et
portent des masques (livre VIII, remarque 48) pour plaire et se
conformer aux yeux du roi qui définissent les normes sociales.
Toute
la cour se déguise tel un spectacle et imite ce modèle pour plaire au
roi.
4)
En effet, à travers les livres, l’auteur fait le portrait de
nombreux courtisans en les présentant comme des automates
faisant tout le temps la même chose sans réfléchir (livre VIII,
remarque 65).
A la remarque 12 du livre VII, Narcisse est présenté
comme un personnage ayant une routine quotidienne et
particulière.
La parataxe ici présente fait penser à une répétition.
souligne son manque de changement....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dissertation Les Caractères de La Bruyère
- Révision dissertation: Jean de La Bruyère est l’auteur d’une œuvre unique, Les caractères
- Correction dissertation sur le Moyen orient hggsp terminale
- Selon Xavier Marton auteur d’une étude sur La Bruyère « la comédie sociale que dévoilent et dénoncent Les Caractères contraint chacun à se mettre en scène ».
- Correction dissertation Baccalauréat 2023.pdf