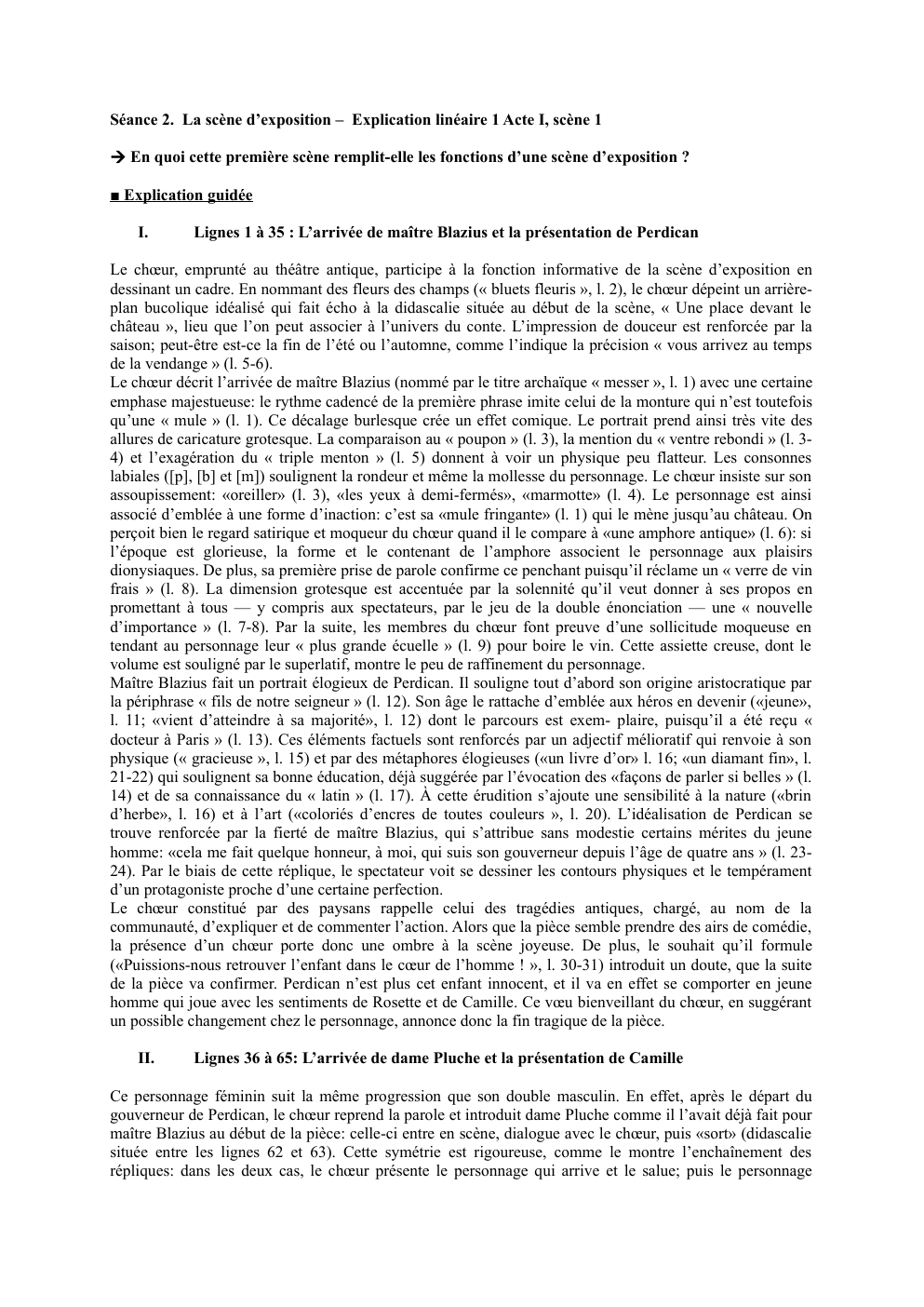corrigé classico lycée explication linéaire Acte I scène 1 On ne badine pas avec l'amour
Publié le 20/12/2023
Extrait du document
«
Séance 2.
La scène d’exposition – Explication linéaire 1 Acte I, scène 1
En quoi cette première scène remplit-elle les fonctions d’une scène d’exposition ?
■ Explication guidée
I.
Lignes 1 à 35 : L’arrivée de maître Blazius et la présentation de Perdican
Le chœur, emprunté au théâtre antique, participe à la fonction informative de la scène d’exposition en
dessinant un cadre.
En nommant des fleurs des champs (« bluets fleuris », l.
2), le chœur dépeint un arrièreplan bucolique idéalisé qui fait écho à la didascalie située au début de la scène, « Une place devant le
château », lieu que l’on peut associer à l’univers du conte.
L’impression de douceur est renforcée par la
saison; peut-être est-ce la fin de l’été ou l’automne, comme l’indique la précision « vous arrivez au temps
de la vendange » (l.
5-6).
Le chœur décrit l’arrivée de maître Blazius (nommé par le titre archaïque « messer », l.
1) avec une certaine
emphase majestueuse: le rythme cadencé de la première phrase imite celui de la monture qui n’est toutefois
qu’une « mule » (l.
1).
Ce décalage burlesque crée un effet comique.
Le portrait prend ainsi très vite des
allures de caricature grotesque.
La comparaison au « poupon » (l.
3), la mention du « ventre rebondi » (l.
34) et l’exagération du « triple menton » (l.
5) donnent à voir un physique peu flatteur.
Les consonnes
labiales ([p], [b] et [m]) soulignent la rondeur et même la mollesse du personnage.
Le chœur insiste sur son
assoupissement: «oreiller» (l.
3), «les yeux à demi-fermés», «marmotte» (l.
4).
Le personnage est ainsi
associé d’emblée à une forme d’inaction: c’est sa «mule fringante» (l.
1) qui le mène jusqu’au château.
On
perçoit bien le regard satirique et moqueur du chœur quand il le compare à «une amphore antique» (l.
6): si
l’époque est glorieuse, la forme et le contenant de l’amphore associent le personnage aux plaisirs
dionysiaques.
De plus, sa première prise de parole confirme ce penchant puisqu’il réclame un « verre de vin
frais » (l.
8).
La dimension grotesque est accentuée par la solennité qu’il veut donner à ses propos en
promettant à tous — y compris aux spectateurs, par le jeu de la double énonciation — une « nouvelle
d’importance » (l.
7-8).
Par la suite, les membres du chœur font preuve d’une sollicitude moqueuse en
tendant au personnage leur « plus grande écuelle » (l.
9) pour boire le vin.
Cette assiette creuse, dont le
volume est souligné par le superlatif, montre le peu de raffinement du personnage.
Maître Blazius fait un portrait élogieux de Perdican.
Il souligne tout d’abord son origine aristocratique par
la périphrase « fils de notre seigneur » (l.
12).
Son âge le rattache d’emblée aux héros en devenir («jeune»,
l.
11; «vient d’atteindre à sa majorité», l.
12) dont le parcours est exem- plaire, puisqu’il a été reçu «
docteur à Paris » (l.
13).
Ces éléments factuels sont renforcés par un adjectif mélioratif qui renvoie à son
physique (« gracieuse », l.
15) et par des métaphores élogieuses («un livre d’or» l.
16; «un diamant fin», l.
21-22) qui soulignent sa bonne éducation, déjà suggérée par l’évocation des «façons de parler si belles » (l.
14) et de sa connaissance du « latin » (l.
17).
À cette érudition s’ajoute une sensibilité à la nature («brin
d’herbe», l.
16) et à l’art («coloriés d’encres de toutes couleurs », l.
20).
L’idéalisation de Perdican se
trouve renforcée par la fierté de maître Blazius, qui s’attribue sans modestie certains mérites du jeune
homme: «cela me fait quelque honneur, à moi, qui suis son gouverneur depuis l’âge de quatre ans » (l.
2324).
Par le biais de cette réplique, le spectateur voit se dessiner les contours physiques et le tempérament
d’un protagoniste proche d’une certaine perfection.
Le chœur constitué par des paysans rappelle celui des tragédies antiques, chargé, au nom de la
communauté, d’expliquer et de commenter l’action.
Alors que la pièce semble prendre des airs de comédie,
la présence d’un chœur porte donc une ombre à la scène joyeuse.
De plus, le souhait qu’il formule
(«Puissions-nous retrouver l’enfant dans le cœur de l’homme ! », l.
30-31) introduit un doute, que la suite
de la pièce va confirmer.
Perdican n’est plus cet enfant innocent, et il va en effet se comporter en jeune
homme qui joue avec les sentiments de Rosette et de Camille.
Ce vœu bienveillant du chœur, en suggérant
un possible changement chez le personnage, annonce donc la fin tragique de la pièce.
II.
Lignes 36 à 65: L’arrivée de dame Pluche et la présentation de Camille
Ce personnage féminin suit la même progression que son double masculin.
En effet, après le départ du
gouverneur de Perdican, le chœur reprend la parole et introduit dame Pluche comme il l’avait déjà fait pour
maître Blazius au début de la pièce: celle-ci entre en scène, dialogue avec le chœur, puis «sort» (didascalie
située entre les lignes 62 et 63).
Cette symétrie est rigoureuse, comme le montre l’enchaînement des
répliques: dans les deux cas, le chœur présente le personnage qui arrive et le salue; puis le personnage
demande à boire; le chœur lui offre à boire et interroge le personnage; le personnage annonce alors l’arrivée
d’un autre personnage dont il....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Explication linéaire n°2 : Molière, Le Malade imaginaire, Acte III, scène 3
- Explication linéaire Acte I Scène 3 Ruy Blas
- Le Jeu de l’Amour et du hasard- extrait de la scène 8 de l’acte III– récapitulatif de cours pour une analyse linéaire à l’oral
- Explication linéaire le malade imaginaire acte II scène 5
- Explication linéaire de la scène 5 de l’acte II du Malade Imaginaire