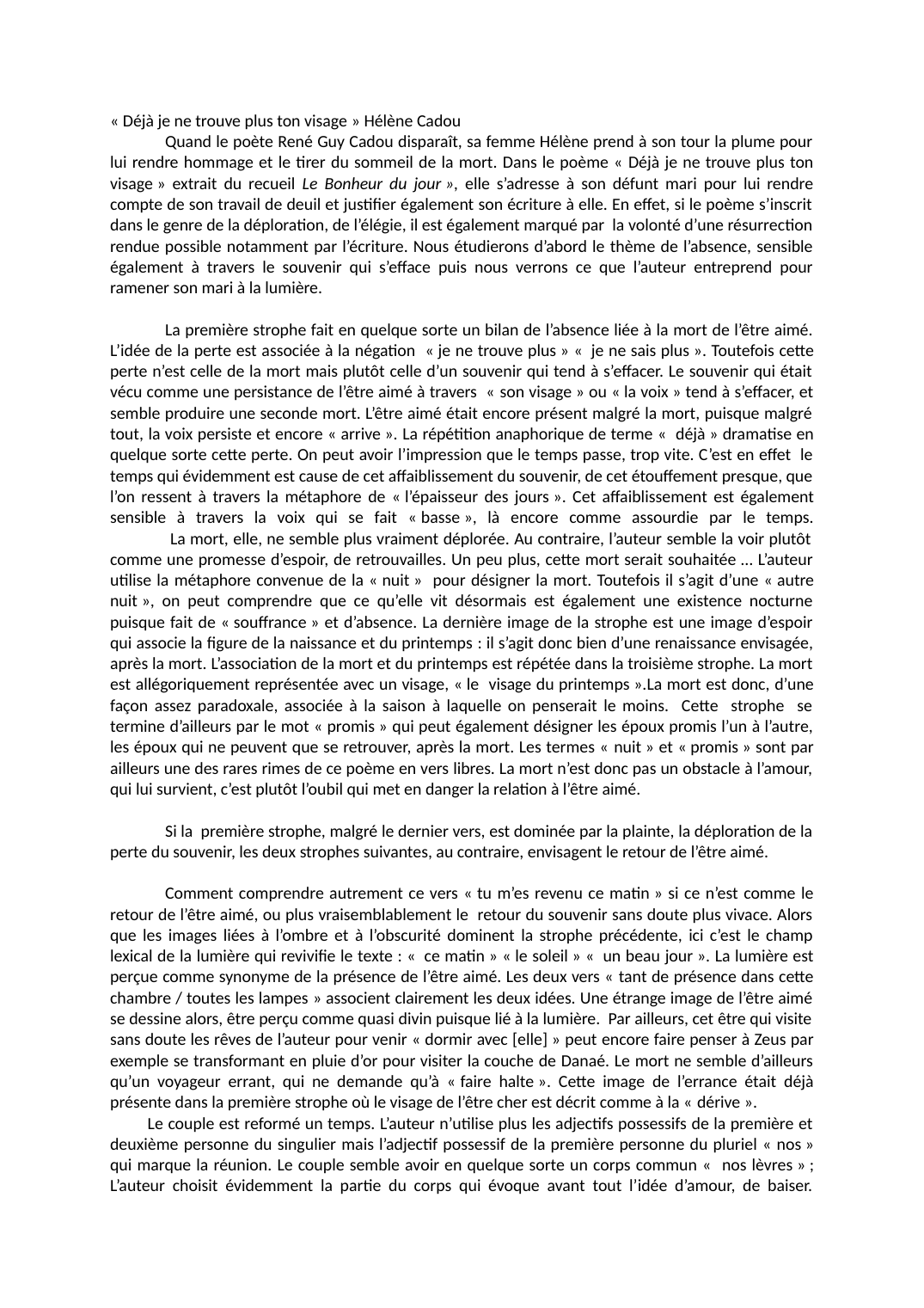commentaire Hélène Cadou déjà je ne trouve plus ton visage
Publié le 29/09/2021

Extrait du document
«
« Déjà je ne trouve plus ton visage » Hélène Cadou
Quand le poète René Guy Cadou disparaît, sa femme Hélène prend à son tour la plume pour
lui rendre hommage et le tirer du sommeil de la mort.
Dans le poème « Déjà je ne trouve plus ton
visage » extrait du recueil Le Bonheur du jour », elle s’adresse à son défunt mari pour lui rendre
compte de son travail de deuil et justifier également son écriture à elle.
En effet, si le poème s’inscrit
dans le genre de la déploration, de l’élégie, il est également marqué par la volonté d’une résurrection
rendue possible notamment par l’écriture.
Nous étudierons d’abord le thème de l’absence, sensible
également à travers le souvenir qui s’efface puis nous verrons ce que l’auteur entreprend pour
ramener son mari à la lumière.
La première strophe fait en quelque sorte un bilan de l’absence liée à la mort de l’être aimé.
L’idée de la perte est associée à la négation « je ne trouve plus » « je ne sais plus ».
Toutefois cette
perte n’est celle de la mort mais plutôt celle d’un souvenir qui tend à s’effacer.
Le souvenir qui était
vécu comme une persistance de l’être aimé à travers « son visage » ou « la voix » tend à s’effacer, et
semble produire une seconde mort.
L’être aimé était encore présent malgré la mort, puisque malgré
tout, la voix persiste et encore « arrive ».
La répétition anaphorique de terme « déjà » dramatise en
quelque sorte cette perte.
On peut avoir l’impression que le temps passe, trop vite.
C’est en effet le
temps qui évidemment est cause de cet affaiblissement du souvenir, de cet étouffement presque, que
l’on ressent à travers la métaphore de « l’épaisseur des jours ».
Cet affaiblissement est également
sensible à travers la voix qui se fait « basse », là encore comme assourdie par le temps.
La mort, elle, ne semble plus vraiment déplorée.
Au contraire, l’auteur semble la voir plutôt
comme une promesse d’espoir, de retrouvailles.
Un peu plus, cette mort serait souhaitée … L’auteur
utilise la métaphore convenue de la « nuit » pour désigner la mort.
Toutefois il s’agit d’une « autre
nuit », on peut comprendre que ce qu’elle vit désormais est également une existence nocturne
puisque fait de « souffrance » et d’absence.
La dernière image de la strophe est une image d’espoir
qui associe la figure de la naissance et du printemps : il s’agit donc bien d’une renaissance envisagée,
après la mort.
L’association de la mort et du printemps est répétée dans la troisième strophe.
La mort
est allégoriquement représentée avec un visage, « le visage du printemps ».La mort est donc, d’une
façon assez paradoxale, associée à la saison à laquelle on penserait le moins.
Cette strophe se
termine d’ailleurs par le mot « promis » qui peut également désigner les époux promis l’un à l’autre,
les époux qui ne peuvent que se retrouver, après la mort.
Les termes « nuit » et « promis » sont par
ailleurs une des rares rimes de ce poème en vers libres.
La mort n’est donc pas un obstacle à l’amour,
qui lui survient, c’est plutôt l’oubil qui met en danger la relation à l’être aimé.
Si la première strophe, malgré le dernier vers, est dominée par la plainte, la déploration de la
perte du souvenir, les deux strophes suivantes, au contraire, envisagent le retour de l’être aimé.
Comment comprendre autrement ce vers « tu m’es revenu ce matin » si ce n’est comme le
retour de l’être aimé, ou plus vraisemblablement le retour du souvenir sans doute plus vivace.
Alors
que les images liées à l’ombre et à l’obscurité dominent la strophe précédente, ici c’est le champ
lexical de la lumière qui revivifie le texte : « ce matin » « le soleil » « un beau jour ».
La lumière est
perçue comme synonyme de la présence de l’être aimé.
Les deux vers « tant de présence dans cette
chambre / toutes les lampes » associent clairement les deux idées.
Une étrange image de l’être aimé
se dessine alors, être perçu comme quasi divin puisque lié à la lumière.
Par ailleurs, cet être qui visite
sans doute les rêves de l’auteur pour venir « dormir avec [elle] » peut encore faire penser à Zeus par
exemple se transformant en pluie d’or pour visiter la couche de Danaé.
Le mort ne semble d’ailleurs
qu’un voyageur errant, qui ne demande qu’à « faire halte ».
Cette image de l’errance était déjà
présente dans la première strophe où le visage de l’être cher est décrit comme à la « dérive ».
Le couple est reformé un temps.
L’auteur n’utilise plus les adjectifs possessifs de la première et
deuxième personne du singulier mais l’adjectif possessif de la première personne du pluriel « nos »
qui marque la réunion.
Le couple semble avoir en quelque sorte un corps commun « nos lèvres » ;
L’auteur choisit évidemment la partie du corps qui évoque avant tout l’idée d’amour, de baiser..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- René Guy Cadou, Hélène ou le règne végétal, 1945. « Je t'attendais ainsi qu'on attend les navires ». Commentaire
- Sonnets pour Hélène de Ronsard: Quand vous serez bien vieille (commentaire)
- René-Guy CADOU: La nuit ! La nuit surtout je ne rêve pas je vois. Commentaire
- Dans le texte la souris Algernon se trouve confrontée à une expérience angoissante. Vous-même, avez-vous déjà éprouvé un sentiment de même nature face à une situation réelle, ou à la lecture d'un roman, ou lors de la vision d'un film d'horreur ? Décrire les circonstances et analyser vos réactions.
- Commentaire littéraire Thérèse Desqueyroux, François Mauriac Chapitre IV de « Ce dernier soir avant le retour au pays » à « déjà il se rapprochait.