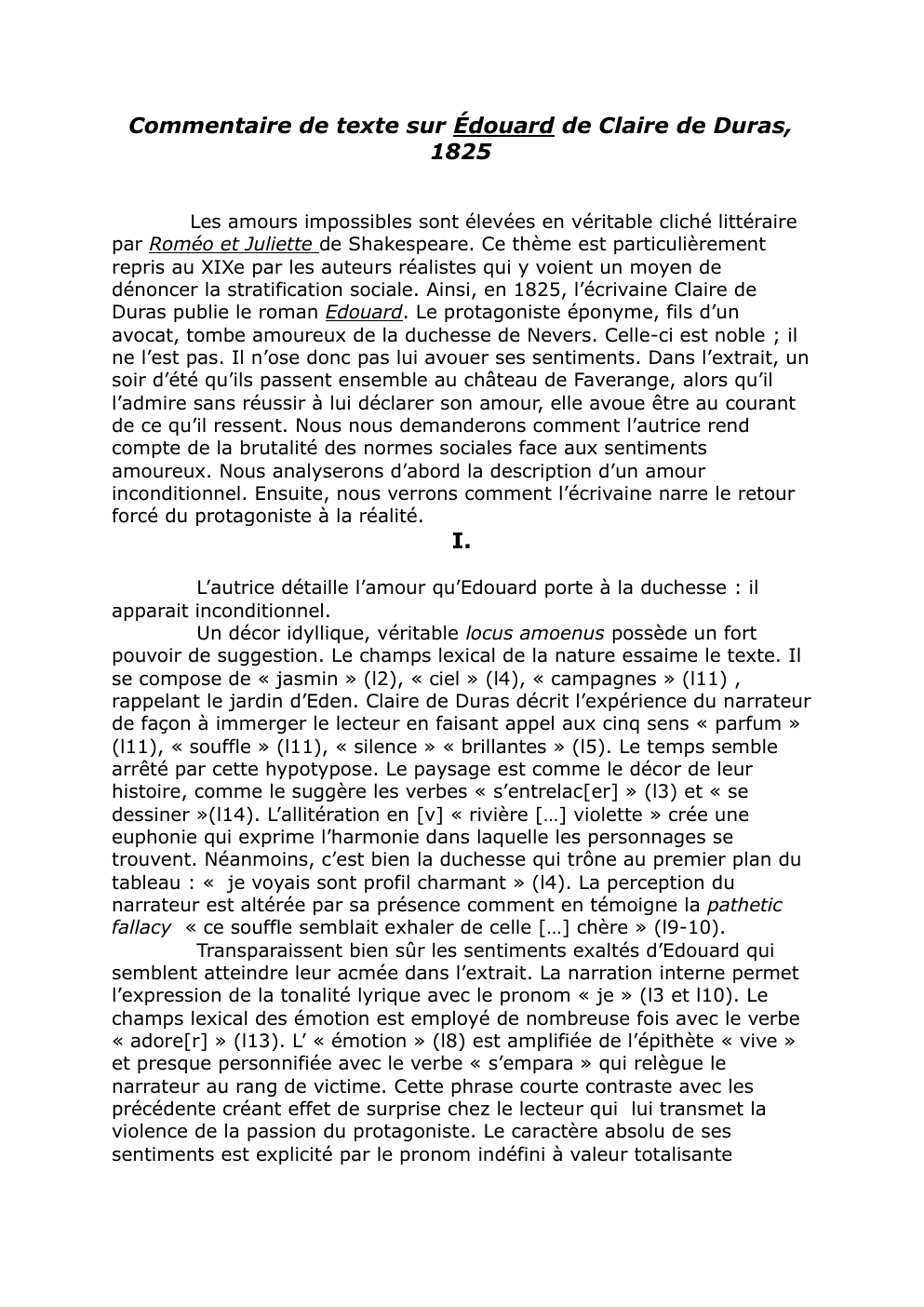commentaire de texte noté 20 bac francais 2024 Commentaire de texte sur Édouard de Claire de Duras, 1825
Publié le 12/07/2025
Extrait du document
«
Commentaire de texte sur Édouard de Claire de Duras,
1825
Les amours impossibles sont élevées en véritable cliché littéraire
par Roméo et Juliette de Shakespeare.
Ce thème est particulièrement
repris au XIXe par les auteurs réalistes qui y voient un moyen de
dénoncer la stratification sociale.
Ainsi, en 1825, l’écrivaine Claire de
Duras publie le roman Edouard.
Le protagoniste éponyme, fils d’un
avocat, tombe amoureux de la duchesse de Nevers.
Celle-ci est noble ; il
ne l’est pas.
Il n’ose donc pas lui avouer ses sentiments.
Dans l’extrait, un
soir d’été qu’ils passent ensemble au château de Faverange, alors qu’il
l’admire sans réussir à lui déclarer son amour, elle avoue être au courant
de ce qu’il ressent.
Nous nous demanderons comment l’autrice rend
compte de la brutalité des normes sociales face aux sentiments
amoureux.
Nous analyserons d’abord la description d’un amour
inconditionnel.
Ensuite, nous verrons comment l’écrivaine narre le retour
forcé du protagoniste à la réalité.
I.
L’autrice détaille l’amour qu’Edouard porte à la duchesse : il
apparait inconditionnel.
Un décor idyllique, véritable locus amoenus possède un fort
pouvoir de suggestion.
Le champs lexical de la nature essaime le texte.
Il
se compose de « jasmin » (l2), « ciel » (l4), « campagnes » (l11) ,
rappelant le jardin d’Eden.
Claire de Duras décrit l’expérience du narrateur
de façon à immerger le lecteur en faisant appel aux cinq sens « parfum »
(l11), « souffle » (l11), « silence » « brillantes » (l5).
Le temps semble
arrêté par cette hypotypose.
Le paysage est comme le décor de leur
histoire, comme le suggère les verbes « s’entrelac[er] » (l3) et « se
dessiner »(l14).
L’allitération en [v] « rivière […] violette » crée une
euphonie qui exprime l’harmonie dans laquelle les personnages se
trouvent.
Néanmoins, c’est bien la duchesse qui trône au premier plan du
tableau : « je voyais sont profil charmant » (l4).
La perception du
narrateur est altérée par sa présence comment en témoigne la pathetic
fallacy « ce souffle semblait exhaler de celle […] chère » (l9-10).
Transparaissent bien sûr les sentiments exaltés d’Edouard qui
semblent atteindre leur acmée dans l’extrait.
La narration interne permet
l’expression de la tonalité lyrique avec le pronom « je » (l3 et l10).
Le
champs lexical des émotion est employé de nombreuse fois avec le verbe
« adore[r] » (l13).
L’ « émotion » (l8) est amplifiée de l’épithète « vive »
et presque personnifiée avec le verbe « s’empara » qui relègue le
narrateur au rang de victime.
Cette phrase courte contraste avec les
précédente créant effet de surprise chez le lecteur qui lui transmet la
violence de la passion du protagoniste.
Le caractère absolu de ses
sentiments est explicité par le pronom indéfini à valeur totalisante
« tout » (l12) et l’hyperbole « je passe ma vie près d’elle » qui fait de
l’été partagé une sorte de nouvelle naissance.
Une relation forte de compréhension mutuelle lie les deux
personnages.
En effet, le narrateur pense être compris comme signifie la
métaphore « elle lit dans mon cœur » (l14) et son expolition « devine
mes sentiments ».
L’effet de répétition crée insiste sur la croyance du
narrateur selon laquelle Mme de Nevers sait qu’il l’aime, frôlant
l’ésotérisme avec la synesthésie « elle les vois » (l15) l’élève au rang de
divineresse.
La duchesse apparait plein de compassion : le narrateur la
décrit du complément de manière « sans colère » (l15).
Cette croyance
semble confirmée par le dialogue finale : alors qu’Edouard est perturbé,
elle engage la discussion.
Il qualifie vaguement son amour du pronom
indéfini « le » (l21).
Sa....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- oral bac: Commentaire du texte : DIDEROT Encyclopédie article « Raison »
- ?BAC BLEU. JANVIER 2013. CORRIGE DU COMMENTAIRE COMPOSE.Texte
- Sujet type bac Question et commentaire de texte de Michaux: "Un Barbare en Asie"
- COMMENTAIRE DE TEXTE : “Stances à Marquise”, Pierre Corneille (1658)
- Commentaire de texte Olympe de Gouges - A partir de « Homme, es tu capable d’être juste ? »