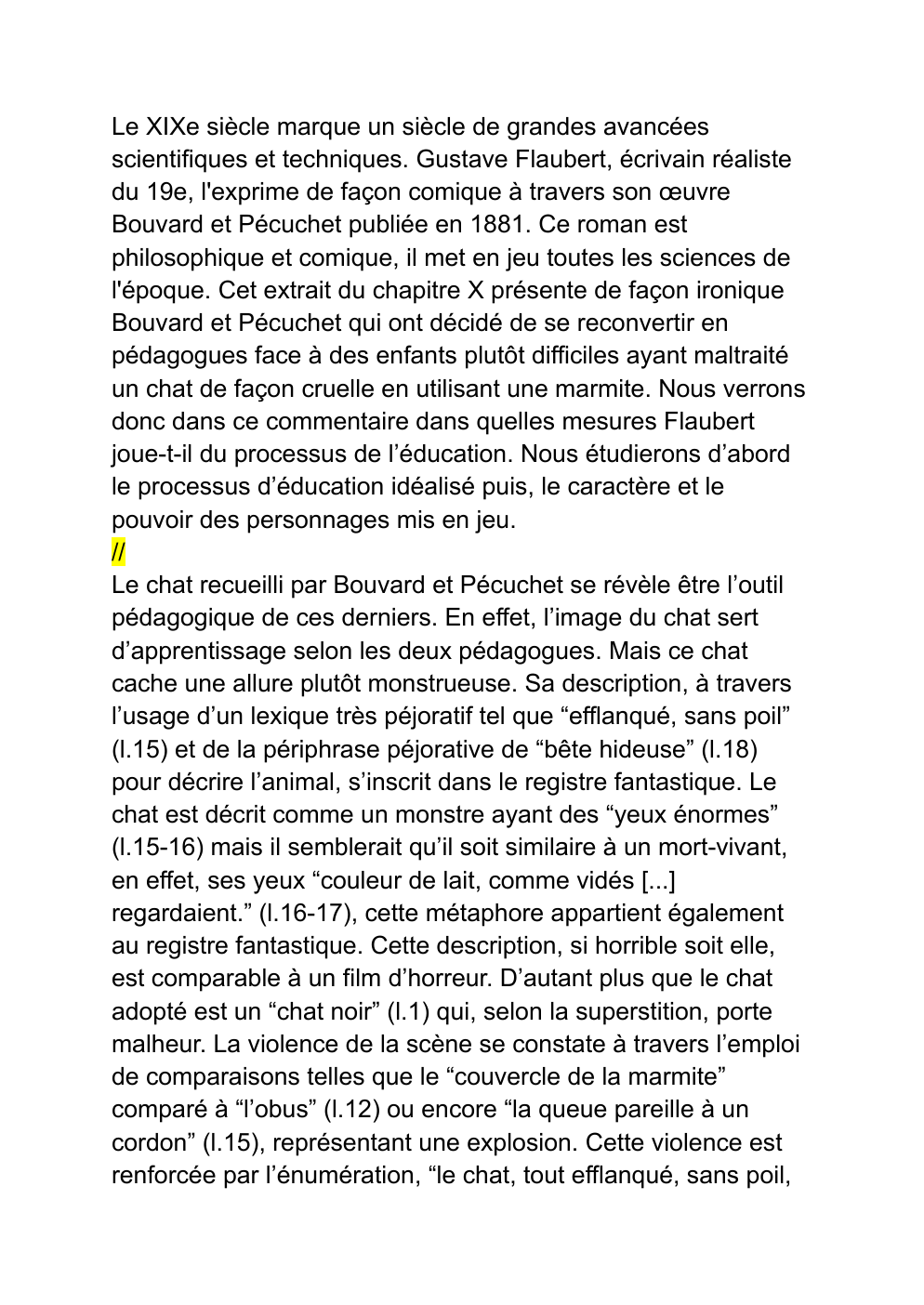Commentaire de texte chapitre X - Gustave Flaubert
Publié le 23/04/2025
Extrait du document
«
Le XIXe siècle marque un siècle de grandes avancées
scientifiques et techniques.
Gustave Flaubert, écrivain réaliste
du 19e, l'exprime de façon comique à travers son œuvre
Bouvard et Pécuchet publiée en 1881.
Ce roman est
philosophique et comique, il met en jeu toutes les sciences de
l'époque.
Cet extrait du chapitre X présente de façon ironique
Bouvard et Pécuchet qui ont décidé de se reconvertir en
pédagogues face à des enfants plutôt difficiles ayant maltraité
un chat de façon cruelle en utilisant une marmite.
Nous verrons
donc dans ce commentaire dans quelles mesures Flaubert
joue-t-il du processus de l’éducation.
Nous étudierons d’abord
le processus d’éducation idéalisé puis, le caractère et le
pouvoir des personnages mis en jeu.
//
Le chat recueilli par Bouvard et Pécuchet se révèle être l’outil
pédagogique de ces derniers.
En effet, l’image du chat sert
d’apprentissage selon les deux pédagogues.
Mais ce chat
cache une allure plutôt monstrueuse.
Sa description, à travers
l’usage d’un lexique très péjoratif tel que “efflanqué, sans poil”
(l.15) et de la périphrase péjorative de “bête hideuse” (l.18)
pour décrire l’animal, s’inscrit dans le registre fantastique.
Le
chat est décrit comme un monstre ayant des “yeux énormes”
(l.15-16) mais il semblerait qu’il soit similaire à un mort-vivant,
en effet, ses yeux “couleur de lait, comme vidés [...]
regardaient.” (l.16-17), cette métaphore appartient également
au registre fantastique.
Cette description, si horrible soit elle,
est comparable à un film d’horreur.
D’autant plus que le chat
adopté est un “chat noir” (l.1) qui, selon la superstition, porte
malheur.
La violence de la scène se constate à travers l’emploi
de comparaisons telles que le “couvercle de la marmite”
comparé à “l’obus” (l.12) ou encore “la queue pareille à un
cordon” (l.15), représentant une explosion.
Cette violence est
renforcée par l’énumération, “le chat, tout efflanqué, sans poil,
la queue pareille à un cordon” (l.15).
Ce chat ne comble
néanmoins pas le manque d’éducation de ces deux enfants.
//
Or, Flaubert souligne l’échec de Bouvard et Pécuchet en tant
que pédagogues en leur donnant des surnoms ironiques tels
que “mon oncle” et “bon ami” (l.4-5) ou encore “bonshommes”
(l.20).
Ainsi, à travers un lexique péjoratif avec l’emploi de
termes tels que “tirait”, “moquer”, “abusait” (l.7-8), il explique et
décrit la difficulté de l’éducation d’un enfant.
Ces enfants, déjà
difficiles, sont également capricieux, l’auteur le souligne à
travers leur égoïsme en expliquant “cet argent leur appartenait”
(l.3), ce qui va complètement à l’encontre des souhaits des
adultes.
//
Tout au long du texte, il y a une longue opposition entre
l’intention éducative des adultes et le résultat.
Cette opposition
est marquée avec l’usage de la locution prépositive “afin de”
(l.1) marquant le but puis l’usage de la conjonction de
coordination “mais” (l.5) marquant la contradiction avec
l'élément qui précède.
Pareillement, elle est expliquée par
l’antithèse entre les “leçons” qui finissaient “en disputes” (l.5-6).
De la même manière, l’opposition entre les termes dits de
supériorité “bon ami” et “mon oncle” (l.4-5) et les enfants qui
“tutoyaient” (l.5) les pédagogues.
De plus, le lexique mélioratif
et éducatif “sensibles, [...] soigner [...] aumône” (l.1-2) s’oppose
au lexique de l’ingratitude “prétention injuste” (l.3).
Ces
oppositions montrent les différences dans les relations entre
chaque personnage.
//
//Il est vrai que Flaubert marque une supériorité entre les
adultes et les enfants à travers l’emploi comique....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Gustave FLAUBERT, Madame Bovary, (1857). Deuxième partie, chapitre 13. Commentaire
- Gustave Flaubert, Salammbô. Vous ferez de ce texte un commentaire composé ; vous pourrez par exemple étudier le caractère dramatique de la scène ainsi que son élargissement épique.
- Gustave Flaubert, Madame Bovary, II, 9. Commentaire
- Gustave Flaubert, Madame Bovary, le partie, chapitre 3 (Tête à tête amoureux)
- Commentaire composé d'un texte de Jules Vallès, extrait de l'enfant. Chapitre XIX. "Louisette"