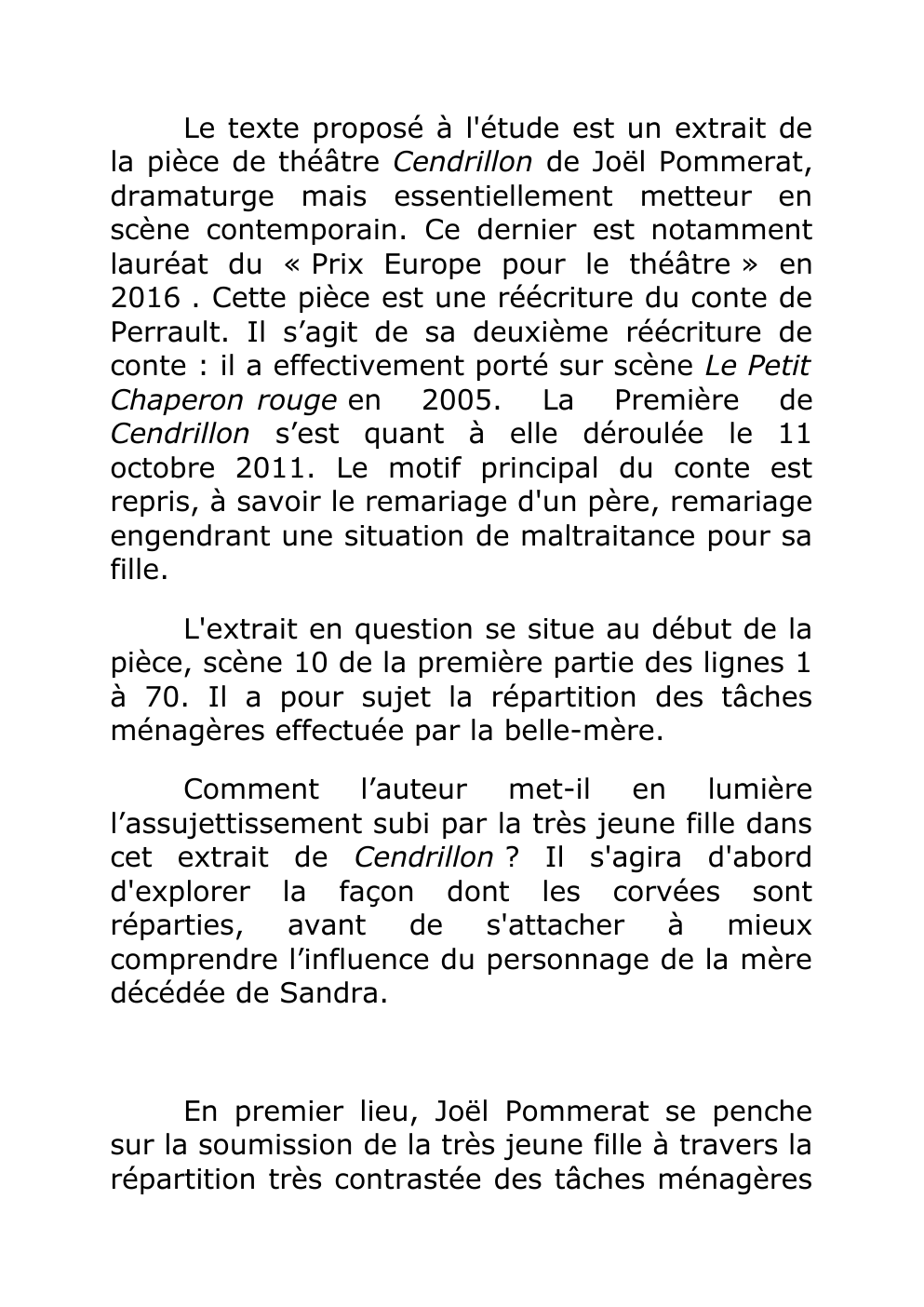Commentaire de le scène 10 de la première partie de la pièce Cendrillon de J.Pommerat
Publié le 30/04/2025
Extrait du document
«
Le texte proposé à l'étude est un extrait de
la pièce de théâtre Cendrillon de Joël Pommerat,
dramaturge mais essentiellement metteur en
scène contemporain.
Ce dernier est notamment
lauréat du « Prix Europe pour le théâtre » en
2016 .
Cette pièce est une réécriture du conte de
Perrault.
Il s’agit de sa deuxième réécriture de
conte : il a effectivement porté sur scène Le Petit
Chaperon rouge en 2005.
La Première de
Cendrillon s’est quant à elle déroulée le 11
octobre 2011.
Le motif principal du conte est
repris, à savoir le remariage d'un père, remariage
engendrant une situation de maltraitance pour sa
fille.
L'extrait en question se situe au début de la
pièce, scène 10 de la première partie des lignes 1
à 70.
Il a pour sujet la répartition des tâches
ménagères effectuée par la belle-mère.
Comment l’auteur met-il en lumière
l’assujettissement subi par la très jeune fille dans
cet extrait de Cendrillon ? Il s'agira d'abord
d'explorer la façon dont les corvées sont
réparties,
avant
de
s'attacher
à
mieux
comprendre l’influence du personnage de la mère
décédée de Sandra.
En premier lieu, Joël Pommerat se penche
sur la soumission de la très jeune fille à travers la
répartition très contrastée des tâches ménagères
effectuée par la belle-mère.
Dès la première
didascalie, l’indication « la très jeune fille a l’air
sombre » dévoile l’incommodité ressentie par
cette dernière : l’adjectif qualificatif « sombre »
montre qu’elle ne se sent pas à sa place au sein
de cette nouvelle famille, elle est morose.
La
belle-mère prend alors instantanément la parole,
elle comble déjà l’espace scénique par sa
présence et annonce : « depuis toujours, les
enfants aident aux tâches ménagères et
participent à des travaux simples de rangement
et de nettoyage ».
La locution adverbiale «
depuis toujours » indique qu’il s’agit d’une
évidence dans cette maison.
Cela va de soi et il
n’est même pas pensable de procéder d’une
façon différente.
Suite à cette intervention, les
deux soeurs paraissent étonnamment joyeuses,
ce qui est exprimé à travers les répliques
suivantes « absolument », « on aime bien ça »,
« super ! », correspondant respectivement à un
adverbe, une phrase déclarative et une phrase
exclamative.
Ainsi, elles font l’effort de faire
ressortir la bonne ambiance régnant dans cette
famille avant l’arrivée des nouveaux venus, ce
qu’elles justifient par cette entente à propos de
sujets susceptibles d’engendrer des conflits dans
tant d’autres foyers.
La belle-mère est par la
suite dans une position de domination.
Elle
décide effectivement seule du partage des
corvées : « J’ai réfléchi à une juste répartition
des tâches entre vous ».
Ici, l’utilisation du
pronom personnel « je » indique que c’est son
propre choix.
De surcroît, cela montre qu’elle ne
prendra pas en compte l’avis des autres
personnages car elle estime que son choix est
préférable et plus légitime.
Par la même
occasion, cette dernière insiste sur son désir de
parité concernant la répartition des corvées,
qu’elle promet alors « juste et équitable ».
Cette
idée est renforcée par l’emploi de l’adverbe
« évidemment » à maintes reprises : tout d’abord
utilisé deux fois par la belle-mère à sept mots de
différence seulement, il est repris ensuite par le
père qui confirme les paroles de sa compagne.
Ce
dernier témoigne ainsi son soutien à la bellemère, il est nécessaire pour lui de préserver leur
relation.
Cette lourde répétition démontre déjà
subtilement
que
ces
affirmations
sont
frauduleuses.
Effectivement, en cherchant à trop
vouloir rassurer son auditoire à propos des
paroles qui vont succéder, un sentiment de
méfiance peut-être éprouvé face à cette
déclaration à l’allure pourtant si anodine.
Il s’agit
donc a fortiori d’une provocation adressée à la
très jeune fille.
De fait, la décision de la bellemère est brutale : la répartition des tâches n’est
manifestement pas impartiale, elle avantage ses
filles.
En effet, « ranger votre linge propre dans
les tiroirs »,
« aidiez la femme de ménage
pendant qu’elle s’occupe de la cuisine », ces
paroles correspondant aux tâches destinées aux
deux soeurs sont à peine qualifiables de « tâches
ménagères ».
La réaction des deux soeurs est
particulièrement étonnante malgré cette faveur
considérable : en répondant « Ah bon? » (l.22)
elles ne cachent pas leur surprise.
Elles ne sont
pas satisfaites et s’attendaient à tout autre
chose.
Néanmoins, il s’agit certainement d’un
moyen très raffiné servant à irriter la très jeune
fille.
Les deux soeurs se doutent bien que les
corvées adressées à Sandra seront infiniment
plus ingrates que les leurs.
Réagir ainsi met en
évidence leur dérision et instaure alors une
certaine distance.
Cela est confirmé par la
répétition du « Ah bon? » (l.40), accompagné par
« C’est pas des tâches comme ça qu’on faisait
avant », une fois les besognes de Sandra
dévoilées.
L’autorité exercée par la belle-mère
refait alors surface : « Eh bien, on ne discute
pas » (L.47).
La négation indique ici que les deux
soeurs sont tout de même sous l’emprise de la
belle-mère, ce procédé les empêchant de
répondre ou de réagir.
Malgré leur révolte, elles
sont contraintes de céder.
En revanche, la
gradation concernant Sandra est d’un tout autre
niveau « tu pourrais aider la femme de ménage à
changer les poubelles des différents sanitaires,
salles de bains, buanderie, cuisine et aider à
porter tout ça ensuite dans le local à poubelles du
jardin », ces corvées qui nécessitent notamment
la
manipulation
de
détritus,
exposent
explicitement le dédain éprouvé envers Sandra.
La belle-mère s'évertue à humilier la très jeune
fille, à la déshumaniser, afin que son rang
atteigne un stade méprisable.
Cependant, un
effort de modération est notable, via notamment
l’emploi du conditionnel « tu pourrais », servant
ici
à
atténuer
ses
paroles.
Mais
la
condescendance ne s’arrête pas là : à travers son
interrogation « tu es d’accord?», la belle-mère
n’attend en réalité même pas de réponse, il s’agit
là d’un ordre dissimulé, reformulé.
Sandra n’a
pas le droit d’y voir d’objection.
Ce stratagème
permet en outre de duper le père, qui dénué
d’esprit critique du fait de sa soumission pourrait
y voir a contrario une marque de sollicitude.
Sandra réagit aux attaques de la belle-mère de
façon déconcertante : « Oui je suis d’accord ! Ah
oui c’est très bien ça ».
L’adverbe “très”
démontre qu’elle est d’une docilité stupéfiante,
elle est en accord avec tout ce que dit la belle
mère.
Il s’agit d’une démonstration claire de sa
servitude.
La très jeune fille ne ressent même
plus l’utilité de s’indigner face à son propre sort.
Elle accepte sa fatalité telle une stoïcienne en
partant du principe que tout espoir d’échapper à
son destin serait vain.
La didascalie révélant que
« la très jeune fille lève la main » renforce cette
hypothèse, il s’avère qu’elle considère sa bellemère comme une supérieure digne d’un grand
respect et juge utile de se faire approuver avant
d’user d’un droit qu’elle conserve pourtant : la
liberté de s’exprimer.
Cette attitude est absurde.
Dans un élan altruiste, elle accepte même les
tâches de ses deux demi soeurs « Si ça leur pose
un problème, je crois que je vais aimer ça ».
Ici,
elle se punit d’une transgression méconnue pour
satisfaire
des
sentiments
de
culpabilité
inconscients : « ça va me faire du bien de faire
ça ».
En
outre,
elle
développe
consciencieusement ce qu’il l’attend « nettoyer le
gras de la cuisinière, racler le gras du four […] la
graisse et le gras du four […] c’est vraiment
dégoûtant ».
Par l’usage de termes peu
valorisants tels que le nom commun « gras »,
elle accentue la répugnance associée à son
travail.
Elle a cependant une conscience lucide de
son infériorité.
Effectivement, elle demeure très
insolente envers son père : « Qu’est-ce que tu
racontes toi ? Je suis pas du tout gentille ! ».
Ici,
elle réfute les paroles de son père en utilisant
une phrase interrogative puis en employant une
négation « pas ».
Persécutée de tous les côtés,
Sandra ressent une inconsciente nécessité de
dominer tout de même une dernière personne :
ici son père, ce qui se traduit chez elle par un
manque
de
respect.
Cette
réaction
disproportionnée peut également signifier de sa
part une déception implicite quant à la réaction
de son père, qui demeurait pourtant le seul
personnage susceptible de la soutenir.
En effet,
les paroles du père : « Voilà très bien… c’est
gentil ! Ne t’inquiète pas, elle est simple et
gentille Sandra » sont assez audacieuses venant
d’un père, il se permet même d’employer
l’adjectif qualificatif « gentil » pour qualifier la
décision de sa femme.
Il ne veut surtout pas que
sa fille devienne un obstacle pour son couple et la
fait passer au second plan, ce qui la fait
naturellement exploser.
De plus, en rétorquant
par la suite « Tais-toi, s’il te plaît Sandra, arrête
de dire n’importe quoi », on constate également
une souffrance paternelle, il n’a pas d’autre issue
que de supplier sa fille, de l’implorer afin
d’obtenir son....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Lecture Linaire n*3 Introduction : Juste la fin du monde Deuxième partie scène 3 « tu es là »
- Commentaire de la scène de rencontre dans Le Lys dans la vallée
- commentaire composé electre acte II scène 9
- O.E.2: Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle / E.O.I. Juste la fin du monde (1990) de Jean-Luc LAGARCE ORAL LECTURE LINÉAIRE n°7, extrait de la Première partie, scène 8 – LA MÈRE
- Plan détaillé du commentaire acte II scène 4 de Lucrèce Borgia