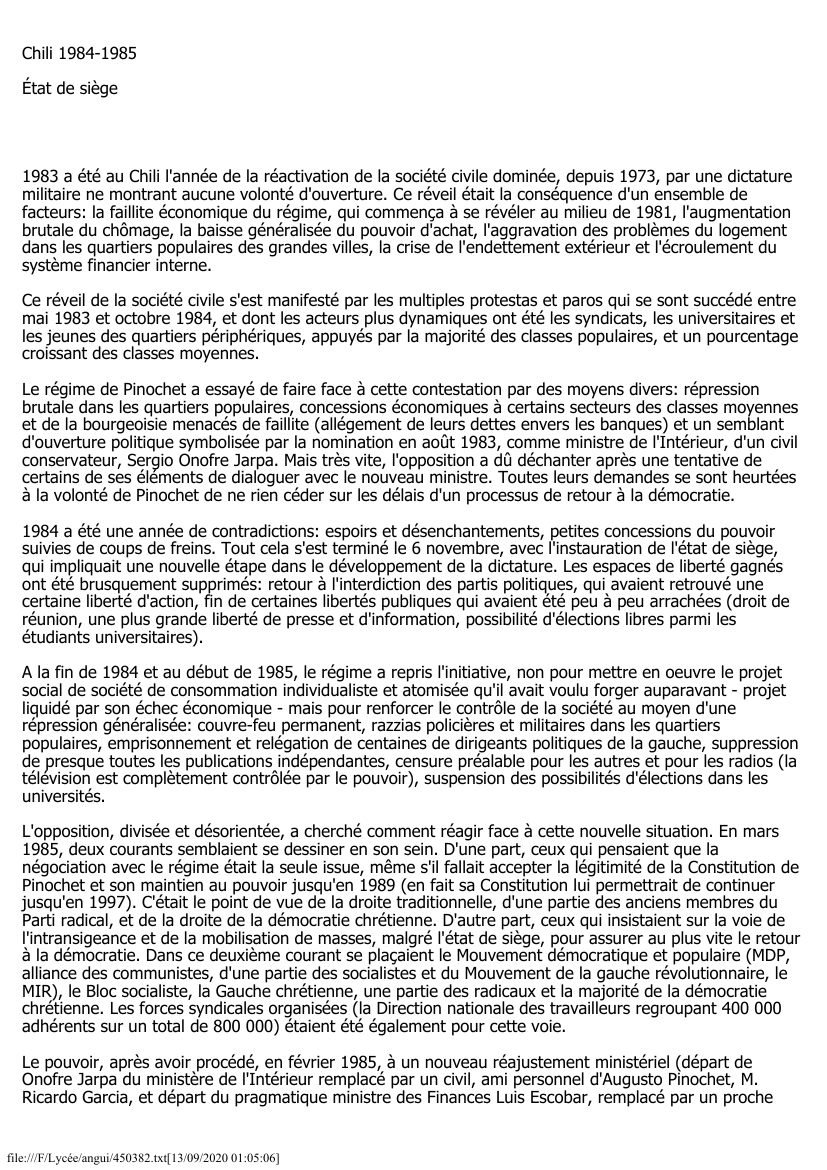Chili: 1984-1985 État de siège
Publié le 13/09/2020

Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Chili: 1984-1985 État de siège. Ce document contient 743 mots soit 2 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format PDF sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en: Histoire-géographie.
«
file:///F/Lycée/angui/450382.txt[13/09/2020 01:05:06]
Chili 1984-1985
État de siège
1983 a été au Chili l'année de la réactivation de la socié
té civile dominée, depuis 1973, par une dictature
militaire ne montrant aucune volonté d'ouverture.
Ce réveil éta
it la conséquence d'un ensemble de
facteurs: la faillite économique du régime, qui commença à s
e révéler au milieu de 1981, l'augmentation
brutale du chômage, la baisse généralisée du pouvoir d'achat
, l'aggravation des problèmes du logement
dans les quartiers populaires des grandes villes, la crise de l'endettem
ent extérieur et l'écroulement du
système financier interne.
Ce réveil de la société civile s'est manifesté par les multi
ples protestas et paros qui se sont succédé entre
mai 1983 et octobre 1984, et dont les acteurs plus dynamiques ont été
les syndicats, les universitaires et
les jeunes des quartiers périphériques, appuyés par la majorité
des classes populaires, et un pourcentage
croissant des classes moyennes.
Le régime de Pinochet a essayé de faire face à cette contestati
on par des moyens divers: répression
brutale dans les quartiers populaires, concessions économiques à c
ertains secteurs des classes moyennes
et de la bourgeoisie menacés de faillite (allégement de leurs det
tes envers les banques) et un semblant
d'ouverture politique symbolisée par la nomination en août 1983, c
omme ministre de l'Intérieur, d'un civil
conservateur, Sergio Onofre Jarpa.
Mais très vite, l'opposition a dû
déchanter après une tentative de
certains de ses éléments de dialoguer avec le nouveau ministre.
To
utes leurs demandes se sont heurtées
à la volonté de Pinochet de ne rien céder sur les délais d'u
n processus de retour à la démocratie.
1984 a été une année de contradictions: espoirs et désenchan
tements, petites concessions du pouvoir
suivies de coups de freins.
Tout cela s'est terminé le 6 novembre, av
ec l'instauration de l'état de siège,
qui impliquait une nouvelle étape dans le développement de la dict
ature.
Les espaces de liberté gagnés
ont été brusquement supprimés: retour à l'interdiction des p
artis politiques, qui avaient retrouvé une
certaine liberté d'action, fin de certaines libertés publiques qui
avaient été peu à peu arrachées (droit de
réunion, une plus grande liberté de presse et d'information, possi
bilité d'élections libres parmi les
étudiants universitaires).
A la fin de 1984 et au début de 1985, le régime a repris l'initiat
ive, non pour mettre en oeuvre le projet
social de société de consommation individualiste et atomisée qu
'il avait voulu forger auparavant - projet
liquidé par son échec économique - mais pour renforcer le contr
ôle de la société au moyen d'une
répression généralisée: couvre-feu permanent, razzias polici
ères et militaires dans les quartiers
populaires, emprisonnement et relégation de centaines de dirigeants p
olitiques de la gauche, suppression
de presque toutes les publications indépendantes, censure préalabl
e pour les autres et pour les radios (la
télévision est complètement contrôlée par le pouvoir), s
uspension des possibilités d'élections dans les
universités.
L'opposition, divisée et désorientée, a cherché comment ré
agir face à cette nouvelle situation.
En mars
1985, deux courants semblaient se dessiner en son sein.
D'une part, ceux
qui pensaient que la
négociation avec le régime était la seule issue, même s'il f
allait accepter la légitimité de la Constitution de
Pinochet et son maintien au pouvoir jusqu'en 1989 (en fait sa Constitut
ion lui permettrait de continuer
jusqu'en 1997).
C'était le point de vue de la droite traditionnelle,
d'une partie des anciens membres du
Parti radical, et de la droite de la démocratie chrétienne.
D'autr
e part, ceux qui insistaient sur la voie de
l'intransigeance et de la mobilisation de masses, malgré l'état de
siège, pour assurer au plus vite le retour
à la démocratie.
Dans ce deuxième courant se plaçaient le Mo
uvement démocratique et populaire (MDP,
alliance des communistes, d'une partie des socialistes et du Mouvement d
e la gauche révolutionnaire, le
MIR), le Bloc socialiste, la Gauche chrétienne, une partie des radic
aux et la majorité de la démocratie
chrétienne.
Les forces syndicales organisées (la Direction nation
ale des travailleurs regroupant 400 000
adhérents sur un total de 800 000) étaient été également
pour cette voie.
Le pouvoir, après avoir procédé, en février 1985, à un no
uveau réajustement ministériel (départ de
Onofre Jarpa du ministère de l'Intérieur remplacé par un civil,
ami personnel d'Augusto Pinochet, M.
Ricardo Garcia, et départ du pragmatique ministre des Finances Luis E
scobar, remplacé par un proche.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓