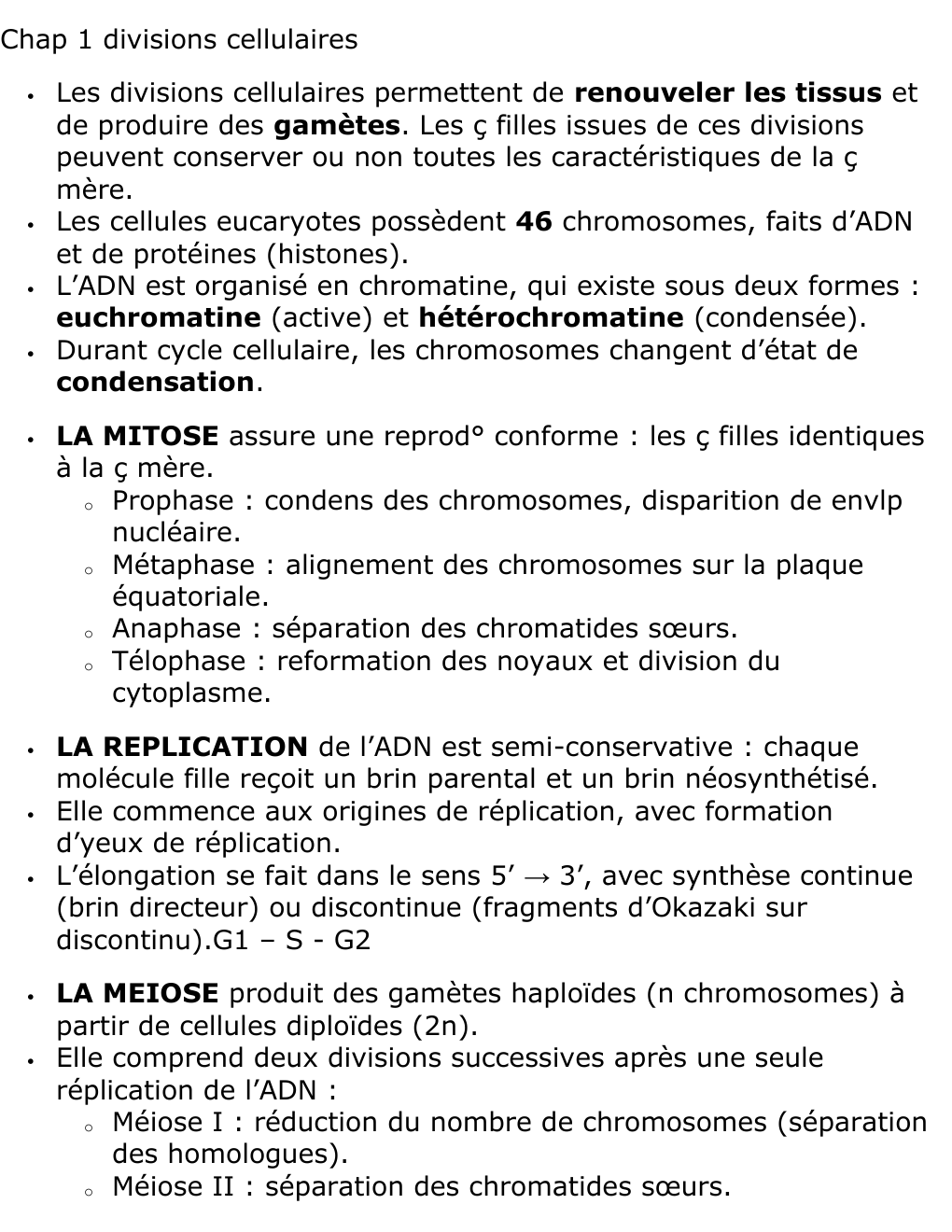Chapitre SVT première Chap 1 divisions cellulaires
Publié le 09/06/2025
Extrait du document
«
Chap 1 divisions cellulaires
Les divisions cellulaires permettent de renouveler les tissus et
de produire des gamètes.
Les ç filles issues de ces divisions
peuvent conserver ou non toutes les caractéristiques de la ç
mère.
Les cellules eucaryotes possèdent 46 chromosomes, faits d’ADN
et de protéines (histones).
L’ADN est organisé en chromatine, qui existe sous deux formes :
euchromatine (active) et hétérochromatine (condensée).
Durant cycle cellulaire, les chromosomes changent d’état de
condensation.
LA MITOSE assure une reprod° conforme : les ç filles identiques
à la ç mère.
o Prophase : condens des chromosomes, disparition de envlp
nucléaire.
o Métaphase : alignement des chromosomes sur la plaque
équatoriale.
o Anaphase : séparation des chromatides sœurs.
o Télophase : reformation des noyaux et division du
cytoplasme.
LA REPLICATION de l’ADN est semi-conservative : chaque
molécule fille reçoit un brin parental et un brin néosynthétisé.
Elle commence aux origines de réplication, avec formation
d’yeux de réplication.
L’élongation se fait dans le sens 5’ → 3’, avec synthèse continue
(brin directeur) ou discontinue (fragments d’Okazaki sur
discontinu).G1 – S - G2
LA MEIOSE produit des gamètes haploïdes (n chromosomes) à
partir de cellules diploïdes (2n).
Elle comprend deux divisions successives après une seule
réplication de l’ADN :
o Méiose I : réduction du nombre de chromosomes (séparation
des homologues).
o Méiose II : séparation des chromatides sœurs.
Résultat : 4 cellules haploïdes génétiquement différentes.
LES ERREURS DE REPLICATION ou des dommages à l’ADN
(causés par les ROS, UV, etc.) peuvent entraîner des mutations.
Plusieurs systèmes de réparation existent : photoréactivation
(casser liaisons anormales) BER (retraits de base), NER (excision
de nucléotides).
Si la réparation échoue, une mutation peut survenir (addition,
substitution ou délétion de nucléotides)
Chap 2 : variabilité génétique et santé (cancer et résistance)
I.LES PERTURBATIONS DU GENOME ET L’APPARITION DES CANCERS
Le cancer est une maladie liée à des dérèglements du génome
cellulaire, provoquant une division cellulaire anarchique et la perte du
contrôle collectif des cellules.
Les cellules cancéreuses se caractérisent
par une perte de différenciation, une multiplication rapide et des
anomalies de mitose.
Elles peuvent former des tumeurs malignes et
des métastases en perdant leur adhérence et en migrant dans
l’organisme.
La cancérisation se déroule en plusieurs étapes : mutation d’une cellule
initiatrice, formation d’un clone cellulaire immortel, stimulation de
l’angiogénèse (création de nouveaux vaisseaux sanguins), puis
dissémination des cellules (métastases).
Deux grandes catégories de gènes contrôlent le rythme des divisions
cellulaires :
o Proto oncogènes : stimulent la division cellulaire ; une mutation peut
les transformer en oncogèneshyperactifs, favorisant le cancer (ex :
gène RAS).
o Gènes suppresseurs de tumeurs (ex : p53) : inhibent la division
cellulaire ou déclenchent l’apoptose (mort cellulaire programmée).
Leur inactivation favorise la cancérisation.
Les facteurs à l’origine des cancers sont multiples :
o Modifications épigénétiques (méthylation, acétylation des histones)
qui modifient l’expression des gènes sans changer la séquence d’ADN
par des facteurs de l’environnement.
o Agents chimiques (ex : benzopyrène de la fumée de cigarette),
physiques (radiations), ou viraux (HPV 16 et 18 : E6 détruit P53)
o Facteurs de risque : comportements (tabac, alcool, alimentation),
environnement (pollution, infections), individuels (âge, hérédité,
maladies).
II.
VARIATION GENETIQUE BACTERIENNE ET RESISTANCE AUX
ANTIBIOTIQUES
Paroi bactérienne : composée de peptidoglycane (synthétise par PLP et
dégrade par autosyline).
Certaines bactéries sont pathogènes et peuvent
être combattues par des antibiotiques (des molécules naturelles
fabriquées par d’autres bactéries, micro-organisme ou champignons,
capable de détruire des bactéries) qui ciblent spécifiquement la paroi, la
membrane, l’ADN ou les ribosomes bactériens.
La résistance bactérienne aux antibiotiques est due à :
o Mutations spontanées transmise à la descendance = résistance
naturelle
o Transfert de gènes entre bactéries = résistance acquise
L’utilisation excessive d’antibiotiques favorise la sélection de bactéries
multi-résistantes : BMR et BHRe
Deviennent résistantes en : produisant enzymes neutralisantes, devenant
imperméables, modifiant leur cible, favorisant l’efflux actif
Chap 3 : expression patrimoine génétique
1- INFO GÉNÉTIQUE ET SON EXPRESSION
ADN et gènes : L’ADN contient l’information génétique universelle.
Un
gène est une séquence d’ADN qui code une molécule fonctionnelle,
généralement une protéine.
Génome humain : Il comprend environ 25 000 gènes.
2 - DE L’ADN A LA PROTEINE : TRANSCRIPTION ET TRADUCTION
TRANSCRIPTION (noyau) Processus : L’ADN sert de modèle pour la
synthèse d’un ARN (une seule chaîne linéaire avec 4 structures
différentes : acides ribonucléiques).
3 Étapes : Initiation ARN polymérase se fixe sur le promoteur du
gène/Élongation ARNm est synthétisé par complémentarité avec un brin
d’ADN/Terminaison ARNm est libéré
Maturation de l’ARNm (chez les eucaryotes) : Ajout d’une coiffe et d’une
queue polyA.
Épissage constitutif : élimination introns, conservation tt
les exons.
OU alternatif : différentes combinaisons d’exons = 1 gène
peut produire plusieurs ARNm donc prot
TRADUCTION (cyto) Code génétique : Universel, il permet de traduire
l’ARNm en séquences d’AA (protéines) grâce à des codons (triplets de
bases).
Ribosomes et ARNt : ribosomes lisent ARNm et ARNt les lient aux AA
correspondants.
Étapes : Initiation : Assemblage du ribosome sur l’ARNm/Élongation :
Formation de la chaîne peptidique/Terminaison : Libération de la protéine
au codon stop.
3 – PHENOTYPE : Ensemble des caractères observables d’un individu, à
différentes échelles (moléculaire, cellulaire, macroscopique).
Lien génophéno : Les protéines issues de l’expression des gènes déterminent les
caracté cellul.
& macroscopiques.
Expression différentielle des gènes : Selon le type cellulaire ou les
signaux reçus, seules certaines portions du génome sont exprimées.
Régulation soit sur séquences régulatrices ou sur chromatine (modif
comme acetyl ou methyl impacte accessibilité des gènes) - Facteurs
environnementaux : hydrophobes / protéiques / physiques
Enviro module proteosynthese donc epigenetique (chgmt activité gènes
pas ADN)
4 – SANTÉ, MUTA : modif de la séquence d’ADN, pouvant affecter la
structure et la fonction des protéines = maladies génétiques ou modifier
le phénotype.
Ex : mucoviscidose (insuffisance respiratoire, pb
digestif/reproduct°), mono génique : mutation gène CTFR (c7,27exons,
1480AA), souvent mutation DF 508.
Prot CTFR : transport ions chlorures,
mutée : mucus épais visqueux, maladie autosomique récessive fréquente
Dépistage néonatal systématique (3j naissance) et test sueur (quantité
chlore)
Traitements : kinésithérapie respiratoire, aérosols fluidifier mucus, greffe,
thérapie ç
DT2 (+35ans) : maladie (95%) polygénique = plusieurs gènes de
prédisposition et facteurs envi : alimentation riche, vie sédentaire, DT2
souvent accompagné de surpoid
Caractérisé par mauvaise régulat° concentrat° sanguine glucose +
résistance insuline
C 4 – Les enzymes, catalyseurs indis à la vie c I.
LES ENZYMES, DES
BIOCATALYSEURS
Enzymes = prot qui accélèrent les réacs chimiques du méta ç sans
être modifiées à la fin de la réaction, abaissent l’énergie d’activation
nécessaire pour instabilité et déformation de la molécule pour se
transformer soit la reac chim, substrat = réactif
Deux types de catalyseurs existent : chimiques et biologiques
(enzymes).
II.
CARACTERISTIQUES DE LA CATALYSE ENZYMATIQUE
Spécificité grâce a forme tridimensionnelle : SUBSTRAT = chaque
enzyme agit sur un seul type de molécule, D’ACTION : chq enzyme
ne réalise qu’un seul type de réaction.
L’action enzymatique se fait en 2 étapes : formation d’un complexe
enzyme-substrat, puis transformation du substrat en produit.
Le site actif de l’enzyme (site de fixation : partie enz + site
catalytique : partie substrat) assure la reconnaissance et la
transformation du substrat, complémentarité ES
III.
CONDITIONS D’ACTION DES ENZYMES
Cinétique = vitesse catalyse en fonction t, pente = vi
La vitesse d’une réaction enzymatique dépend de plusieurs facteurs :
o Concentrat° en substrat : + substrat, + réaction est rapide
jusqu’à un max
o Concentrat° en enzyme : + il y a d’enzyme, + réaction est
rapide.
o pH : chq enzyme a un pH optimal (gamme limité) ; en dehors
son activité diminue.
o Température : chaque enzyme a un optimum thermique d’action
; a partir d’une certaine température son activité diminue
IV.
STRUCTURE DES ENZYMES ET SPECIALISATION CELLULAIRE
Les enzymes sont des protéines dont l’activité dépend de leur
structure tridimensionnelle (structure primaire = orga AA, secondaire
= forme soit hélice coude…, tertiaire = orga spatiale / repliements,
quaternaire = orga sous unités).
Toute modif (température, pH, ions) peut altérer la forme de
l’enzyme, son efficacité.
Chaque cellule....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Chapitre 1: Les divisions cellulaires des eucaryotes
- SVT Chapitre 8 ==> Reproduction de la fleur entre vie fixée et mobilité
- Cours SVT 1ere chapitre 2 thème 2: Chapitre 2 th2 : Le bilan radiatif terrestre
- svt cours - Chapitre 2 : La dynamique de la lithosphère
- (Séance SVT Chapitre 2 du Thème 1 : La matière organisée en cristaux