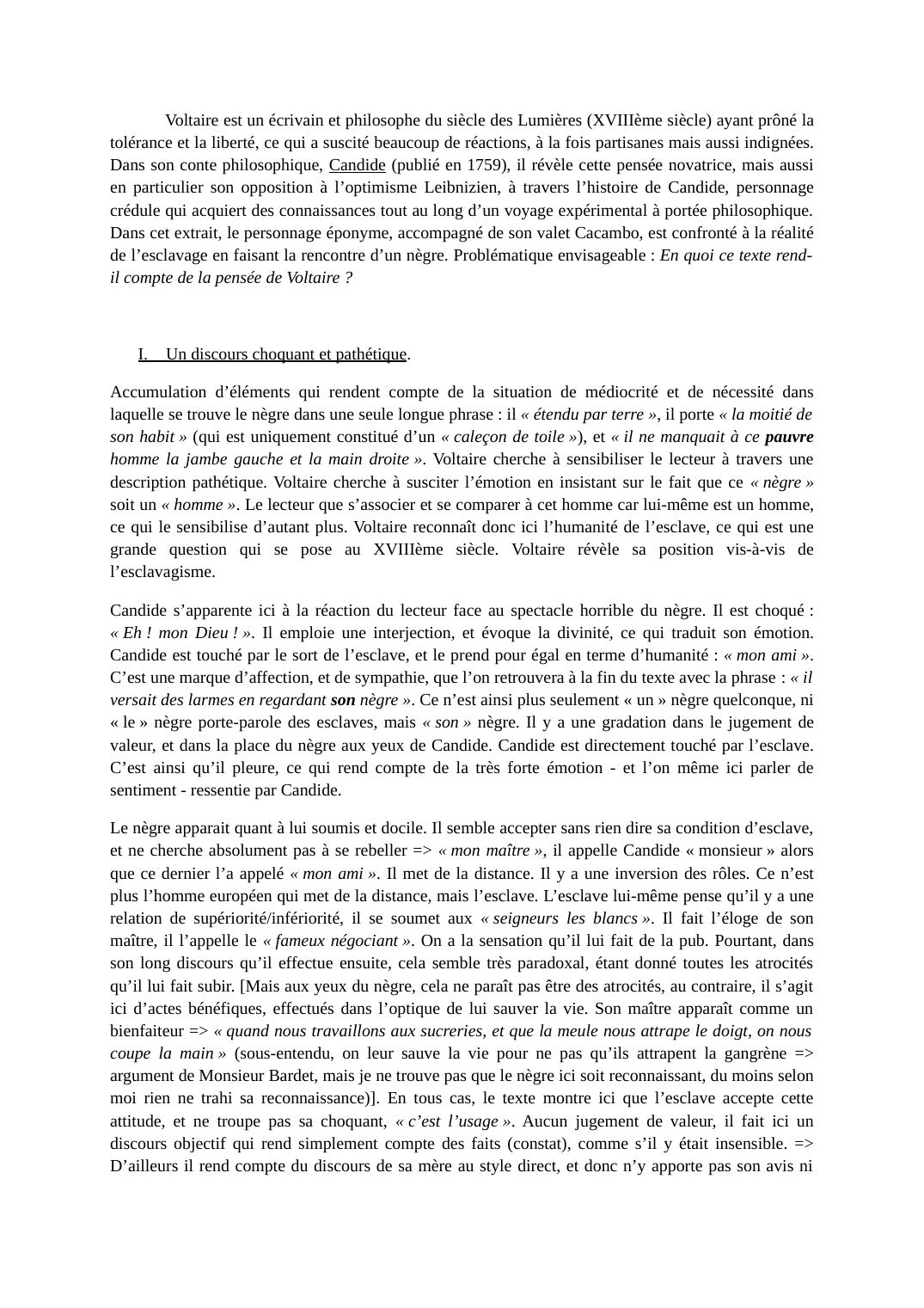Candide
Publié le 17/05/2020

Extrait du document
«
Voltaire est un écrivain et philosophe du siècle des Lumières (XVIIIème siècle) ayant prôné la
tolérance et la liberté, ce qui a suscité beaucoup de réactions, à la fois partisanes mais aussi indignées.
Dans son conte philosophique, Candide (publié en 1759), il révèle cette pensée novatrice, mais aussi
en particulier son opposition à l’optimisme Leibnizien, à travers l’histoire de Candide, personnage
crédule qui acquiert des connaissances tout au long d’un voyage expérimental à portée philosophique.
Dans cet extrait, le personnage éponyme, accompagné de son valet Cacambo, est confronté à la réalité
de l’esclavage en faisant la rencontre d’un nègre.
Problématique envisageable : En quoi ce texte rend-
il compte de la pensée de Voltaire ?
I.
Un discours choquant et pathétique .
Accumulation d’éléments qui rendent compte de la situation de médiocrité et de nécessité dans
laquelle se trouve le nègre dans une seule longue phrase : il « étendu par terre » , il porte « la moitié de
son habit » (qui est uniquement constitué d’un « caleçon de toile » ), et « il ne manquait à ce pauvre
homme la jambe gauche et la main droite » .
Voltaire cherche à sensibiliser le lecteur à travers une
description pathétique.
Voltaire cherche à susciter l’émotion en insistant sur le fait que ce « nègre »
soit un « homme » .
Le lecteur que s’associer et se comparer à cet homme car lui-même est un homme,
ce qui le sensibilise d’autant plus.
Voltaire reconnaît donc ici l’humanité de l’esclave, ce qui est une
grande question qui se pose au XVIIIème siècle.
Voltaire révèle sa position vis-à-vis de
l’esclavagisme.
Candide s’apparente ici à la réaction du lecteur face au spectacle horrible du nègre.
Il est choqué :
« Eh ! mon Dieu ! » .
Il emploie une interjection, et évoque la divinité, ce qui traduit son émotion.
Candide est touché par le sort de l’esclave, et le prend pour égal en terme d’humanité : « mon ami » .
C’est une marque d’affection, et de sympathie, que l’on retrouvera à la fin du texte avec la phrase : « il
versait des larmes en regardant son nègre » .
Ce n’est ainsi plus seulement « un » nègre quelconque, ni
« le » nègre porte-parole des esclaves, mais « son » nègre.
Il y a une gradation dans le jugement de
valeur, et dans la place du nègre aux yeux de Candide.
Candide est directement touché par l’esclave.
C’est ainsi qu’il pleure, ce qui rend compte de la très forte émotion - et l’on même ici parler de
sentiment - ressentie par Candide.
Le nègre apparait quant à lui soumis et docile.
Il semble accepter sans rien dire sa condition d’esclave,
et ne cherche absolument pas à se rebeller => « mon maître » , il appelle Candide « monsieur » alors
que ce dernier l’a appelé « mon ami » .
Il met de la distance.
Il y a une inversion des rôles.
Ce n’est
plus l’homme européen qui met de la distance, mais l’esclave.
L’esclave lui-même pense qu’il y a une
relation de supériorité/infériorité, il se soumet aux « seigneurs les blancs » .
Il fait l’éloge de son
maître, il l’appelle le « fameux négociant » .
On a la sensation qu’il lui fait de la pub.
Pourtant, dans
son long discours qu’il effectue ensuite, cela semble très paradoxal, étant donné toutes les atrocités
qu’il lui fait subir.
[Mais aux yeux du nègre, cela ne paraît pas être des atrocités, au contraire, il s’agit
ici d’actes bénéfiques, effectués dans l’optique de lui sauver la vie.
Son maître apparaît comme un
bienfaiteur => « quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on nous
coupe la main » (sous-entendu, on leur sauve la vie pour ne pas qu’ils attrapent la gangrène =>
argument de Monsieur Bardet, mais je ne trouve pas que le nègre ici soit reconnaissant, du moins selon
moi rien ne trahi sa reconnaissance)].
En tous cas, le texte montre ici que l’esclave accepte cette
attitude, et ne troupe pas sa choquant, « c’est l’usage » .
Aucun jugement de valeur, il fait ici un
discours objectif qui rend simplement compte des faits (constat), comme s’il y était insensible.
=>
D’ailleurs il rend compte du discours de sa mère au style direct, et donc n’y apporte pas son avis ni.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Lecture linéaire Candide - Candide – chapitre 3
- lecture linéaire candide ou l'optimisme: l’idée du philosophe allemand Leibniz, selon laquelle tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible
- Fiche de lecture: Voltaire - Candide
- Lecture Cursive Candide
- Résumé Candide