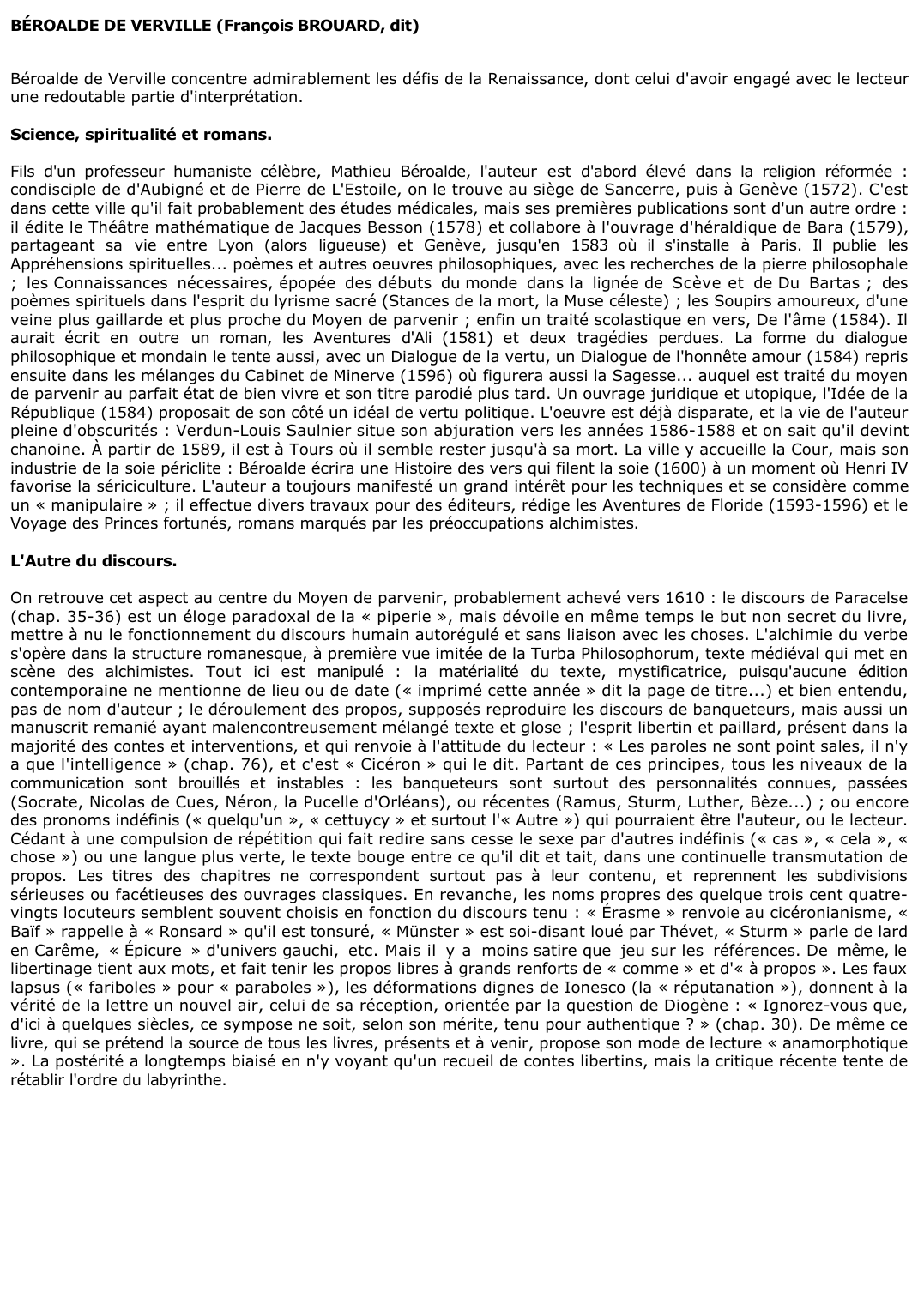BÉROALDE DE VERVILLE (François BROUARD, dit)
Publié le 09/12/2021

Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : BÉROALDE DE VERVILLE (François BROUARD, dit). Ce document contient 0 mots. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système d’échange gratuit de ressources numériques ou achetez-le pour la modique somme d’un euro symbolique. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en : Littérature
Béroalde de Verville concentre admirablement les défis de la Renaissance, dont celui d'avoir engagé avec le lecteur une redoutable partie d'interprétation. Science, spiritualité et romans. Fils d'un professeur humaniste célèbre, Mathieu Béroalde, l'auteur est d'abord élevé dans la religion réformée : condisciple de d'Aubigné et de Pierre de L'Estoile, on le trouve au siège de Sancerre, puis à Genève (1572). C'est dans cette ville qu'il fait probablement des études médicales, mais ses premières publications sont d'un autre ordre : il édite le Théâtre mathématique de Jacques Besson (1578) et collabore à l'ouvrage d'héraldique de Bara (1579), partageant sa vie entre Lyon (alors ligueuse) et Genève, jusqu'en 1583 où il s'installe à Paris. Il publie les Appréhensions spirituelles... poèmes et autres oeuvres philosophiques, avec les recherches de la pierre philosophale ; les Connaissances nécessaires, épopée des débuts du monde dans la lignée de Scève et de Du Bartas ; des poèmes spirituels dans l'esprit du lyrisme sacré (Stances de la mort, la Muse céleste) ; les Soupirs amoureux, d'une veine plus gaillarde et plus proche du Moyen de parvenir ; enfin un traité scolastique en vers, De l'âme (1584). Il aurait écrit en outre un roman, les Aventures d'Ali (1581) et deux tragédies perdues. La forme du dialogue philosophique et mondain le tente aussi, avec un Dialogue de la vertu, un Dialogue de l'honnête amour (1584) repris ensuite dans les mélanges du Cabinet de Minerve (1596) où figurera aussi la Sagesse... auquel est traité du moyen de parvenir au parfait état de bien vivre et son titre parodié plus tard. Un ouvrage juridique et utopique, l'Idée de la République (1584) proposait de son côté un idéal de vertu politique. L'oeuvre est déjà disparate, et la vie de l'auteur pleine d'obscurités : Verdun-Louis Saulnier situe son abjuration vers les années 1586-1588 et on sait qu'il devint chanoine. À partir de 1589, il est à Tours où il semble rester jusqu'à sa mort. La ville y accueille la Cour, mais son industrie de la soie périclite : Béroalde écrira une Histoire des vers qui filent la soie (1600) à un moment où Henri IV favorise la sériciculture. L'auteur a toujours manifesté un grand intérêt pour les techniques et se considère comme un « manipulaire » ; il effectue divers travaux pour des éditeurs, rédige les Aventures de Floride (1593-1596) et le Voyage des Princes fortunés, romans marqués par les préoccupations alchimistes.
Béroalde de Verville concentre admirablement les défis de la Renaissance, dont celui d'avoir engagé avec le lecteur une redoutable partie d'interprétation. Science, spiritualité et romans. Fils d'un professeur humaniste célèbre, Mathieu Béroalde, l'auteur est d'abord élevé dans la religion réformée : condisciple de d'Aubigné et de Pierre de L'Estoile, on le trouve au siège de Sancerre, puis à Genève (1572). C'est dans cette ville qu'il fait probablement des études médicales, mais ses premières publications sont d'un autre ordre : il édite le Théâtre mathématique de Jacques Besson (1578) et collabore à l'ouvrage d'héraldique de Bara (1579), partageant sa vie entre Lyon (alors ligueuse) et Genève, jusqu'en 1583 où il s'installe à Paris. Il publie les Appréhensions spirituelles... poèmes et autres oeuvres philosophiques, avec les recherches de la pierre philosophale ; les Connaissances nécessaires, épopée des débuts du monde dans la lignée de Scève et de Du Bartas ; des poèmes spirituels dans l'esprit du lyrisme sacré (Stances de la mort, la Muse céleste) ; les Soupirs amoureux, d'une veine plus gaillarde et plus proche du Moyen de parvenir ; enfin un traité scolastique en vers, De l'âme (1584). Il aurait écrit en outre un roman, les Aventures d'Ali (1581) et deux tragédies perdues. La forme du dialogue philosophique et mondain le tente aussi, avec un Dialogue de la vertu, un Dialogue de l'honnête amour (1584) repris ensuite dans les mélanges du Cabinet de Minerve (1596) où figurera aussi la Sagesse... auquel est traité du moyen de parvenir au parfait état de bien vivre et son titre parodié plus tard. Un ouvrage juridique et utopique, l'Idée de la République (1584) proposait de son côté un idéal de vertu politique. L'oeuvre est déjà disparate, et la vie de l'auteur pleine d'obscurités : Verdun-Louis Saulnier situe son abjuration vers les années 1586-1588 et on sait qu'il devint chanoine. À partir de 1589, il est à Tours où il semble rester jusqu'à sa mort. La ville y accueille la Cour, mais son industrie de la soie périclite : Béroalde écrira une Histoire des vers qui filent la soie (1600) à un moment où Henri IV favorise la sériciculture. L'auteur a toujours manifesté un grand intérêt pour les techniques et se considère comme un « manipulaire » ; il effectue divers travaux pour des éditeurs, rédige les Aventures de Floride (1593-1596) et le Voyage des Princes fortunés, romans marqués par les préoccupations alchimistes.
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- grand oral: Sondages d’opinions et vérités des urnes en France sous la présidence de François Hollande
- C.E. 2 nov. 1973, SOCIÉTÉ ANONYME « LIBRAIRIE FRANÇOIS MASPERO », Rec. 611
- Dans quelle mesure la Juste la fin du monde consiste-t-elle, comme le dit François BERREUR, en« un équilibre de tensions»
- Corrigé commentaire Hobbes: Léviathan, chapitre XIII, Trad. François Tricaud, Sirey (© Dalloz), 1971, pp. 126-127.
- François Mauriac écrit dans Commencements d'une vie (1932) : « Est-ce à dire que les souvenirs d'un auteur nous égarent toujours sur son compte ? Bien loin de là : le tout est de savoir les lire. C'est ce qui y transparaît de lui-même malgré lui qui nous éclaire sur un écrivain. Les véritables visages de Rousseau, de Chateaubriand, de Gide se dessinent peu à peu dans le filigrane de leurs confessions et histoires. » Vous direz dans quelle mesure, selon vous, ce propos de François Mauri