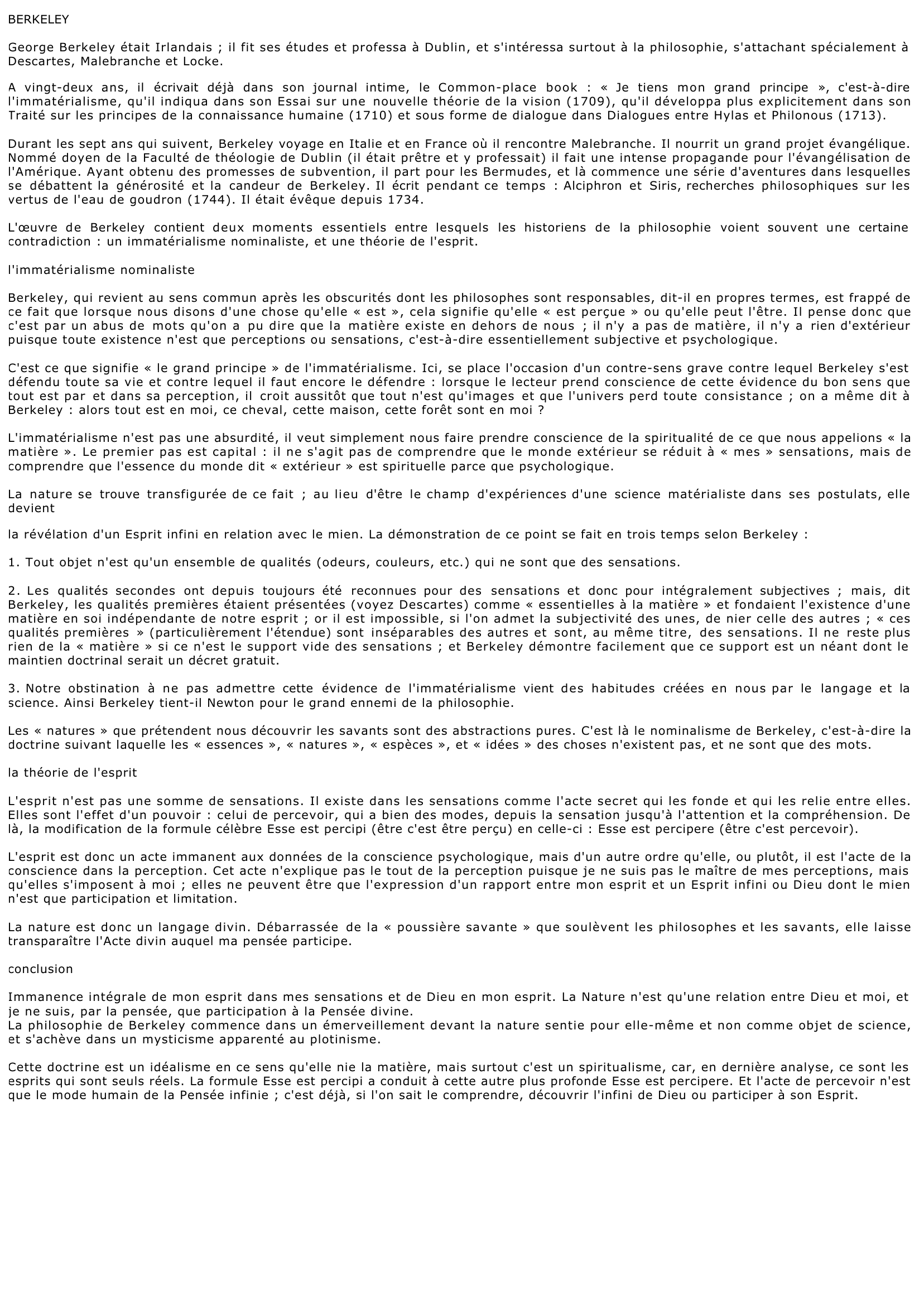BERKELEY
Publié le 15/05/2020

Extrait du document
«
BERKELEY
George Berkeley était Irlandais ; il fit ses études et professa à Dublin, et s'intéressa surtout à la philosophie, s'attachant spécialement àDescartes, Malebranche et Locke.
A vingt-deux ans, il écrivait déjà dans son journal intime, le Common-place book : « Je tiens mon grand principe », c'est-à-direl'immatérialisme, qu'il indiqua dans son Essai sur une nouvelle théorie de la vision (1709), qu'il développa plus explicitement dans sonTraité sur les principes de la connaissance humaine (1710) et sous forme de dialogue dans Dialogues entre Hylas et Philonous (1713).
Durant les sept ans qui suivent, Berkeley voyage en Italie et en France où il rencontre Malebranche.
Il nourrit un grand projet évangélique.Nommé doyen de la Faculté de théologie de Dublin (il était prêtre et y professait) il fait une intense propagande pour l'évangélisation del'Amérique.
Ayant obtenu des promesses de subvention, il part pour les Bermudes, et là commence une série d'aventures dans lesquellesse débattent la générosité et la candeur de Berkeley.
Il écrit pendant ce temps : Alciphron et Siris, recherches philosophiques sur lesvertus de l'eau de goudron (1744).
Il était évêque depuis 1734.
L'œuvre de Berkeley contient deux moments essentiels entre lesquels les historiens de la philosophie voient souvent une certainecontradiction : un immatérialisme nominaliste, et une théorie de l'esprit.
l'immatérialisme nominaliste
Berkeley, qui revient au sens commun après les obscurités dont les philosophes sont responsables, dit-il en propres termes, est frappé dece fait que lorsque nous disons d'une chose qu'elle « est », cela signifie qu'elle « est perçue » ou qu'elle peut l'être.
Il pense donc quec'est par un abus de mots qu'on a pu dire que la matière existe en dehors de nous ; il n'y a pas de matière, il n'y a rien d'extérieurpuisque toute existence n'est que perceptions ou sensations, c'est-à-dire essentiellement subjective et psychologique.
C'est ce que signifie « le grand principe » de l'immatérialisme.
Ici, se place l'occasion d'un contre-sens grave contre lequel Berkeley s'estdéfendu toute sa vie et contre lequel il faut encore le défendre : lorsque le lecteur prend conscience de cette évidence du bon sens quetout est par et dans sa perception, il croit aussitôt que tout n'est qu'images et que l'univers perd toute consistance ; on a même dit àBerkeley : alors tout est en moi, ce cheval, cette maison, cette forêt sont en moi ?
L'immatérialisme n'est pas une absurdité, il veut simplement nous faire prendre conscience de la spiritualité de ce que nous appelions « lamatière ».
Le premier pas est capital : il ne s'agit pas de comprendre que le monde extérieur se réduit à « mes » sensations, mais decomprendre que l'essence du monde dit « extérieur » est spirituelle parce que psychologique.
La nature se trouve transfigurée de ce fait ; au lieu d'être le champ d'expériences d'une science matérialiste dans ses postulats, elledevient
la révélation d'un Esprit infini en relation avec le mien.
La démonstration de ce point se fait en trois temps selon Berkeley :
1.
Tout objet n'est qu'un ensemble de qualités (odeurs, couleurs, etc.) qui ne sont que des sensations.
2.
Les qualités secondes ont depuis toujours été reconnues pour des sensations et donc pour intégralement subjectives ; mais, ditBerkeley, les qualités premières étaient présentées (voyez Descartes) comme « essentielles à la matière » et fondaient l'existence d'unematière en soi indépendante de notre esprit ; or il est impossible, si l'on admet la subjectivité des unes, de nier celle des autres ; « cesqualités premières » (particulièrement l'étendue) sont inséparables des autres et sont, au même titre, des sensations.
Il ne reste plusrien de la « matière » si ce n'est le support vide des sensations ; et Berkeley démontre facilement que ce support est un néant dont lemaintien doctrinal serait un décret gratuit.
3.
Notre obstination à ne pas admettre cette évidence de l'immatérialisme vient des habitudes créées en nous par le langage et lascience.
Ainsi Berkeley tient-il Newton pour le grand ennemi de la philosophie.
Les « natures » que prétendent nous découvrir les savants sont des abstractions pures.
C'est là le nominalisme de Berkeley, c'est-à-dire ladoctrine suivant laquelle les « essences », « natures », « espèces », et « idées » des choses n'existent pas, et ne sont que des mots.
la théorie de l'esprit
L'esprit n'est pas une somme de sensations.
Il existe dans les sensations comme l'acte secret qui les fonde et qui les relie entre elles.Elles sont l'effet d'un pouvoir : celui de percevoir, qui a bien des modes, depuis la sensation jusqu'à l'attention et la compréhension.
Delà, la modification de la formule célèbre Esse est percipi (être c'est être perçu) en celle-ci : Esse est percipere (être c'est percevoir).
L'esprit est donc un acte immanent aux données de la conscience psychologique, mais d'un autre ordre qu'elle, ou plutôt, il est l'acte de laconscience dans la perception.
Cet acte n'explique pas le tout de la perception puisque je ne suis pas le maître de mes perceptions, maisqu'elles s'imposent à moi ; elles ne peuvent être que l'expression d'un rapport entre mon esprit et un Esprit infini ou Dieu dont le mienn'est que participation et limitation.
La nature est donc un langage divin.
Débarrassée de la « poussière savante » que soulèvent les philosophes et les savants, elle laissetransparaître l'Acte divin auquel ma pensée participe.
conclusion
Immanence intégrale de mon esprit dans mes sensations et de Dieu en mon esprit.
La Nature n'est qu'une relation entre Dieu et moi, etje ne suis, par la pensée, que participation à la Pensée divine.La philosophie de Berkeley commence dans un émerveillement devant la nature sentie pour elle-même et non comme objet de science,et s'achève dans un mysticisme apparenté au plotinisme.
Cette doctrine est un idéalisme en ce sens qu'elle nie la matière, mais surtout c'est un spiritualisme, car, en dernière analyse, ce sont lesesprits qui sont seuls réels.
La formule Esse est percipi a conduit à cette autre plus profonde Esse est percipere.
Et l'acte de percevoir n'estque le mode humain de la Pensée infinie ; c'est déjà, si l'on sait le comprendre, découvrir l'infini de Dieu ou participer à son Esprit..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Empirisme / Berkeley
- George Berkeley Bien que ses ancêtres fussent anglais, Berkeley se considérait commeirlandais ; il était né dans le Kilkenny et avait fait ses études au TrinityCollege.
- L'oeuvre de Berkeley OEUVRES PRINCIPALESESSAY TOWARDS A NEW THEORY OF VISION
- Edwin Mattison McMillan1907-1991Professeur de physique à l'Université de Californie, Berkeley à partir 1946.
- George Berkeley (Vie, ¼uvre, Apports, Concepts, Commentaires).