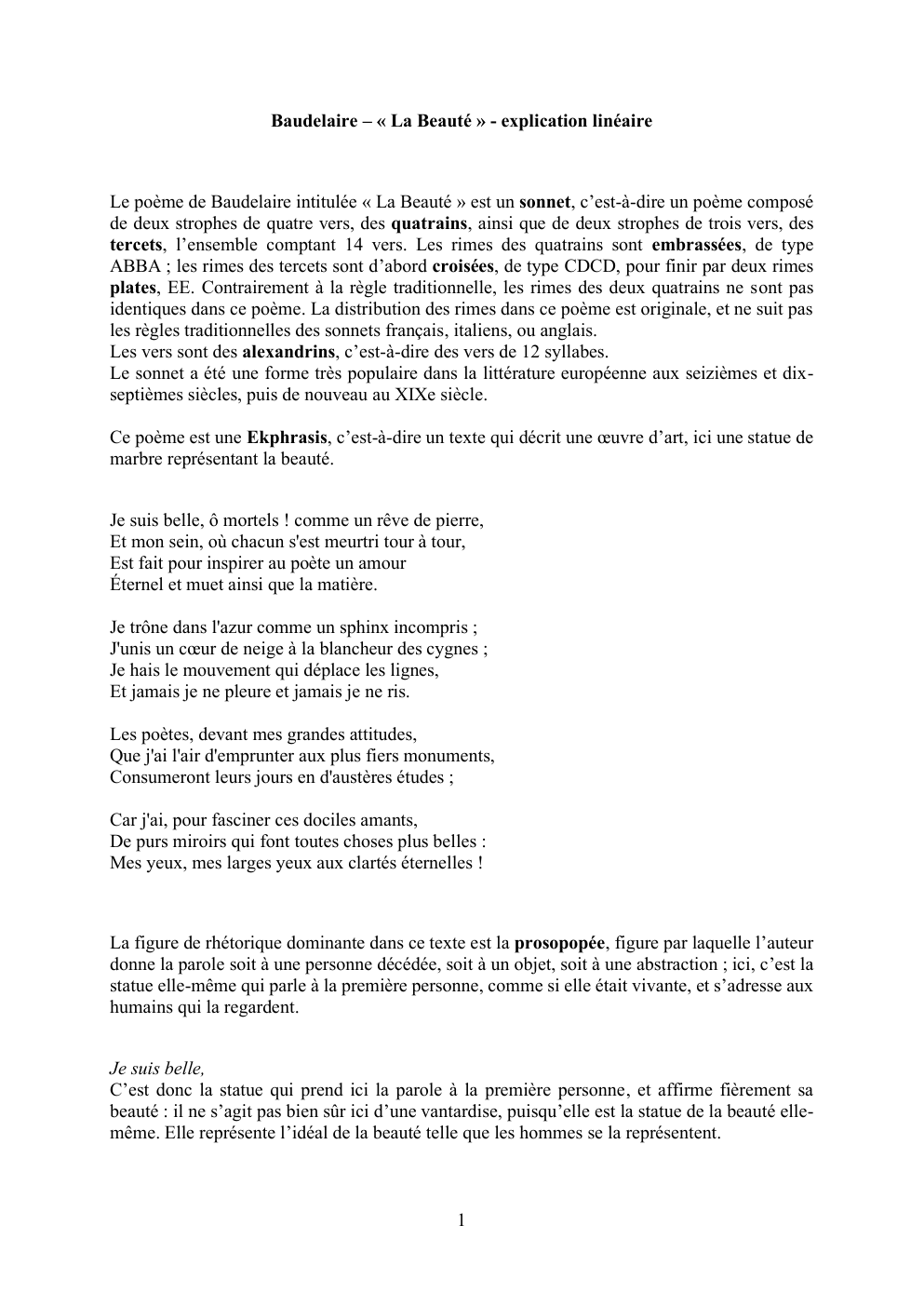Baudelaire – « La Beauté » - explication linéaire
Publié le 25/06/2023
Extrait du document
«
Baudelaire – « La Beauté » - explication linéaire
Le poème de Baudelaire intitulée « La Beauté » est un sonnet, c’est-à-dire un poème composé
de deux strophes de quatre vers, des quatrains, ainsi que de deux strophes de trois vers, des
tercets, l’ensemble comptant 14 vers.
Les rimes des quatrains sont embrassées, de type
ABBA ; les rimes des tercets sont d’abord croisées, de type CDCD, pour finir par deux rimes
plates, EE.
Contrairement à la règle traditionnelle, les rimes des deux quatrains ne sont pas
identiques dans ce poème.
La distribution des rimes dans ce poème est originale, et ne suit pas
les règles traditionnelles des sonnets français, italiens, ou anglais.
Les vers sont des alexandrins, c’est-à-dire des vers de 12 syllabes.
Le sonnet a été une forme très populaire dans la littérature européenne aux seizièmes et dixseptièmes siècles, puis de nouveau au XIXe siècle.
Ce poème est une Ekphrasis, c’est-à-dire un texte qui décrit une œuvre d’art, ici une statue de
marbre représentant la beauté.
Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre,
Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour,
Est fait pour inspirer au poète un amour
Éternel et muet ainsi que la matière.
Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris ;
J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes ;
Je hais le mouvement qui déplace les lignes,
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.
Les poètes, devant mes grandes attitudes,
Que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments,
Consumeront leurs jours en d'austères études ;
Car j'ai, pour fasciner ces dociles amants,
De purs miroirs qui font toutes choses plus belles :
Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles !
La figure de rhétorique dominante dans ce texte est la prosopopée, figure par laquelle l’auteur
donne la parole soit à une personne décédée, soit à un objet, soit à une abstraction ; ici, c’est la
statue elle-même qui parle à la première personne, comme si elle était vivante, et s’adresse aux
humains qui la regardent.
Je suis belle,
C’est donc la statue qui prend ici la parole à la première personne, et affirme fièrement sa
beauté : il ne s’agit pas bien sûr ici d’une vantardise, puisqu’elle est la statue de la beauté ellemême.
Elle représente l’idéal de la beauté telle que les hommes se la représentent.
1
ô mortels !
Le « ô » est une interjection qui sert à apostropher les hommes qui la regardent et l’admirent.
Ceux-ci sont désignés par le qualificatif de « mortels », dans le but de bien marquer leur
infériorité devant l’œuvre d’art ; si les hommes ont l’avantage d’être vivants, la statue, même
en pierre, représente un idéal éternel.
comme un rêve de pierre,
« Comme » introduit ici une comparaison qui permet de bien poser le paradoxe que représente
la statue : d’une part, elle est belle comme dans un rêve, mais, d’autre part, elle n’a rien d’un
rêve, puisqu’elle est bien un objet matériel, et d’un matériau particulièrement dur.
« rêve de pierre » est un oxymore, figure de rhétorique qui associe deux termes en principe
incompatibles l’un avec l’autre, dans le but de créer une réalité nouvelle.
Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre,
Ce vers présente une remarquable assonance (retour du même son voyelle) en « è », qui donne
au vers une sonorité particulièrement claire.
Et mon sein,
le terme « sein » nous indique que la statue en question est celle d’une femme, suivant la
tradition de la sculpture antique, où les déesses féminines sont régulièrement utilisées pour
représenter les canons de la beauté parfaite.
où chacun s'est meurtri tour à tour,
le verbe « meurtrir » forme ici une antithèse avec le sein, qui par principe est doux, chaleureux,
confortable ; mais celui de la statue est évidemment froid et dur.
L’antithèse indique ici que la
beauté absolue est un idéal inaccessible.
Est fait pour inspirer au poète un amour
Éternel et muet
La beauté est évidemment une source d’inspiration et d’extase ; l’amour que le poète pourra
éprouver pour la statue sera évidemment platonique, dépourvu de toute dimension sexuelle ;
l’homme ne peut qu’admirer la perfection des lignes, sans espérer n’avoir jamais aucune
relation personnelle avec la statue.
Cet amour rappelle d’autre part les amours platoniques vécus
par les poètes italiens, Dante pour Béatrice, Pétrarque pour Laure.
Il sera éternel comme la
beauté, et muet comme la statue.
ainsi que la matière.
Nouvelle antithèse entre l’amour et la matière, celui-ci étend par définition de l’ordre du
spirituel.
La comparaison entre les deux confirme le paradoxe (proposition qui a l’air
contradictoire en apparence, mais qui s’explique de manière logique) : toute matérielle qu’elle
soit, la statue de la beauté n’en inspire pas moins des sentiments d’ordre spirituel.
2
Je trône dans l'azur
Trôner signifie : être assis sur un trône ; la beauté est bien une déesse ; l’azur désigne ici le ciel,
il s’agit d’une métonymie (figure qui consiste à désigner un objet par une de ses
caractéristiques), le ciel est désigné ici par sa couleur.
L’azur est devenu un symbole d’idéal et
d’infini.
La beauté est placée dans une position de supériorité, elle domine l’homme à l’égal
d’une divinité.
comme un sphinx incompris ;
Le sphinx est un être fabuleux des mythologies égyptienne et grecque, moitié homme ou
femme, moitié lion ou lionne ; dans la légende d’Œdipe, une sphinge terrorise la ville de Thèbes
en posant aux passants des énigmes insolubles, et elle dévore tous ceux qui n’arrivent pas à
répondre.
La comparaison avec le sphinx se justifie par le fait que la beauté est également une
énigme, parce que le pouvoir qu’elle exerce sur les hommes est incompréhensible ; l’expression
« sphinx incompris » est un pléonasme, figure qui consiste à insister fortement sur une idée en
la répétant à l’aide de deux termes de sens proche.
J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes ;
Le blanc, symbole de pureté, est évoqué trois fois dans ce vers, par la neige, la blancheur, les
cygnes, trois termes qui forment un champ lexical de la blancheur.
C’est bien sûr ici la couleur
de la pierre dans laquelle la statue a été sculptée.
(Dans l’Antiquité, chez les Grecs et les
Romains, et encore au Moyen Âge, les statues en....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'invitation au voyage de Baudelaire- explication linéaire
- Baudelaire la cloche fêlée explication linéaire
- explication linéaire sed non satiata BAUDELAIRE
- « L’Albatros » de Baudelaire, explication linéaire
- Analyse linéaire La Beauté, Charles Baudelaire