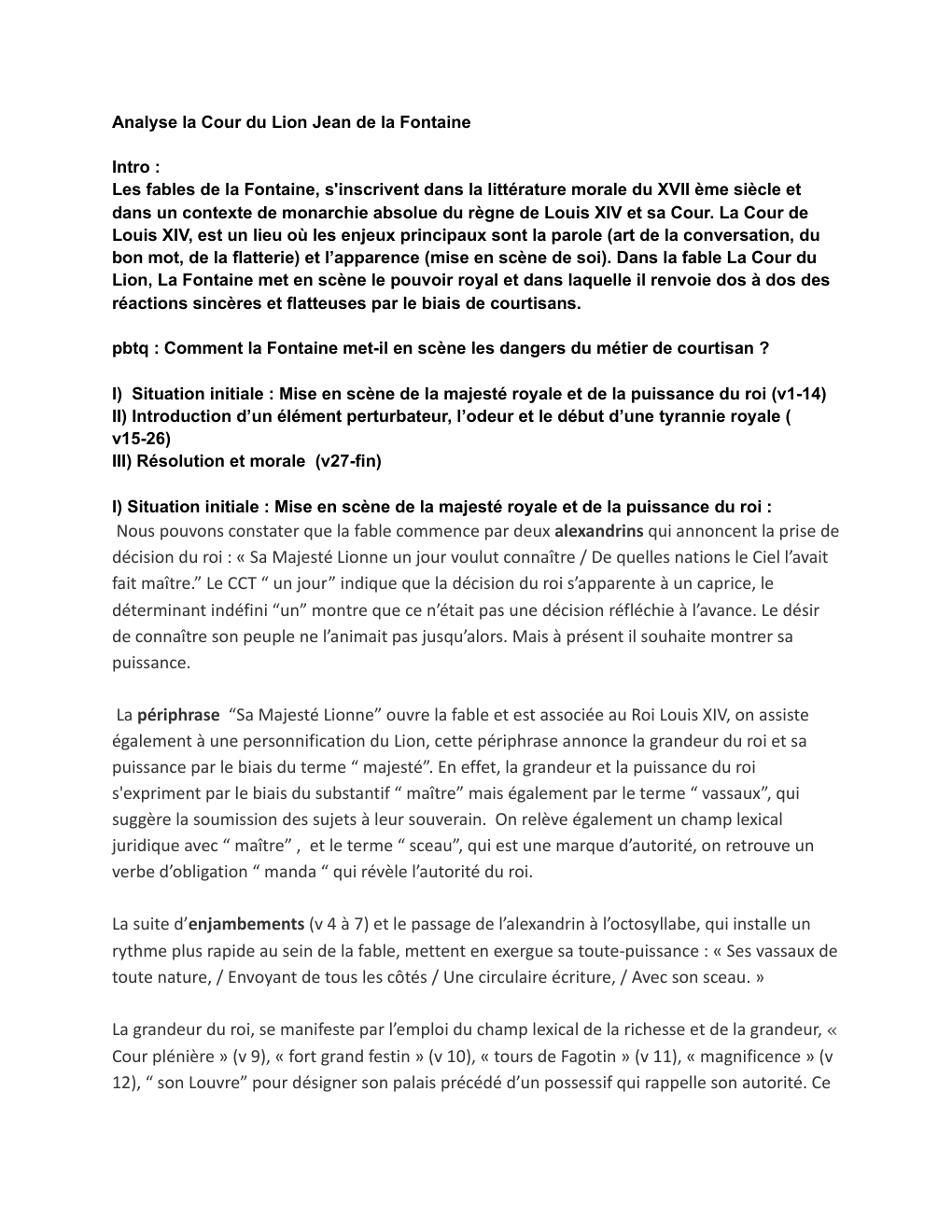Analyse la Cour du Lion Jean de la Fontaine
Publié le 08/05/2025
Extrait du document
«
Analyse la Cour du Lion Jean de la Fontaine
Intro :
Les fables de la Fontaine, s'inscrivent dans la littérature morale du XVII ème siècle et
dans un contexte de monarchie absolue du règne de Louis XIV et sa Cour.
La Cour de
Louis XIV, est un lieu où les enjeux principaux sont la parole (art de la conversation, du
bon mot, de la flatterie) et l’apparence (mise en scène de soi).
Dans la fable La Cour du
Lion, La Fontaine met en scène le pouvoir royal et dans laquelle il renvoie dos à dos des
réactions sincères et flatteuses par le biais de courtisans.
pbtq : Comment la Fontaine met-il en scène les dangers du métier de courtisan ?
I) Situation initiale : Mise en scène de la majesté royale et de la puissance du roi (v1-14)
II) Introduction d’un élément perturbateur, l’odeur et le début d’une tyrannie royale (
v15-26)
III) Résolution et morale (v27-fin)
I) Situation initiale : Mise en scène de la majesté royale et de la puissance du roi :
Nous pouvons constater que la fable commence par deux alexandrins qui annoncent la prise de
décision du roi : « Sa Majesté Lionne un jour voulut connaître / De quelles nations le Ciel l’avait
fait maître.” Le CCT “ un jour” indique que la décision du roi s’apparente à un caprice, le
déterminant indéfini “un” montre que ce n’était pas une décision réfléchie à l’avance.
Le désir
de connaître son peuple ne l’animait pas jusqu’alors.
Mais à présent il souhaite montrer sa
puissance.
La périphrase “Sa Majesté Lionne” ouvre la fable et est associée au Roi Louis XIV, on assiste
également à une personnification du Lion, cette périphrase annonce la grandeur du roi et sa
puissance par le biais du terme “ majesté”.
En effet, la grandeur et la puissance du roi
s'expriment par le biais du substantif “ maître” mais également par le terme “ vassaux”, qui
suggère la soumission des sujets à leur souverain.
On relève également un champ lexical
juridique avec “ maître” , et le terme “ sceau”, qui est une marque d’autorité, on retrouve un
verbe d’obligation “ manda “ qui révèle l’autorité du roi.
La suite d’enjambements (v 4 à 7) et le passage de l’alexandrin à l’octosyllabe, qui installe un
rythme plus rapide au sein de la fable, mettent en exergue sa toute-puissance : « Ses vassaux de
toute nature, / Envoyant de tous les côtés / Une circulaire écriture, / Avec son sceau.
»
La grandeur du roi, se manifeste par l’emploi du champ lexical de la richesse et de la grandeur, «
Cour plénière » (v 9), « fort grand festin » (v 10), « tours de Fagotin » (v 11), « magnificence » (v
12), “ son Louvre” pour désigner son palais précédé d’un possessif qui rappelle son autorité.
Ce
champ lexical vise à montrer le faste du règne de Louis XIV, le climat de fête et de réjouissance
qui régnait à cette époque.
La durée des festivités : « un mois durant » (v 8), le spectacle proposé : « tours de Fagotin » et
l’abondance de la nourriture servie, rendue visible par l’hyperbole : « un fort grand festin »
révèlent le caractère excessif, l’absence de mesure du roi Soleil qui désire impressionner ses
sujets.
Il est important de noter que le vers 13, après une série d’octosyllabe, est un alexandrin qui a
pour objectif, grâce à la longueur du vers, d’accentuer la puissance de Louis XIV.
Mais ce vers est
également présent pour dénoncer ce goût de la fête.
C’est ce que suggère la rime entre «
magnificence » et « puissance ».
Ainsi, dans cette première partie, La Fontaine dresse le portrait du roi dans toute sa puissance
et sa grandeur, il illustre la volonté du roi d’exhiber ses richesses et de déployer son autorité.
II) Introduction d’un élément perturbateur, l’odeur et le début d’une tyrannie royale (
v15-26)
On constate un fort contraste entre la deuxième et la première partie.
En effet, la deuxième
partie débute par une comparaison du “ Louvre “ avec “ un vrai charnier” ce qui assimile la
demeure royale à un lieu rempli d’ossements.
Ce contraste se manifeste également par un
déséquilibre dans la versification, avec la présence d’enjambements comme “ d’abord “ qui est
rejeté au vers suivant.
Cette discordance est causée par l’arrivée d’un élément perturbateur :
l’odeur.
En effet, on retrouve le champ lexical de l’odeur “ nez”, “ narine” , “ odeur” qui crée un violent
contraste avec la magnificence et la grandeur.
Dès lors, l’odeur perturbe la fête et suscite des
réactions chez certains courtisans.
Le premier courtisan à intervenir dans la fable est L’Ours : “ L’Ours boucha sa narine”.
L’Ours fait
une “ mine” et une “ grimace”, il y a une dimension théâtrale dans la réaction de l’Ours, il prend
des postures pour exprimer son ressenti et mène un jeu muet et sincère.
Par ailleurs, le
possessif “ sa” devant grimace suggère que L’ours est responsable de sa sentence, et dédouane
le roi de toute responsabilité.
Néanmoins, L’Ours ne va pas être apprécié du roi ceci se manifeste par la périphrase “ sa
grimace déplut” , et également par le groupe adjectival “ Le Monarque irrité” qui traduit la
susceptibilité du Lion qui s’apprête à condamner l’Ours.
Par ailleurs, le possessif “ sa” devant
grimace suggère....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Etude linéaire La cour du lion, Jean de la Fontaine
- La Fontaine, Fables, Livre VII, « La Cour du Lion ». Commentaire
- Fable, Jean de La Fontaine, Le Fou qui vend de la sagesse, Livre IX, fable 8 - Analyse linéaire
- LA FONTAINE, Jean de (7 ou 8 septembre 1621-13 avril 1695) Poète A son arrivée à Paris, Jean de la Fontaine est reçu comme avocat à la cour du Parlement mais ce sont moins les affaires à plaider qui l'intéressent que les cercles littéraires de la capitale.
- « Le rat qui s'est retiré du monde » de Jean de La Fontaine analyse complète