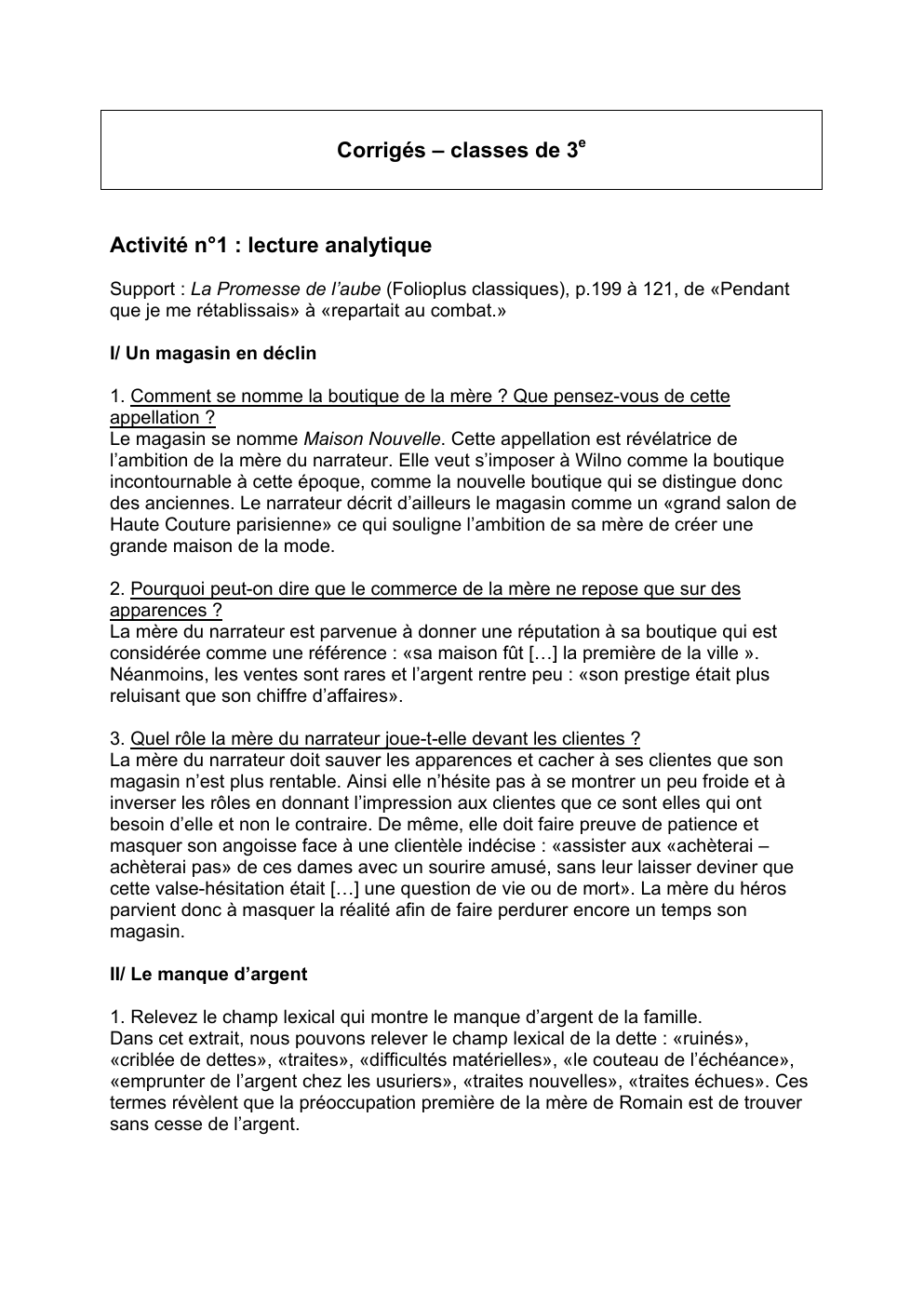Activité n°1 : lecture analytique Support : La Promesse de l’aube (Folioplus classiques), p.199 à 121, de «Pendant que je me rétablissais» à «repartait au combat.»
Publié le 12/04/2025
Extrait du document
«
Corrigés – classes de 3e
Activité n°1 : lecture analytique
Support : La Promesse de l’aube (Folioplus classiques), p.199 à 121, de «Pendant
que je me rétablissais» à «repartait au combat.»
I/ Un magasin en déclin
1.
Comment se nomme la boutique de la mère ? Que pensez-vous de cette
appellation ?
Le magasin se nomme Maison Nouvelle.
Cette appellation est révélatrice de
l’ambition de la mère du narrateur.
Elle veut s’imposer à Wilno comme la boutique
incontournable à cette époque, comme la nouvelle boutique qui se distingue donc
des anciennes.
Le narrateur décrit d’ailleurs le magasin comme un «grand salon de
Haute Couture parisienne» ce qui souligne l’ambition de sa mère de créer une
grande maison de la mode.
2.
Pourquoi peut-on dire que le commerce de la mère ne repose que sur des
apparences ?
La mère du narrateur est parvenue à donner une réputation à sa boutique qui est
considérée comme une référence : «sa maison fût […] la première de la ville ».
Néanmoins, les ventes sont rares et l’argent rentre peu : «son prestige était plus
reluisant que son chiffre d’affaires».
3.
Quel rôle la mère du narrateur joue-t-elle devant les clientes ?
La mère du narrateur doit sauver les apparences et cacher à ses clientes que son
magasin n’est plus rentable.
Ainsi elle n’hésite pas à se montrer un peu froide et à
inverser les rôles en donnant l’impression aux clientes que ce sont elles qui ont
besoin d’elle et non le contraire.
De même, elle doit faire preuve de patience et
masquer son angoisse face à une clientèle indécise : «assister aux «achèterai –
achèterai pas» de ces dames avec un sourire amusé, sans leur laisser deviner que
cette valse-hésitation était […] une question de vie ou de mort».
La mère du héros
parvient donc à masquer la réalité afin de faire perdurer encore un temps son
magasin.
II/ Le manque d’argent
1.
Relevez le champ lexical qui montre le manque d’argent de la famille.
Dans cet extrait, nous pouvons relever le champ lexical de la dette : «ruinés»,
«criblée de dettes», «traites», «difficultés matérielles», «le couteau de l’échéance»,
«emprunter de l’argent chez les usuriers», «traites nouvelles», «traites échues».
Ces
termes révèlent que la préoccupation première de la mère de Romain est de trouver
sans cesse de l’argent.
2.
Comment le narrateur justifie-t-il ce manque d’argent dont sa mère et lui
souffrent ?
Le narrateur a conscience que sa mère dépense trop d’argent par rapport à ce
qu’elle gagne : «notre train de vie plus grand que nos moyens».
Elle souhaite
conserver «une façade de prospérité», c’est-à-dire sauver les apparences.
De plus,
la mère est prête à tout lorsqu’il s’agit de son fils.
Elle dépense sans compter :
«l’extravagance extraordinaire de ma mère lorsqu’il s’agissait de moi».
Ainsi, elle
paye toute « une écurie de professeurs » chargés de l’éducation de Romain.
3.
Montrez que la situation devient de plus en plus grave et que la mère du narrateur
lutte sans cesse pour s’en sortir.
On comprend que le manque d’argent devient un problème quotidien et que la
situation s’aggrave.
Le narrateur évoque en effet « le cercle infernal des traites ».
Cette expression donne l’impression que la mère est dans un piège dont elle ne peut
se sortir.
Son fils devient le témoin impuissant de cette lutte sans fin : « le mot russe
wechsel, traite, était un refrain que j’entendais continuellement ».
L’adverbe
« continuellement » souligne l’acharnement des créanciers qui ne laissent pas de
répit à la mère de Romain.
Néanmoins, le narrateur met en avant le courage de sa
mère qui ne baisse pas les bras.
Il fait l’éloge de « sa détermination » : « elle lutta
jusqu’au bout pour sauver les apparences ».
Le héros donne l’image d’une mère
forte qui ne s’avoue jamais vaincue comme le suggère la métaphore du combat :
« lutta », « combat ».
III/ Le sacrifice d’une mère pour son fils
1.
Pourquoi peut-on dire que toutes les décisions prises par la mère ont pour but le
bonheur de son fils ?
Tout d’abord, la volonté de la mère de vendre la boutique de Wilno repose sur le
projet d’aller s’installer en France pour assurer un meilleur avenir à son fils : «Son
sens pratique lui suggérait […] que je n’avais que peu de chances de devenir
ambassadeur de France en demeurant dans une petite ville de Pologne orientale».
On constate en outre que la mère s’obstine et ne baisse pas les bras pour son fils et
pour lui assurer un avenir.
Elle le considère comme «la source de son courage».
2.
Quelle expression exprime l’attitude irrationnelle de la mère lorsqu’il s’agit de son
fils ? Comment peut-on expliquer ce comportement ?
L’expression qui souligne l’attitude irrationnelle de la mère lorsqu’il s’agit de son fils
est «extravagance extraordinaire».
On peut penser que la mère de Romain veut tout
faire pour son fils unique car elle l’élève seule.
Elle a donc l’entière responsabilité de
cet enfant.
De plus, elle souhaite un avenir meilleur pour lui.
Elle ne veut pas qu’il
connaisse de difficultés.
3.
Dans le dernier paragraphe, que fait la mère ? Quel lien y a-t-il entre la mère et
son fils ?
A la fin de l’extrait, on comprend qu’un lien indéfectible unit Romain et sa mère.
Cette
dernière ne vit que pour son enfant.
Elle parvient à surmonter toutes les difficultés
car elle sait que ce qu’elle entreprend est pour le bien de son fils qui est «la source
[…] de sa vie».
Le simple fait de le regarder lui redonne des forces.
Les paroles ne
sont pas nécessaires.
Pour aller plus loin :
Comparez le personnage de la mère dans La Promesse de l’aube avec d’autres
figures maternelles dans des romans autobiographiques.
On peut tout d’abord opposer la figure maternelle aimante de La Promesse de l’aube
aux mères tyranniques décrites dans L’Enfant de Vallès et Vipère au poing d’Hervé
Bazin.
Dans ces deux romans, la mère maltraite moralement et physiquement son
fils.
Dans Enfance, Nathalie Sarraute brosse le portrait d’une mère indifférente.
Elle
ne la maltraite pas, mais finit par la délaisser.
Dans Les armoires vides, récit
autobiographique d’Annie Ernaux, la mère est une femme simple qui vient d’un milieu
modeste.
Mais la narratrice admire cette femme imposante au caractère bien trempé,
qui apprécie peu les démonstrations d’affection, mais veille sur sa fille.
Enfin, dans
Sido, Colette évoque une figure maternelle impressionnante et émouvante, une
femme hors du commun.
Activité n°2 : Sujet type brevet
Support : La Promesse de l’aube (Folioplus classiques)., p.138 à 139, de «Je ne
cachais jamais» à «son visage se durcit à nouveau».
I/ Analyse de texte (/15 points)
1.
De quel type de récit s’agit-il ? Justifiez votre réponse.
(/2)
Il s’agit d’un récit autobiographique.
Nous pouvons le voir grâce à l’emploi de la
première personne du singulier : «je ne cachais».
De plus, le narrateur évoque un
souvenir d’enfance et fait référence à sa mère, ce qui sont des thèmes de
prédilection de l’autobiographie.
2.
Quelle scène se produit régulièrement pendant les récréations ? (/1)
Le narrateur subit une sorte d’interrogatoire pendant les récréations.
Plusieurs élèves
se rassemblent autour de lui et le questionnent au sujet de son départ en France.
3.
Quels indices nous prouvent que les autres élèves se moquent de Romain ? (/2)
Nous pouvons voir que les autres élèves se moquent de Romain aux gestes qu’ils
effectuent : «Ils se poussaient du coude», «des visages réjouis qui se dissimulaient
pour pouffer de rire».
Ce sont des signes de moqueries.
Ils ne prennent pas au
sérieux le projet du narrateur.
4.
Selon vous, pourquoi le narrateur fait-il le choix du discours direct à ce moment du
récit ? (/1)
Le discours direct permet de mieux revivre la scène.
Le lecteur a accès aux paroles
des élèves telles qu’elles ont été prononcées.
Nous avons ainsi l’impression
d’assister à l’incident.
De plus, dans cet extrait, le discours direct permet de
retranscrire les paroles des élèves pour mieux comprendre le ton ironique qu’ils
employaient alors.
5.
Comment le narrateur justifie-t-il le fait d’accepter cette humiliation et de jouer le
jeu de ses camarades ? (/2)
Le narrateur justifie l’acceptation de ces moqueries par le fait que cet interrogatoire le
ramène sans cesse à la réalisation du projet dont il rêve.
Répondre aux questions
des élèves lui donnait l’impression que tout cela allait se produire : «le jeu qu’ils me
poussaient à jouer […] m’aidait à nourrir mon espoir et mes illusions.»
6.
Toutefois, quel incident rend ce jeu beaucoup plus blessant pour le héros ? (/1)
Romain accepte ce petit jeu tant qu’il est le seul impliqué dans la moquerie.
Un jour,
l’un des élèves prononce des propos injurieux à l’égard de la mère du narrateur pour
expliquer le fait que tous deux soient encore en Pologne et non en France : «On
n’accepte pas les anciennes cocottes, là-bas.».
Le héros est alors terriblement vexé :
«mes yeux s’emplirent de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Manon Lescaut Lecture analytique 4 Support :Le dialogue entre Des Grieux et Tiberge
- Manon Lescaut Lecture analytique 5 Support : La mort de Manon
- Manon Lescaut Lecture analytique 3 Support : le souper
- Manon Lescaut Lecture analytique 2 Support : le parloir
- Lecture analytique du poème "Le goût du néant" de Charles Baudelaire