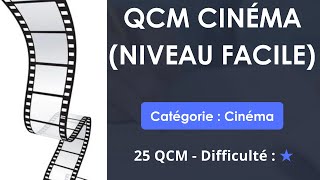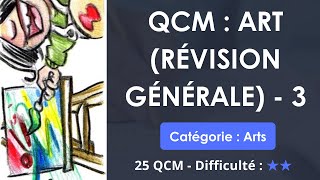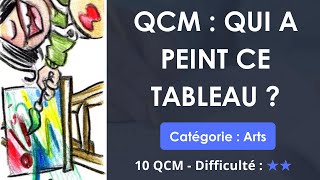Fichte:
• Kant distinguait la liberté comme détermination rationnelle du vouloir et le libre arbitre comme manifestation sensible ou phénomène de la première. Fichte, qui fait procéder le sensible de la raison elle-même, conçue comme principe immanent de la nature (c’est bien le Moi qui s’oppose un Non-Moi), réunit liberté et libre arbitre en faisant de celle-là l’être-pour-soi, la singularisation, de l’universalité rationnelle. La liberté n’est plus seulement ce dont la raison, en tant que loi morale, imposait l’affirmation pratique, mais elle est la raison, tout ensemble théorique et pratique, théorique parce que pratique, en son essence même. Voilà pourquoi cette raison, qui n’a rapport qu’à soi, se prescrit à elle-même — et telle est la loi morale fondamentale — sa propre liberté : « Je dois agir librement afin de devenir libre » (SS, SW, 4, p. 153). Le rationalisme fîchtéen se présente bien comme la systématisation de la liberté, auto-position de la raison posant tout ce qui a sens et être pour elle.
•• Puisque, de la sorte, la liberté constitutive du Moi fini en tout son être, indivisiblement rationnel et sensible, est en tant qu’elle devient et devient en tant qu’elle est, qu’à l’origine elle est déjà tout comme, à la fin, elle devient encore, bref : puisqu’être libre et se libérer ne font qu’un, l’existence la plus naturelle en porte témoignage tout comme l’existence la plus spirituelle est en attente d’elle. L'Assise fondamentale du droit naturel, qui prouve qu’un Moi ne peut être conscient de lui-même que comme d’un être agissant librement en s’appropriant les choses et d’abord son corps dans la relation réciproque des Moi, souligne que ces Moi s’incitent mutuellement à se comporter en êtres libres, déjà dans leurs corps se renvoyant des uns aux autres l’image de corps capables de s’articuler à l’infini dans des mouvements imprévisibles. Ainsi, loin d’être un contenu seulement intelligible, la liberté est, pour Fichte, ce que chaque Moi intuitionne en lui-même dans la perception sensible qu’il en a chez l’autre Moi, à travers leur incitation réciproque à actualiser cette liberté comme infinie libération. Car l’effort intersubjectif de l’actualisation de la liberté est sans fin, la vie éthique qui constitue (selon la première Doctrine de la science) ou accompagne nécessairement pour l’authentifier (selon les versions ultérieures) l’accomplissement de l’existence, ne peut se reposer dans l’inaction paresseuse (le mal moral lui-même) et requiert même l’affirmation religieuse de sa poursuite dans d’autres mondes. Constante dans sa forme et concrète dans son contenu, la réalisation de la liberté n’a donc pas seulement son lieu dans le droit (ou la politique) et dans la morale, mais dans toutes les sphères et les périodes de la vie humaine : le travail et la culture, sous tous leurs modes, en sont l’expression, et, à leur cime, la philosophie la célèbre dans l’actualisation elle-même parfaitement libre d’elle-même.
••• Cette liberté du savoir philosophique est d’abord une liberté à l’égard de lui-même, d’où la réitération, chez Fichte, de l’écriture de la Doctrine de la science ; sa fidélité revendiquée à lui-même ne pouvait être vivante, libre, qu’en libérant constamment son esprit de sa lettre. C’est là, d’ailleurs, pour le savoir philosophique lui-même, avouer sa finitude relativement à l’Etre (divin), qu’il oppose à son être-là dans le savoir. Pour celui-ci, l’Etre, agir infini, éternel, est en quelque sorte au-delà ou en deçà de la liberté, qui n’est qu’en devenant libération. Mais la liberté philosophante ne relativise-t-elle pas alors elle-même sa propre relativisation, c’est-à-dire sa distinction d’avec l’absolu ? En ne se posant pas une telle question, le philosophe fichtéen n’aurait-il pas arrêté trop tôt sa propre libération ?
Liens utiles
- FICHTE
- FICHTE
- Fichte et l'idéalisme allemand
- Johann Gottlieb Fichte Johann Fichte naquit à Rammenau (Saxe) dans une famille modeste, etacquit sa connaissance grâce à la bonté d'un riche ami de son père, quifinança ses études de théologie et de philosophie à Iéna puis à Leipzig.
- Seconde période du XVIIIe siècle et première période du XIXe siècle: Fichte et Schopenhauer (idéalisme allemand)