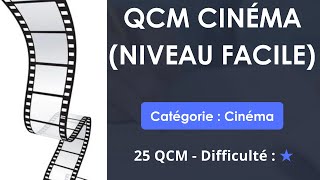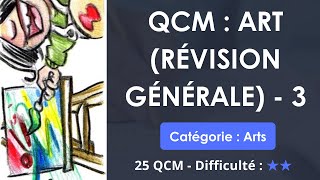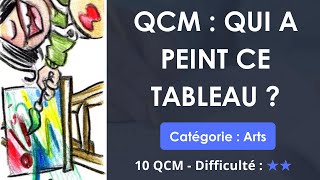Schopenhauer: Pitié
Pitié (Mitleid)
• La pitié, ou compassion, est la « participation tout immédiate, sans aucune arrière-pensée, d’abord aux douleurs d’autrui, puis et par suite à la cessation, ou à la suppression de ces maux » (FM, p. 118). Contre le rationalisme kantien, longuement et violemment critiqué, Schopenhauer la considère comme le « fondement de la morale ».
•• Il ne s’agit pas d’un postulat, mais d’une véritable déduction, selon une démarche analytique, régressant de condition en condition, jusqu’à en trouver une qui soit réalisée. Soit la séquence suivante : 1 — « Le propre de l’action, positive ou négative, moralement bonne, (est) d’être dirigée en vue de l’avantage et du profit d’un autre» (FM, p. 117) ; 2- « Or, pour que mon action soit faite uniquement en vue d’un autre, il faut que le bien de cet autre soit pour moi, et directement, un motif, au même titre où mon bien à moi l’est d’ordinaire » (ibid.) 3 - « Or, c’est supposer que, par un moyen quelconque, je suis identifié (identifiziert) avec lui, que toute différence entre moi et autrui est détruite, au moins jusqu’à un certain point, car c’est sur cette différence que repose justement mon égoïsme » (FM, p. 118). 4 - Or « c’est là le phénomène quotidien de la pitié » (ibid.) 5 - « Cette pitié, voilà (par conséquent) le seul principe réel de toute justice spontanée et de toute vraie charité » (ibid.) Schopenhauer est donc fondé à soutenir que « toute cette série de pensées, dont voici l’analyse », il ne l’a pas « rêvée » (ibid.), puisqu’elle aboutit à un phénomène indubitable et familier, qualités dont ne saurait évidemment se prévaloir la déduction kantienne, cet « ergotage conceptuel » et ces « bulles de savon ». De la pitié procèdent la justice et la charité, ces deux vertus cardinales, dont « toutes les autres découlent en pratique et se déduisent en théorie » (FM, p. 123). La justice — neminem laede, ne nuis à personne —, « voilà en un mot tout l'Ancien Testament» (FM, p. 144). La charité — omnes, quantum potes, juva, aide chacun, autant que tu le peux —, ce « second degré » de la pitié, où « la souffrance d’autrui devient par elle-même, et sans intermédiaire, le motif de mes actes » (FM, p. 140), « voilà le Nouveau » (FM, p. 144).
••• La pitié n’est pas seulement le fondement de la morale. Elle se voit, de surcroît, investie d’une fonction métaphysique essentielle. Dans l’expérience de la compassion, j’éprouve l’unité fondamentale de tous les êtres, même inanimés, cette vérité dont les Oupanichads ont donné la formule avec la « sublime parole » : Tat twam asi, tu es ceci, cet autre, c’est aussi toi-même, l’individuation phénoménale n’est qu’une illusion. La pitié ouvre donc à l’essence ultime des choses, l’unité de la chose en soi. De même que la sexualité constitue le « vrai foyer » de la volonté, en tant que celle-ci s’affirme, de même la pitié nous apparaît comme une initiation à cette volonté, en tant qu’elle s’achemine vers sa propre négation. La pitié est donc plus métaphysique que la sexualité, qui, certes, en tant qu’expérience privilégiée de ma volonté, me permet de percer l’écorce phénoménale, pour accéder au noyau de mon être, mais ne me délivre pas du tourment du désir et de la différence. Seule l’expérience de la pitié me conduit à l’essence indivise des êtres. Il s’ensuit, en termes kantiens, que ce « fait quotidien » n’est pas seulement la ratio essendi de la moralité, mais aussi la ratio cognoscendi de la Volonté.
Liens utiles
- Arthur SCHOPENHAUER, Le Monde comme volonté et comme représentation, 181 B, livre IV, trad. A. Burd eau,© PUF, 2e éd. 2004
- François Mauriac écrit : « Les personnages fictifs et irréels nous aident à nous mieux connaître et à prendre conscience de nous-mêmes... Et c'est sans doute notre raison d'être, c'est ce qui légitime notre absurde et étrange métier que cette création d'un monde irréel grâce auquel les hommes vivants voient plus clair dans leur propre coeur et peuvent se témoigner les uns aux autres plus de compréhension et de pitié. »
- POURQUOI AIMONS-NOUS LA FONTAINE ? Après avoir étudié l'oeuvre de La Fontaine, un critique contemporain conclut : « Il n'y a pas de note humaine qui ne s'y fasse entendre, l'ironie, l'émotion, la pitié, le courage, le goût du plaisir et de la retraite, l'acceptation de la vie et le besoin du rêve. On voudrait faire sentir pourquoi on l'aime ; mais on n'ose forcer la voix quand on parle du plus discret des poètes. » Vous direz si vous retrouvez dans ces quelques lignes l'impression que
- Un auteur contemporain affirme que le but suprême du romancier est de nous faire connaître et aimer l'âme humaine dans sa grandeur comme dans sa misère, dans ses victoires comme dans ses défaites. Et il conclut : « Admiration et pitié, telle est la devise du roman ». Qu'en pensez-vous ? Vous vous appuierez sur La Bête humaines de Zola, Noeud de vipère de Mauriac, Un roi sans divertissement de Giono.
- « Les héros des grands romanciers, même quand l'auteur ne prétend rien prouver ni rien démontrer, détiennent une vérité qui peut n'être pas la même pour chacun de nous, mais qu'il appartient à chacun de nous de découvrir et de s'appliquer. Et c'est sans doute notre raison d'être, c'est ce qui légitime notre absurde et étrange métier que cette création d'un monde idéal grâce auquel les hommes vivants voient plus clair dans leur propre coeur et peuvent se témoigner les uns aux autres pl