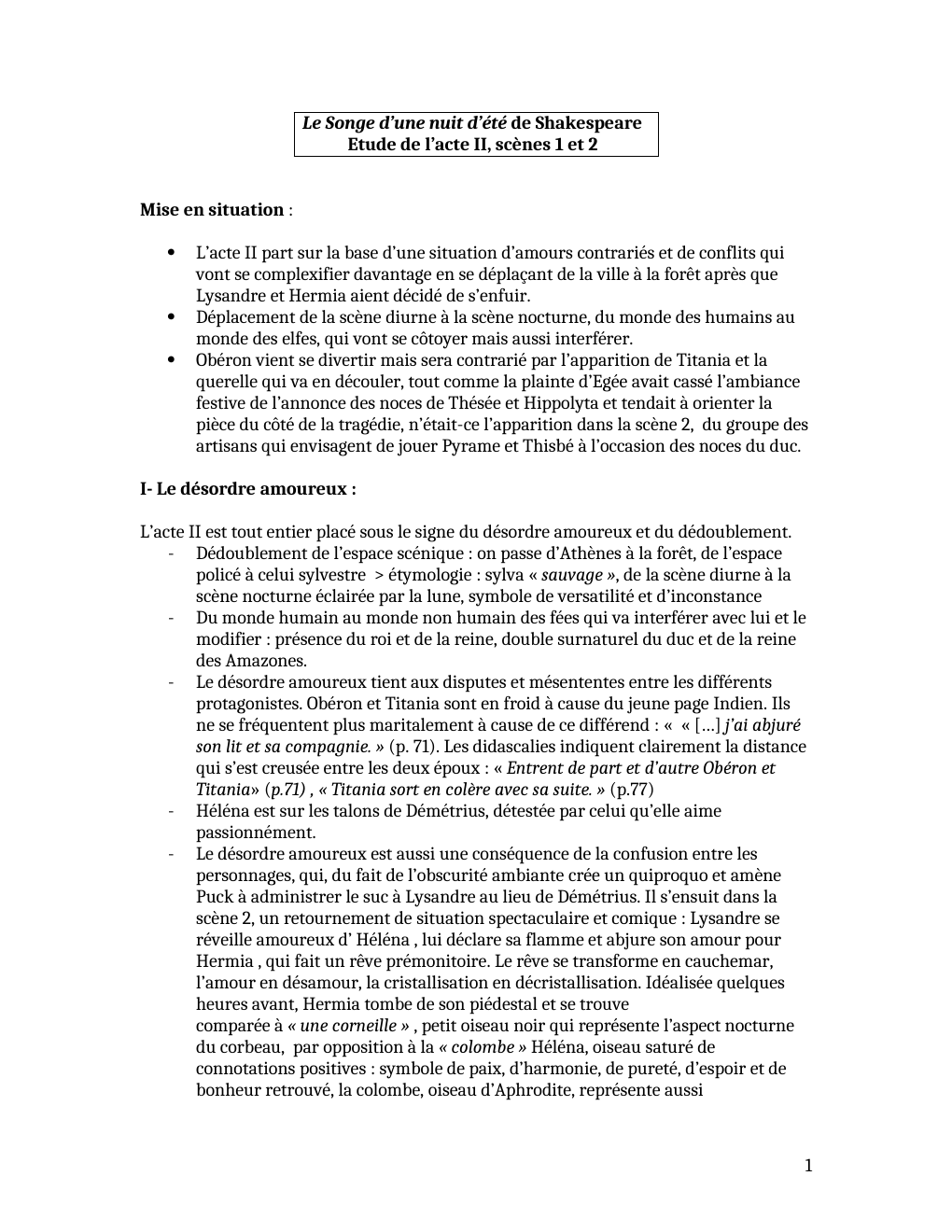Songe d'une nuit - Acte II- Scènes 1 et 2
Publié le 29/05/2025
Extrait du document
«
Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare
Etude de l’acte II, scènes 1 et 2
Mise en situation :
L’acte II part sur la base d’une situation d’amours contrariés et de conflits qui
vont se complexifier davantage en se déplaçant de la ville à la forêt après que
Lysandre et Hermia aient décidé de s’enfuir.
Déplacement de la scène diurne à la scène nocturne, du monde des humains au
monde des elfes, qui vont se côtoyer mais aussi interférer.
Obéron vient se divertir mais sera contrarié par l’apparition de Titania et la
querelle qui va en découler, tout comme la plainte d’Egée avait cassé l’ambiance
festive de l’annonce des noces de Thésée et Hippolyta et tendait à orienter la
pièce du côté de la tragédie, n’était-ce l’apparition dans la scène 2, du groupe des
artisans qui envisagent de jouer Pyrame et Thisbé à l’occasion des noces du duc.
I- Le désordre amoureux :
L’acte II est tout entier placé sous le signe du désordre amoureux et du dédoublement.
- Dédoublement de l’espace scénique : on passe d’Athènes à la forêt, de l’espace
policé à celui sylvestre > étymologie : sylva « sauvage », de la scène diurne à la
scène nocturne éclairée par la lune, symbole de versatilité et d’inconstance
- Du monde humain au monde non humain des fées qui va interférer avec lui et le
modifier : présence du roi et de la reine, double surnaturel du duc et de la reine
des Amazones.
- Le désordre amoureux tient aux disputes et mésententes entre les différents
protagonistes.
Obéron et Titania sont en froid à cause du jeune page Indien.
Ils
ne se fréquentent plus maritalement à cause de ce différend : « « […] j’ai abjuré
son lit et sa compagnie.
» (p.
71).
Les didascalies indiquent clairement la distance
qui s’est creusée entre les deux époux : « Entrent de part et d’autre Obéron et
Titania» (p.71) , « Titania sort en colère avec sa suite.
» (p.77)
- Héléna est sur les talons de Démétrius, détestée par celui qu’elle aime
passionnément.
- Le désordre amoureux est aussi une conséquence de la confusion entre les
personnages, qui, du fait de l’obscurité ambiante crée un quiproquo et amène
Puck à administrer le suc à Lysandre au lieu de Démétrius.
Il s’ensuit dans la
scène 2, un retournement de situation spectaculaire et comique : Lysandre se
réveille amoureux d’ Héléna , lui déclare sa flamme et abjure son amour pour
Hermia , qui fait un rêve prémonitoire.
Le rêve se transforme en cauchemar,
l’amour en désamour, la cristallisation en décristallisation.
Idéalisée quelques
heures avant, Hermia tombe de son piédestal et se trouve
comparée à « une corneille » , petit oiseau noir qui représente l’aspect nocturne
du corbeau, par opposition à la « colombe » Héléna, oiseau saturé de
connotations positives : symbole de paix, d’harmonie, de pureté, d’espoir et de
bonheur retrouvé, la colombe, oiseau d’Aphrodite, représente aussi
1
l’accomplissement amoureux que l’amant offre à l’objet de son désir.
C’est enfin
une des nombreuses métaphores célébrant la femme.
Cette déclaration amoureuse est cependant le produit d’un sortilège et demeure,
aux yeux du spectateur, plus informé que le personnage, un discours en porte-àfaux puisque dans la réalité c’est bien d’Hermia qu’il est amoureux et que le
quiproquo amoureux est le résultat d‘une erreur sur la personne que Puck a
commise.
La passion amoureuse est ainsi une illusion : elle se résume à une
représentations erronée, un jeu de simulacres, un produit de l’imagination.
Le désordre amoureux a des incidences plus grande et affecte l’ordre du monde
et y introduit un chaos généralisé : à cause des querelles entre Obéron et Titania :
« […] la Lune , qui préside aux inondations, a noyé l’atmosphère ; les rhumatismes
pullulent .Tous ces troubles provoquent des changements dans les saisons : les
gelées blanches s’abattent au tendre cœur des roses cramoisies, tandis que , par
dérision , une couronne odorante de bourgeons d’été se pose sur la calvitie glacée
du vieil Hiver.
Le Printemps, l’Été, l’Automne fécond, le coléreux Hiver troquent
leur habituelle parure et le monde étonné de leurs récoltes ne sait plus où il en
es] .
Cette cascade de malheurs provient de nos discordes et de nos querelles ; nous
en sommes l’auteur, la cause originelle.
», avoue Titania (p.75)
II- Amour et pouvoir
Amour et pouvoir interagissent dans une relation dialectique qui fait que parfois ils
s’allient et sont compatibles et d’autres où ils s’affrontent et s’excluent.
L’acte II en donne une bonne illustration : l’autre devient persécuteur par sa
fureur et son pouvoir de nuisance (Obéron) ou par son indifférence et son
potentiel de violence (Démétrius et ses insultes et surtout ses menaces de viol).
Obéron et Titania :
sont déterminés non seulement par leurs liens maritaux et sentimentaux mais
aussi par leur statut politique de souverains, roi et reine, qui les pousse à être en
compétition.
Ils se disputent tous les deux, avec force, le jeune page Indien et ne
cèdent aucunement sur ce qu’ils estiment l’un et l’autre leur droit.
Il s’en suit
une sorte de guerre larvée (1) où tous les coups sont permis :
(1)
(qui n’éclate pas, n’éclot pas)
menaces, intimidations, sortilège.
Obéron rappelle à Titania son devoir de vassalité et de soumission : « […] ne suisje pas ton maitre ? » plaçant le débat sur le plan politique et social, et elle , de le
déplacer sur le plan amoureux pour lui rappeler ses manquements et son
infidélité : « Alors je devrais être ta maitresse : mais je sais qu’en t’enfuyant du
Pays de féerie tu pris la forme de Corydon […] pour jouer du pipeau et débiter des
vers d’amour à l’amoureuse Phillidia ; pourquoi reviens-tu donc par ici du fin fond
2
des escarpements de l’Inde ? Parce que, pardi, cette trépidante Amazone, ta
maitresse doit épouser Thésée ; et tu viens apporter à leur couche la joie et le
bonheur.
» (p.71).
Le pouvoir masculin et celui féminin tendent ainsi à s’opposer
sans que l’on verse cependant dans la haine de l’autre.
L’amour est parasité par
la colère et le dépit : Puck met en garde les elfes : « Obéron est en colère et rage à
cause de cet enfant charmant, dérobé à un roi des Indes, qu’elle a pris comme
page.
» (p.
67-69)
Obéron fait montre d’une insistance somme toute tyrannique et se fait un devoir
de la soumettre à sa volonté, quitte à recourir au sortilège : « […] Tu ne sortiras
pas de ce bois que je ne t’aie châtiée pour cet outrage.
» (p.77) ;
« […] Le premier être vivant qu’elle verra à son réveil, qu’il soit lion, ours, loup ou
taureau, singe fureteur ou macaque affairé, elle le poursuivra dans un transport
d’amour ; et , avant de délivrer sa vue de ce charme , comme je puis le faire par
une autre plante , je l’obligerai à me céder son page.
» (p.79).
L’amour devient ainsi un instrument de vengeance et d’asservissement de
l’autre.
Le coup de foudre est détourné de sa fonction de liant sentimental, pour
devenir le moyen d’une liaison contre-nature avec un être animalisé
(Bottom) et d’une séparation d’avec le jeune page Indien que Titania a « élevé
par amour » de sa mère et dont elle ne veut pas se séparer.
Démétrius / Héléna :
Héléna est totalement asservie et aliénée par son amour pour Démétrius.
Elle se met dans une situation de servilité absolue, quémandant son amour, et se....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Imaginez que Gusman ait assisté aux scènes 2 et 3 de l'acte 1 et écrivez sous forme de tirade ses réactions.
- Commentaire composé : Le Mariage de Figaro scènes VI VII VIII de l'acte II « Suzanne entre avec un grand bonnet […] en emportant le manteau du page »
- Prouver que Dom Juan est séduisant dans les scènes 1, 2 et 5 de l'acte III.
- Jean-Paul SARTRE, Les Mouches, acte II, scènes 3 et 4, 1943. Commentaire
- ACTE V - Scènes 5 et 6 dans Dom Juan de Molière