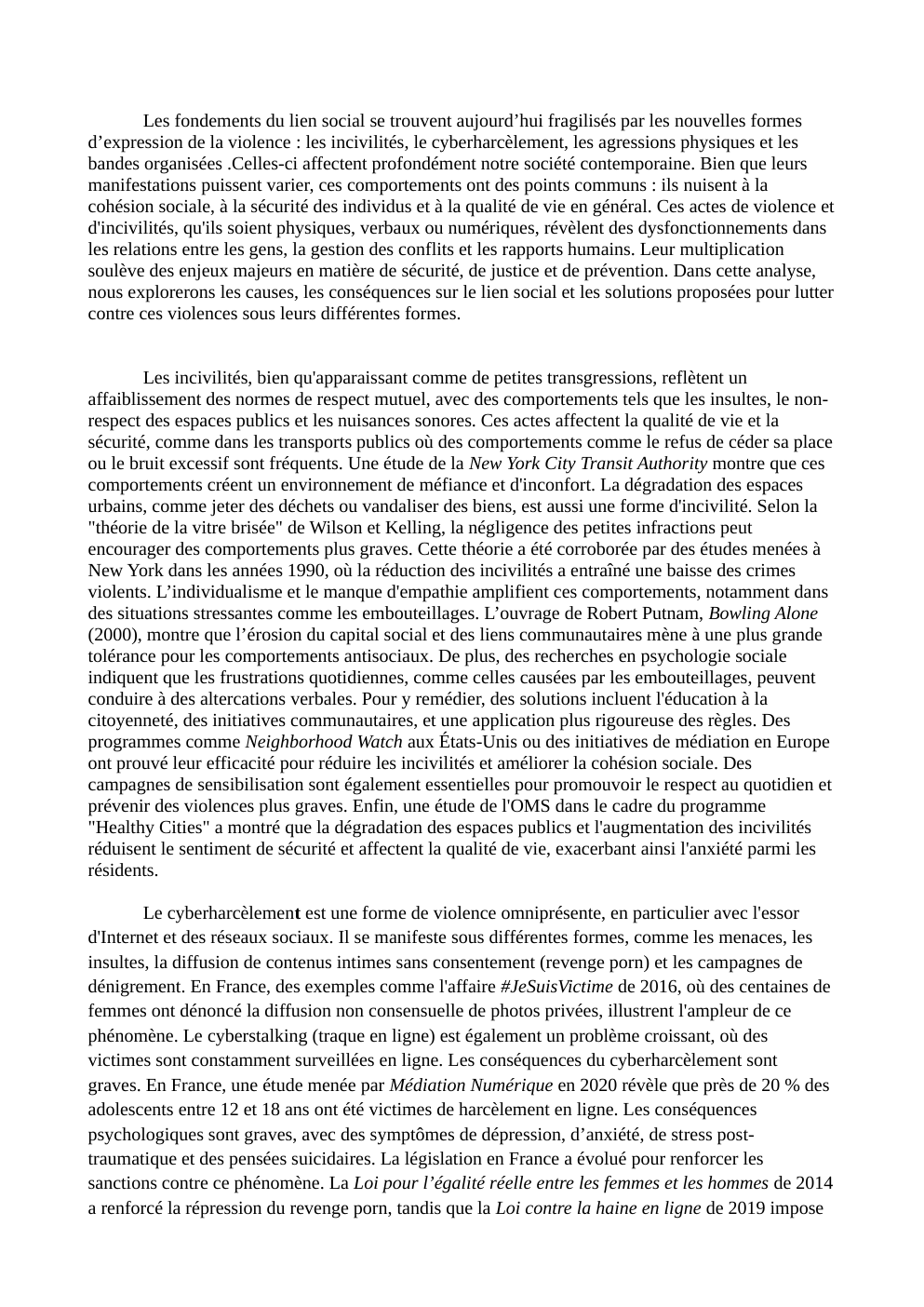Oral de sociologie: les nouvelles formes d’expression de la violence
Publié le 22/04/2025
Extrait du document
«
Les fondements du lien social se trouvent aujourd’hui fragilisés par les nouvelles formes
d’expression de la violence : les incivilités, le cyberharcèlement, les agressions physiques et les
bandes organisées .Celles-ci affectent profondément notre société contemporaine.
Bien que leurs
manifestations puissent varier, ces comportements ont des points communs : ils nuisent à la
cohésion sociale, à la sécurité des individus et à la qualité de vie en général.
Ces actes de violence et
d'incivilités, qu'ils soient physiques, verbaux ou numériques, révèlent des dysfonctionnements dans
les relations entre les gens, la gestion des conflits et les rapports humains.
Leur multiplication
soulève des enjeux majeurs en matière de sécurité, de justice et de prévention.
Dans cette analyse,
nous explorerons les causes, les conséquences sur le lien social et les solutions proposées pour lutter
contre ces violences sous leurs différentes formes.
Les incivilités, bien qu'apparaissant comme de petites transgressions, reflètent un
affaiblissement des normes de respect mutuel, avec des comportements tels que les insultes, le nonrespect des espaces publics et les nuisances sonores.
Ces actes affectent la qualité de vie et la
sécurité, comme dans les transports publics où des comportements comme le refus de céder sa place
ou le bruit excessif sont fréquents.
Une étude de la New York City Transit Authority montre que ces
comportements créent un environnement de méfiance et d'inconfort.
La dégradation des espaces
urbains, comme jeter des déchets ou vandaliser des biens, est aussi une forme d'incivilité.
Selon la
"théorie de la vitre brisée" de Wilson et Kelling, la négligence des petites infractions peut
encourager des comportements plus graves.
Cette théorie a été corroborée par des études menées à
New York dans les années 1990, où la réduction des incivilités a entraîné une baisse des crimes
violents.
L’individualisme et le manque d'empathie amplifient ces comportements, notamment dans
des situations stressantes comme les embouteillages.
L’ouvrage de Robert Putnam, Bowling Alone
(2000), montre que l’érosion du capital social et des liens communautaires mène à une plus grande
tolérance pour les comportements antisociaux.
De plus, des recherches en psychologie sociale
indiquent que les frustrations quotidiennes, comme celles causées par les embouteillages, peuvent
conduire à des altercations verbales.
Pour y remédier, des solutions incluent l'éducation à la
citoyenneté, des initiatives communautaires, et une application plus rigoureuse des règles.
Des
programmes comme Neighborhood Watch aux États-Unis ou des initiatives de médiation en Europe
ont prouvé leur efficacité pour réduire les incivilités et améliorer la cohésion sociale.
Des
campagnes de sensibilisation sont également essentielles pour promouvoir le respect au quotidien et
prévenir des violences plus graves.
Enfin, une étude de l'OMS dans le cadre du programme
"Healthy Cities" a montré que la dégradation des espaces publics et l'augmentation des incivilités
réduisent le sentiment de sécurité et affectent la qualité de vie, exacerbant ainsi l'anxiété parmi les
résidents.
Le cyberharcèlement est une forme de violence omniprésente, en particulier avec l'essor
d'Internet et des réseaux sociaux.
Il se manifeste sous différentes formes, comme les menaces, les
insultes, la diffusion de contenus intimes sans consentement (revenge porn) et les campagnes de
dénigrement.
En France, des exemples comme l'affaire #JeSuisVictime de 2016, où des centaines de
femmes ont dénoncé la diffusion non consensuelle de photos privées, illustrent l'ampleur de ce
phénomène.
Le cyberstalking (traque en ligne) est également un problème croissant, où des
victimes sont constamment surveillées en ligne.
Les conséquences du cyberharcèlement sont
graves.
En France, une étude menée par Médiation Numérique en 2020 révèle que près de 20 % des
adolescents entre 12 et 18 ans ont été victimes de harcèlement en ligne.
Les conséquences
psychologiques sont graves, avec des symptômes de dépression, d’anxiété, de stress posttraumatique et des pensées suicidaires.
La législation en France a évolué pour renforcer les
sanctions contre ce phénomène.
La Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes de 2014
a renforcé la répression du revenge porn, tandis que la Loi contre la haine en ligne de 2019 impose
aux plateformes numériques de retirer les contenus haineux dans un délai de 24 heures.
Ces lois
visent à réduire l'impunité et protéger les victimes.
Pour sensibiliser et agir, la France a lancé des
campagnes telles que StopHarcèlementDeRue, qui inclut désormais le cyberharcèlement, et la
campagne Non au cyberharcèlement du ministère de l’Éducation nationale, qui éduque les jeunes
sur l'utilisation responsable d'Internet.
De plus, des ressources comme le service 3020 d'assistance
aux victimes et la plateforme Pharos pour signaler les contenus illicites offrent un soutien aux
victimes et facilitent les démarches contre les auteurs de cyberharcèlement.
Pour lutter contre ce
phénomène, il est crucial d'éduquer les jeunes dès leur plus jeune âge à une utilisation responsable
des outils numériques, comme l'initiative Digizen en France.
En outre, il est nécessaire de renforcer
la réglementation des entreprises numériques pour détecter et supprimer les contenus malveillants.
Twitter, par exemple, a renforcé ses politiques de modération en 2020 pour lutter contre le
cyberharcèlement en ligne.
Les agressions physiques, bien que souvent considérées comme un problème persistant
malgré les progrès des sociétés, englobent des actes de violence intentionnels comme les coups, les
blessures par arme blanche ou à feu.
Ces agressions se produisent dans des contextes variés, allant
des disputes domestiques aux conflits dans l’espace public.
Les facteurs socio-économiques, tels
que le chômage et la précarité, jouent un rôle important dans l’exacerbation des tensions et des
frustrations, ce qui contribue à la violence.
Selon une étude de l'INSEE, la précarité sociale et le
stress économique peuvent entraîner une augmentation des comportements agressifs.
L'alcool et la
consommation de drogues sont aussi des catalyseurs notables de violences physiques.
Une étude
menée par l'OMS montre que l’alcool altère le jugement et amplifie les comportements impulsifs,
entraînant souvent des agressions physiques dans des lieux comme les bars et les stades sportifs.
Ces lieux sont propices aux violences en raison de la densité humaine et des conflits d’intérêts.
Les
conséquences des agressions physiques sont multiples.
Non seulement les victimes peuvent souffrir
de séquelles physiques à long terme, mais elles risquent aussi de développer des troubles
psychologiques comme l’anxiété, la dépression et le stress post-traumatique.
Selon une étude de
l’Université de Paris, 40% des victimes de violences physiques souffrent de troubles
psychologiques durables.
Pour prévenir ces violences, des réponses coordonnées sont nécessaires.
D’abord, les sanctions judiciaires jouent un rôle dissuasif.
Le Code pénal français prévoit des peines
pour les actes violents, notamment en matière de violences conjugales.
Par ailleurs, des programmes
de médiation comme "Villes et quartiers sans violence" en France ont montré leur efficacité pour
désamorcer les conflits dans les zones urbaines sensibles.
L'éducation à la non-violence dès le plus
jeune âge, combinée à la création d'espaces sûrs pour les jeunes, est essentielle.
Le programme
"École de la paix" vise à enseigner aux enfants à gérer les conflits sans recourir à la violence.
Enfin,
des initiatives comme "Violence éducative zéro" en France incitent à utiliser des méthodes
éducatives non violentes pour réduire les agressions dans les familles et les écoles.
Les bandes organisées sont des groupes, souvent composés de jeunes, qui recherchent un
sentiment d’appartenance et de protection.
Ces groupes, souvent issus de milieux précaires,
s'engagent dans des actes de violence pour contrôler des territoires ou défendre leur honneur.
Leur
structure interne inclut des rôles définis (leaders, exécutants, recruteurs), et leurs activités s'étendent
au-delà des affrontements physiques pour inclure des délits comme le trafic de drogue, les
cambriolages et les extorsions.
Selon une étude du Ministère de l'Intérieur, ces groupes sont en
croissance dans certains quartiers sensibles en France, souvent exacerbés par des tensions socioéconomiques comme la précarité....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- SOCIOLOGIE ET SCIENCE POLITIQUE SP5 : LES FORMES ET MOTIVATIONS DE L’ENGAGEMENT POLITIQUE EN DEMOCRATIE
- Vous proposez un article sur le sujet des réécritures au directeur d'un journal. Vous analysez dans votre texte le principe des réécritures et l'intérêt qu'elles présentent. Dans votre démarche, vous vous efforcez évidemment d'illustrer vos explications. Vous exploitez donc vos connaissances personnelles, ainsi que l'exemple fourni par les textes présentés ci-dessus ; vous vous appuyez éventuellement sur des exemples empruntés à d'autres formes d'expression artistique.
- Vous imaginez un dialogue de 80 lignes entre deux élèves de lycée; l'un est sensible à la poésie lyrique, apprécie l'expression de sentiments tristes et malheurs, et l'autre refuse ce genre de poésie, et préfère d'autres formes artistiques ou d'autres sources d'inspiration poétique.
- L'un des ressorts de la tragédie est l'émotion tragique qu'elle doit inspirer au spectateur, mais elle bannit toute forme de violence visuelle sur scène. En prenant appui sur plusieurs récits dont essentiellement celui de la mort d'Hippolyte, vous chercherez en quoi un récit oral peut susciter plus d'émotion que la représentation de la scène qu'il rapporte.
- Les spectacles (théâtre, cinéma) donnent à voir ce que l'écriture romanesque suggère. A l'aide de ce dossier mais aussi de vos expériences de lecteur et de spectateur, vous réfléchirez à l'intérêt et aux limites de ces formes d'expression ?