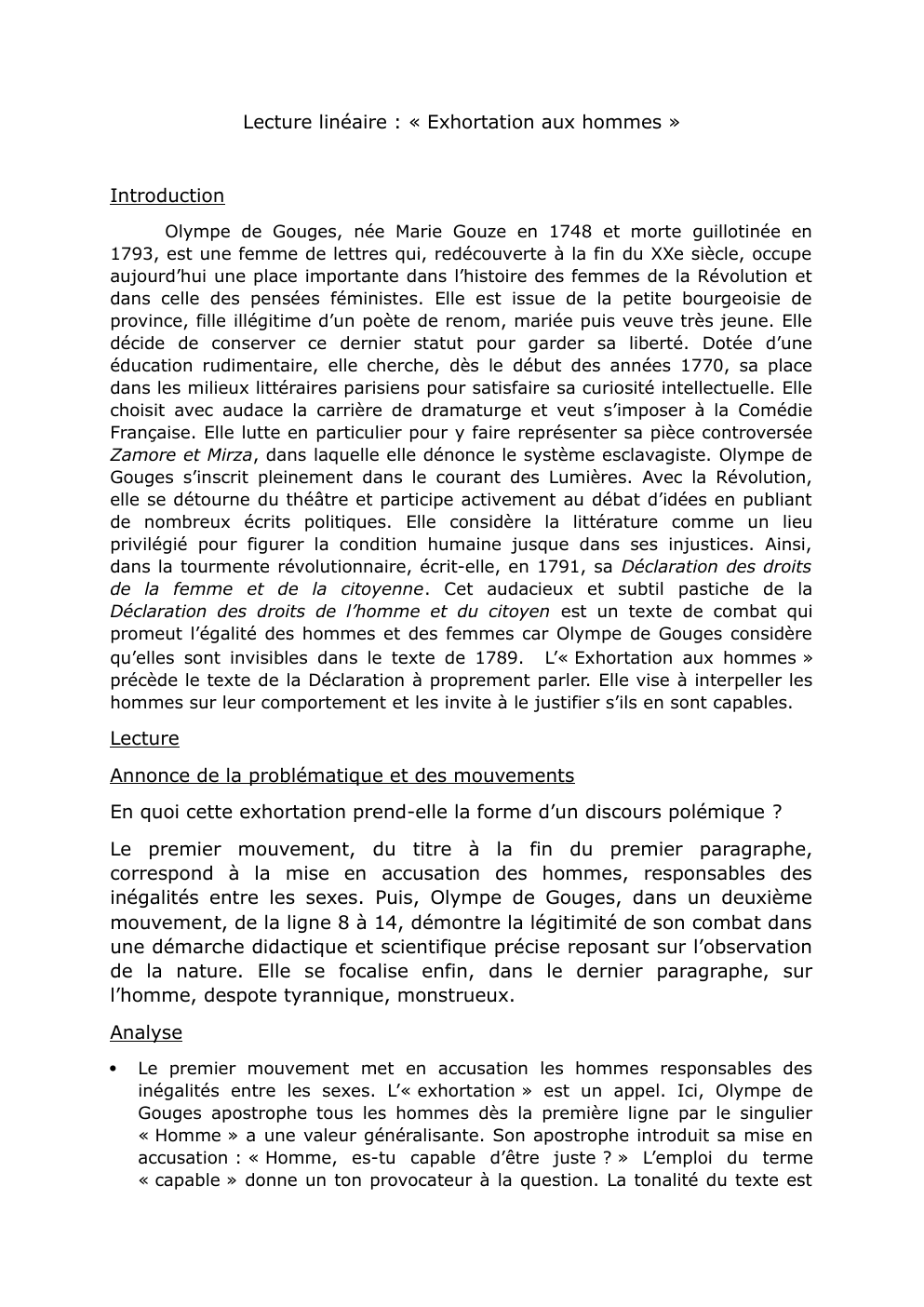Olympe de Gouges, Exhortation aux hommes, analyse linéaire
Publié le 11/05/2025
Extrait du document
«
Lecture linéaire : « Exhortation aux hommes »
Introduction
Olympe de Gouges, née Marie Gouze en 1748 et morte guillotinée en
1793, est une femme de lettres qui, redécouverte à la fin du XXe siècle, occupe
aujourd’hui une place importante dans l’histoire des femmes de la Révolution et
dans celle des pensées féministes.
Elle est issue de la petite bourgeoisie de
province, fille illégitime d’un poète de renom, mariée puis veuve très jeune.
Elle
décide de conserver ce dernier statut pour garder sa liberté.
Dotée d’une
éducation rudimentaire, elle cherche, dès le début des années 1770, sa place
dans les milieux littéraires parisiens pour satisfaire sa curiosité intellectuelle.
Elle
choisit avec audace la carrière de dramaturge et veut s’imposer à la Comédie
Française.
Elle lutte en particulier pour y faire représenter sa pièce controversée
Zamore et Mirza, dans laquelle elle dénonce le système esclavagiste.
Olympe de
Gouges s’inscrit pleinement dans le courant des Lumières.
Avec la Révolution,
elle se détourne du théâtre et participe activement au débat d’idées en publiant
de nombreux écrits politiques.
Elle considère la littérature comme un lieu
privilégié pour figurer la condition humaine jusque dans ses injustices.
Ainsi,
dans la tourmente révolutionnaire, écrit-elle, en 1791, sa Déclaration des droits
de la femme et de la citoyenne.
Cet audacieux et subtil pastiche de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est un texte de combat qui
promeut l’égalité des hommes et des femmes car Olympe de Gouges considère
qu’elles sont invisibles dans le texte de 1789.
L’« Exhortation aux hommes »
précède le texte de la Déclaration à proprement parler.
Elle vise à interpeller les
hommes sur leur comportement et les invite à le justifier s’ils en sont capables.
Lecture
Annonce de la problématique et des mouvements
En quoi cette exhortation prend-elle la forme d’un discours polémique ?
Le premier mouvement, du titre à la fin du premier paragraphe,
correspond à la mise en accusation des hommes, responsables des
inégalités entre les sexes.
Puis, Olympe de Gouges, dans un deuxième
mouvement, de la ligne 8 à 14, démontre la légitimité de son combat dans
une démarche didactique et scientifique précise reposant sur l’observation
de la nature.
Elle se focalise enfin, dans le dernier paragraphe, sur
l’homme, despote tyrannique, monstrueux.
Analyse
Le premier mouvement met en accusation les hommes responsables des
inégalités entre les sexes.
L’« exhortation » est un appel.
Ici, Olympe de
Gouges apostrophe tous les hommes dès la première ligne par le singulier
« Homme » a une valeur généralisante.
Son apostrophe introduit sa mise en
accusation : « Homme, es-tu capable d’être juste ? » L’emploi du terme
« capable » donne un ton provocateur à la question.
La tonalité du texte est
d’emblée polémique.
Le sens de la justice des hommes est ainsi remis en
question et Olympe de Gouges met en place son combat sous le signe de la
justice.
Par « c’est une femme qui t’en fait la question », l’auteure se fait le
porte-parole des femmes.
Elle tutoie son interlocuteur dans une stratégie
argumentative.
De cette manière, un rapprochement entre eux est créé et
leurs différences sont gommées.
L’accusation est explicitée ensuite par « tu
ne lui ôteras pas du moins ce droit.
» Ainsi, Olympe de Gouges use de son
droit d’expression quand d’autres ont été confisqués aux femmes par les
hommes.
Elle se place sur le plan juridique avec le terme « droit ».
L’homme
est responsable des inégalités entre les sexes.
Cette accusation est renforcée
par une série de questions rhétoriques : « Dis-moi ? qui t’a donné le
souverain empire d’opprimer mon sexe ? ta force ? tes talents ? » Portant
implicitement en elles les réponses, elles sont multipliées pour montrer que
l’oppression exercée par les hommes sur les femmes est sans fondement
légitime.
Les hommes usent d’un pouvoir despotique, mis en évidence par le
champ lexical du pouvoir absolu associé à des expressions péjoratives :
« souverain empire d’opprimer » et « cet empire tyrannique ».
L’adjectif
« tyrannique » met en exergue l’injustice et la violence de ce pouvoir.
Parallèlement, Olympe de Gouges, avec l’impératif présent « Dis-moi », met
au défi les hommes de trouver des raisons valables qui justifient la
confiscation de la liberté des femmes.
L’injonction induite inverse le rapport
de forces : Olympe de Gouges commande aux hommes.
Elle leur demande
d’« observe[r] le créateur dans sa sagesse, [de] parcour[ir] la nature dans
toute sa grandeur » pour y trouver un exemple d’oppression semblable à celle
qu’ils exercent sur les femmes.
L’incise provocatrice « si tu l’oses » indique
que la recherche est vaine.
L’homme ne suit donc pas l’exemple de Dieu,
créateur de la nature, qui a voulu l’égalité entre les hommes et les femmes.
La nature est caractérisée de manière méliorative par l’emploi de l’hyperbole
« dans toute sa grandeur ».
Olympe de Gouges s’inscrit ainsi pleinement dans
le courant philosophique des Lumières qui fait de la nature le fondement de
sa morale.
C’est de la nature que l’homme tient sa conscience du bien et du
mal.
Pour Olympe de Gouges, la nature est donc une entité supérieure, dont
l’homme « semble vouloir se rapprocher ».
En....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Olympe de Gouges, explication linéaire 1 (exhortation aux hommes, l. 1 à 21 p. 23)
- analyse linéaire la ddfc postambule - Olympe de Gouges
- Analyse linéaire : Olympe de Gouges, DDFC (préambule)
- analyse linéaire olympe de gouge
- explication linéaire olympe de gouges exorde