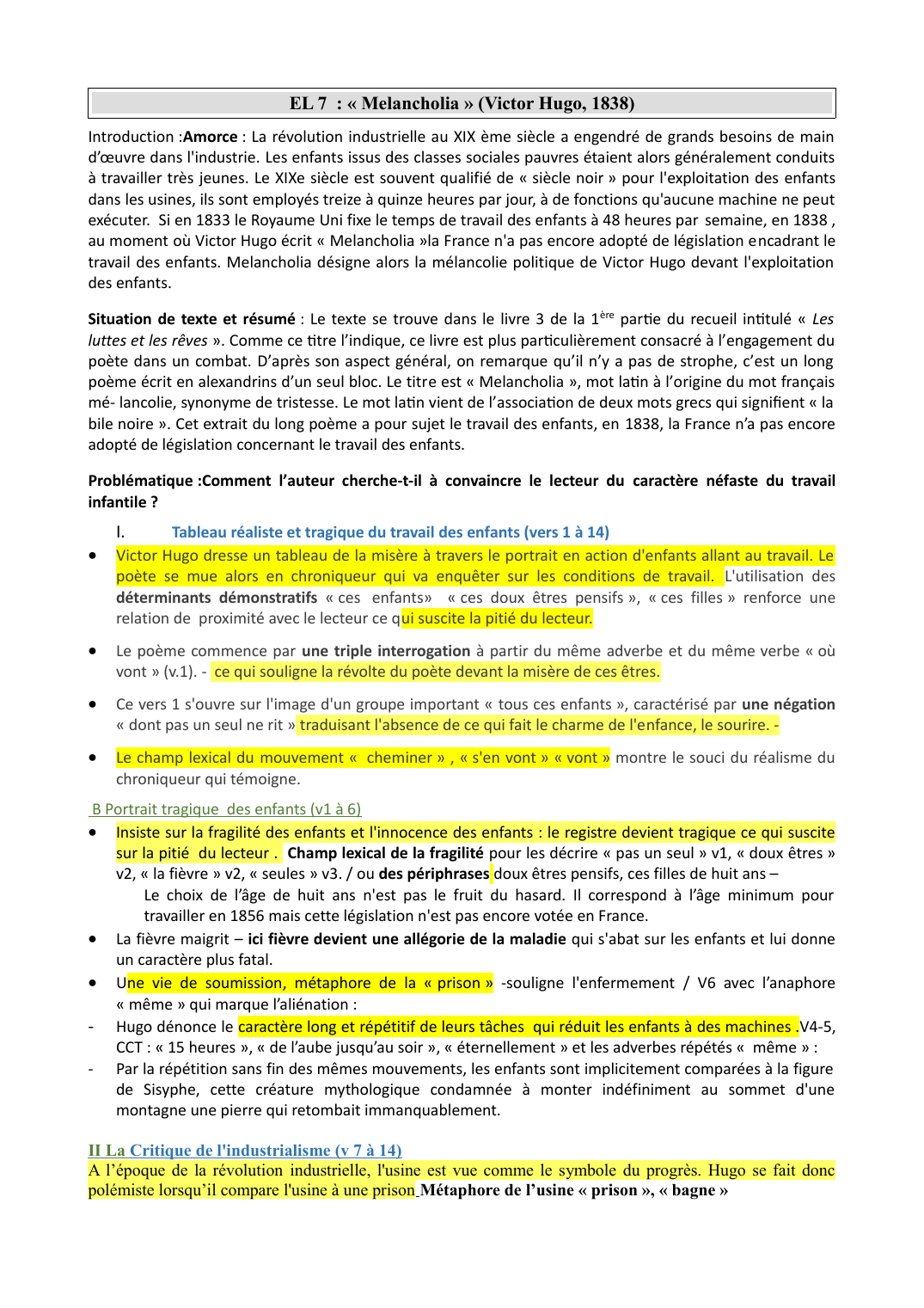Mélancholia de Victor Hugo
Publié le 15/02/2022

Extrait du document
«
EL 7 : « Melancholia » (Victor Hugo, 1838)
Introduction : Amorce : La révolution industrielle au XIX ème siècle a engendré de grands besoins de main
d’œuvre dans l'industrie.
Les enfants issus des classes sociales pauvres étaient alors généralement conduits
à travailler très jeunes.
Le XIXe siècle est souvent qualifié de « siècle noir » pour l'exploitation des enfants
dans les usines, ils sont employés treize à quinze heures par jour, à de fonctions qu'aucune machine ne peut
exécuter.
Si en 1833 le Royaume Uni fixe le temps de travail des enfants à 48 heures par semaine, en 1838 ,
au moment où Victor Hugo écrit « Melancholia »la France n'a pas encore adopté de législation e ncadrant le
travail des enfants.
Melancholia désigne alors la mélancolie politique de Victor Hugo devant l'exploitation
des enfants.
Situation de texte et résumé : Le texte se trouve dans le livre 3 de la 1 ère
partie du recueil intitulé « Les
luttes et les rêves ».
Comme ce titre l’indique, ce livre est plus particulièrement consacré à l’engagement du
poète dans un combat.
D’après son aspect général, on remarque qu’il n’y a pas de strophe, c’est un long
poème écrit en alexandrins d’un seul bloc.
Le titr e est « Melancholia », mot latin à l’origine du mot francais
mé- lancolie, synonyme de tristesse.
Le mot latin vient de l’association de deux mots grecs qui signifient « la
bile noire ».
Cet extrait du long poème a pour sujet le travail des enfants, en 1838, la France n’a pas encore
adopté de législation concernant le travail des enfants.
Problématique : Comment l’auteur cherche-t-il à convaincre le lecteur du caractère néfaste du travail
infantile ?
I.
Tableau réaliste et tragique du travail des enf ants (vers 1 à 14)
V ictor Hugo dresse un tableau de la misère à travers le portrait en action d'enfants allant au travail.
Le
poète se mue alors en chroniqueur qui va enquêter sur les conditions de travail.
L'utilisation des
déterminants démonstratifs « ces enfants» « ces doux êtres pensifs », « ces filles » renforce une
relation de proximité avec le lecteur ce q ui suscite la pitié du lecteur.
Le poème commence par une triple interrogation à partir du même adverbe et du même verbe « où
vont » (v.1) .
- ce qui souligne la révolte du poète devant la misère de ces êtres.
Ce vers 1 s'ouvre sur l'image d'un groupe important « tous ces enfants », caractérisé par une négation
« dont pas un seul ne rit » traduisant l'absence de ce qui fait le charme de l'e nfance, le sourire.
-
Le champ lexical du mouvement « cheminer » , « s'en vont » « vont » montre le souci du réalisme du
chroniqueur qui témoigne.
B Portrait tragique des enfants (v1 à 6)
Insiste sur la fragilité des enfants et l'innocence des enfants : le registre devient tragique ce qui suscite
sur la pitié du lecteur .
Champ lexical de la fragilité pour les décrire « pas un seul » v1, « doux êtres »
v2, « la fièvre » v2, « seules » v3.
/ ou des périphrases doux êtres pensifs, ces filles de huit ans –
Le choix de l’âge de huit ans n'est pas le fruit du hasard.
Il correspond à l’âge minimum pour
travailler en 1856 mais cette législation n'est pas encore votée en France.
La fièvre maigrit – ici fièvre devie nt une allégorie de la maladie qui s'abat sur les enfants et lui donne
un caractère plus fatal.
U ne vie de soumission, métaphore de la « prison » -souligne l'enfermement / V 6 avec l’anaphore
« même » qui marque l’aliénation :
- Hugo dénonce le caractère lo ng et répétitif de leurs tâches qui réduit les enfants à des machines .
V4-5,
CCT : « 15 heures », « de l’aube jusqu’au soir », « éternellement » et les adverbes répétés « même » :
- Par la répétition sans fin des mêmes mouvements, les enfants sont implicitement comparées à la figure
de Sisyphe, cette créature mythologique condamnée à monter indéfiniment au sommet d'une
montagne une pierre qui retombait immanquablement.
II La Critique de l'industrialisme (v 7 à 14)
A l’époque de la révolution industrielle, l'usine est vue comme le symbole du progrès.
Hugo se fait donc
polémiste lorsqu’il compare l'usine à une prison Métaphore de l’usine « prison », « bagne ».
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Victor Hugo, Les Contemplations - tome I “Autrefois”. 21e poème du livre premier intitulé “Aurore”
- Analyse linéaire du prologue de Lucrèce Borgia de Victor Hugo
- LAL Victor Hugo, Les Quatre Vents de l’esprit, 1881, « Écrit après la visite d’un bagne ».
- Victor Hugo, "J'aime l'araignée et j'aime l'ortie", Les Contemplations 1842
- Commentaire lineal CONTEMPLATIONS, VICTOR HUGO (1856), LIVRES I à IV TEXTE 1: "Vieille chanson du jeune temps", I, 19