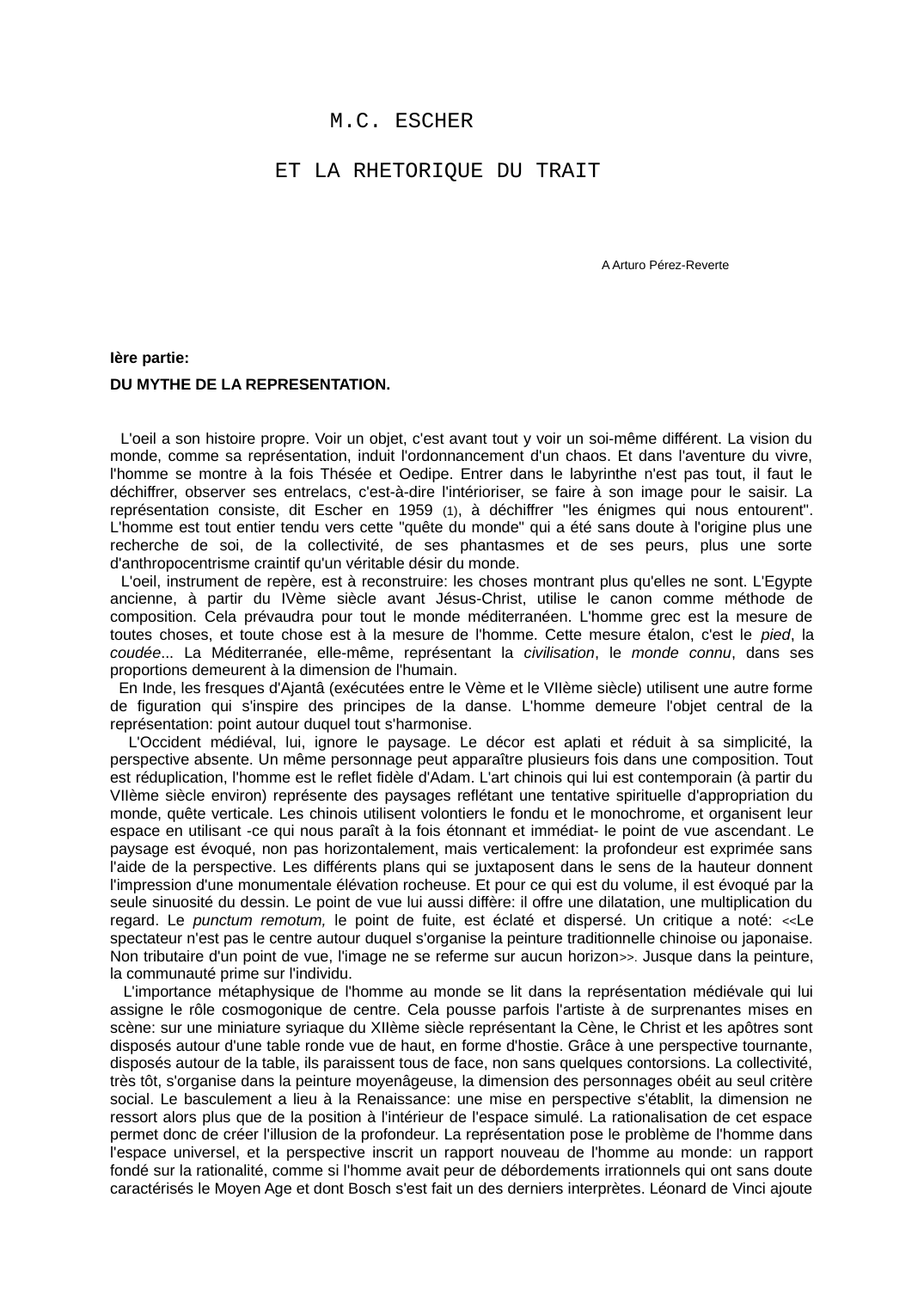M
Publié le 23/05/2020

Extrait du document
«
M.C.
ESCHER
ET LA RHETORIQUE DU TRAIT
A Arturo Pérez-Reverte
Ière partie:
DU MYTHE DE LA REPRESENTATION.
L'oeil a son histoire propre.
Voir un objet, c'est avant tout y voir un soi-même différent.
La vision du
monde, comme sa représentation, induit l'ordonnancement d'un chaos.
Et dans l'aventure du vivre,
l'homme se montre à la fois Thésée et Oedipe.
Entrer dans le labyrinthe n'est pas tout, il faut le
déchiffrer, observer ses entrelacs, c'est-à-dire l'intérioriser, se faire à son image pour le saisir.
La
représentation consiste, dit Escher en 1959 (1) , à déchiffrer "les énigmes qui nous entourent".
L'homme est tout entier tendu vers cette "quête du monde" qui a été sans doute à l'origine plus une
recherche de soi, de la collectivité, de ses phantasmes et de ses peurs, plus une sorte
d'anthropocentrisme craintif qu'un véritable désir du monde.
L'oeil, instrument de repère, est à reconstruire: les choses montrant plus qu'elles ne sont.
L'Egypte
ancienne, à partir du IVème siècle avant Jésus-Christ, utilise le canon comme méthode de
composition.
Cela prévaudra pour tout le monde méditerranéen.
L'homme grec est la mesure de
toutes choses, et toute chose est à la mesure de l'homme.
Cette mesure étalon, c'est le pied , la
coudée ...
La Méditerranée, elle-même, représentant la civilisation , le monde connu , dans ses
proportions demeurent à la dimension de l'humain.
En Inde, les fresques d'Ajantâ (exécutées entre le Vème et le VIIème siècle) utilisent une autre forme
de figuration qui s'inspire des principes de la danse.
L'homme demeure l'objet central de la
représentation: point autour duquel tout s'harmonise.
L'Occident médiéval, lui, ignore le paysage.
Le décor est aplati et réduit à sa simplicité, la
perspective absente.
Un même personnage peut apparaître plusieurs fois dans une composition.
Tout
est réduplication, l'homme est le reflet fidèle d'Adam.
L'art chinois qui lui est contemporain (à partir du
VIIème siècle environ) représente des paysages reflétant une tentative spirituelle d'appropriation du
monde, quête verticale.
Les chinois utilisent volontiers le fondu et le monochrome, et organisent leur
espace en utilisant -ce qui nous paraît à la fois étonnant et immédiat- le point de vue ascendant .
Le
paysage est évoqué, non pas horizontalement, mais verticalement: la profondeur est exprimée sans
l'aide de la perspective.
Les différents plans qui se juxtaposent dans le sens de la hauteur donnent
l'impression d'une monumentale élévation rocheuse.
Et pour ce qui est du volume, il est évoqué par la
seule sinuosité du dessin.
Le point de vue lui aussi diffère: il offre une dilatation, une multiplication du
regard.
Le punctum remotum, le point de fuite, est éclaté et dispersé.
Un critique a noté: >.
Jusque dans la peinture,
la communauté prime sur l'individu.
L'importance métaphysique de l'homme au monde se lit dans la représentation médiévale qui lui
assigne le rôle cosmogonique de centre.
Cela pousse parfois l'artiste à de surprenantes mises en
scène: sur une miniature syriaque du XIIème siècle représentant la Cène, le Christ et les apôtres sont
disposés autour d'une table ronde vue de haut, en forme d'hostie.
Grâce à une perspective tournante,
disposés autour de la table, ils paraissent tous de face, non sans quelques contorsions.
La collectivité,
très tôt, s'organise dans la peinture moyenâgeuse, la dimension des personnages obéit au seul critère
social.
Le basculement a lieu à la Renaissance: une mise en perspective s'établit, la dimension ne
ressort alors plus que de la position à l'intérieur de l'espace simulé.
La rationalisation de cet espace
permet donc de créer l'illusion de la profondeur.
La représentation pose le problème de l'homme dans
l'espace universel, et la perspective inscrit un rapport nouveau de l'homme au monde: un rapport
fondé sur la rationalité, comme si l'homme avait peur de débordements irrationnels qui ont sans doute
caractérisés le Moyen Age et dont Bosch s'est fait un des derniers interprètes.
Léonard de Vinci ajoute.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓