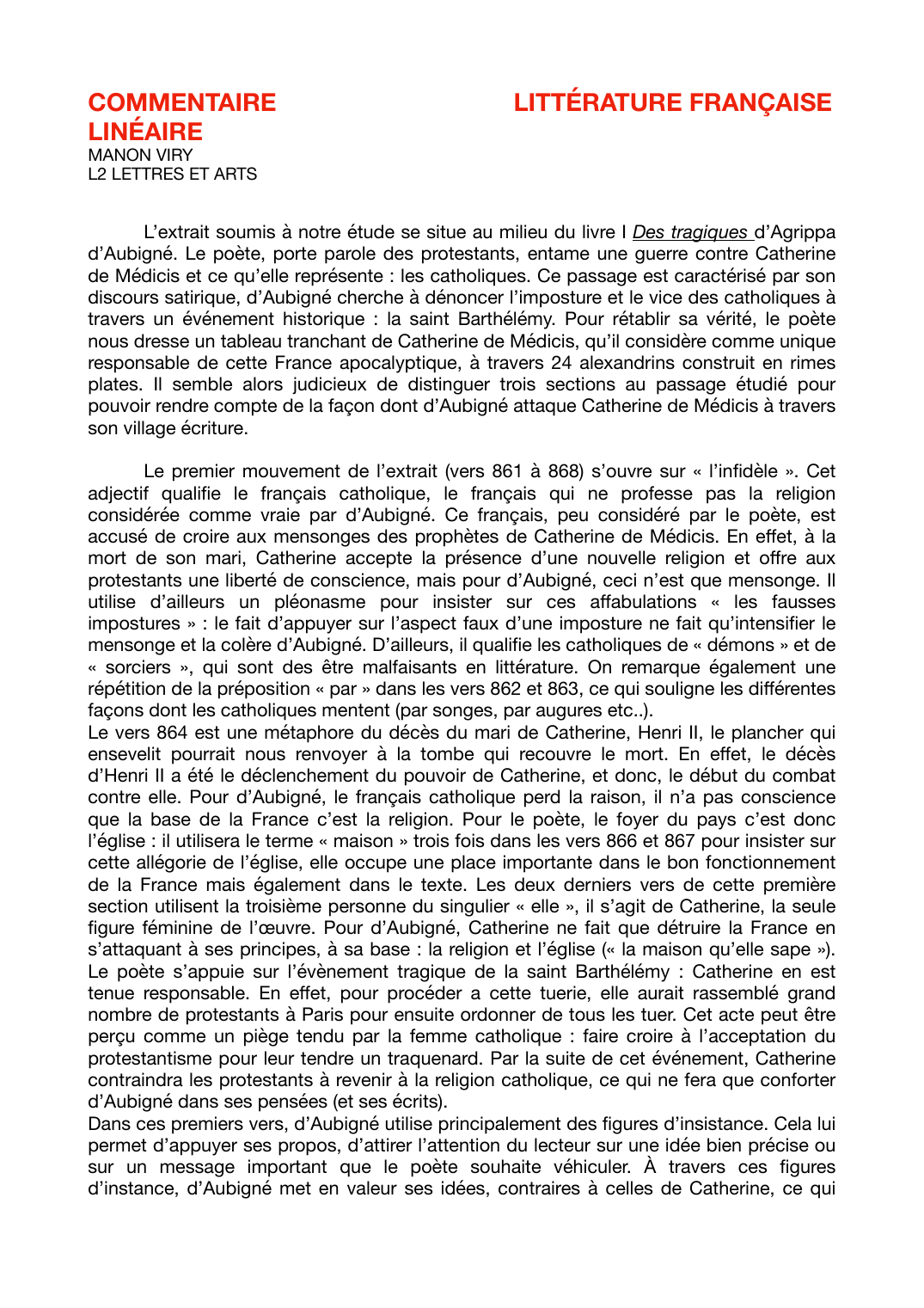Les tragiques d’Agrippa d’Aubigné: Catherine de Médicis
Publié le 19/01/2021

Extrait du document
Général et homme politique romain. Fidèle compagnon de lutte et conseiller d'Octave (futur Auguste), vainqueur aux batailles de Nauloque (36) et d'Actium (31), il déconseilla à Auguste d'établir le principat et lui suggéra vainement de rétablir la république. S'étant montré irrité de la faveur témoignée par l'empereur à son neveu C. Marcellus, il fut éloigné par une mission en Orient, mais, après la mort de Marcellus (23), ce fut à lui que songea Auguste pour assurer sa succession. Rappelé en Italie, il dut divorcer pour épouser Julie, fille d'Auguste et veuve de Marcellus (21). Ses deux premiers fils, Caius et Lucius César, furent adoptés dès leur naissance par leur grand-père Auguste. Mais Agrippa et ses deux enfants moururent avant Auguste, ce qui permit l'ascension de Tibère. Son troisième fils, Agrippa Posthume, fut exécuté au début du règne de Tibère. Sa fille, Agrippine l'Aînée, épousa Germanicus. Protecteur des sciences et des arts, Agrippa fut le grand urbaniste de la Rome d'Auguste, où il fit construire le Panthéon (refait plus tard par Hadrien), plusieurs autres temples, des thermes, des théâtres, des portiques, des aqueducs.
«
COMMENTAIR E LITTRATURE FRANAISE LINAIRE MANON VIRY
L2 LETTRES ET ARTS
LÕextrait soumis notre tude se situe au milieu du livre I Des tragiques dÕAgrippa dÕAubign.
Le pote, porte parole des protestants, entame une guerre contre Catherine de Mdicis et ce quÕelle reprsente : les catholiques.
Ce passage est caractris par son discours satirique, dÕAubign cherche dnoncer lÕimposture et le vice des catholiques travers un vnement historique : la saint Barthlmy.
Pour rtablir sa vrit, le pote nous dresse un tableau tranchant de Catherine de Mdicis, quÕil considre comme unique responsable de cette France apocalyptique, travers 24 alexandrins construit en rimes plates.
Il semble alors judicieux de distinguer trois sections au passage tudi pour pouvoir rendre compte de la faon dont dÕAubign attaque Catherine de Mdicis travers son village criture.
Le premier mouvement de lÕextrait (vers 861 868) sÕouvre sur Ç lÕin Þdle È.
Cet adjectif quali Þe le franais catholique, le franais qui ne professe pas la religion considre comme vraie par dÕAubign.
Ce franais, peu considr par le pote, est accus de croire aux mensonges des prophtes de Catherine de Mdicis.
En e ffet, la mort de son mari, Catherine accepte la prsence dÕune nouvelle religion et o ffre aux protestants une libert de conscience, mais pour dÕAubign, ceci nÕest que mensonge.
Il utilise dÕailleurs un plonasme pour insister sur ces a ffabulations Ç les fausses impostures È : le fait dÕappuyer sur lÕaspect faux dÕune imposture ne fait quÕintensi Þer le mensonge et la colre dÕAubign.
DÕailleurs, il quali Þe les catholiques de Ç dmons È et de Ç sorciers È, qui sont des tre malfaisants en littrature.
On remarque galement une rptition de la prposition Ç par È dans les vers 862 et 863, ce qui souligne les di ffrentes faons dont les catholiques mentent (par songes, par augures etc..).
Le vers 864 est une mtaphore du dcs du mari de Catherine, Henri II, le plancher qui ensevelit pourrait nous renvoyer la tombe qui recouvre le mort.
En e ffet, le dcs dÕHenri II a t le dclenchement du pouvoir de Catherine, et donc, le dbut du combat contre elle.
Pour dÕAubign, le franais catholique perd la raison, il nÕa pas conscience que la base de la France cÕest la religion.
Pour le pote, le foyer du pays cÕest donc lÕglise : il utilisera le terme Ç maison È trois fois dans les vers 866 et 867 pour insister sur cette allgorie de lÕglise, elle occupe une place importante dans le bon fonctionnement de la France mais galement dans le texte.
Les deux derniers vers de cette premire section utilisent la troisime personne du singulier Ç elle È, il sÕagit de Catherine, la seule Þgure fminine de lÕÏuvre.
Pour dÕAubign, Catherine ne fait que dtruire la France en sÕattaquant ses principes, sa base : la religion et lÕglise (Ç la maison quÕelle sape È).
Le pote sÕappuie sur lÕvnement tragique de la saint Barthlmy : Catherine en est tenue responsable.
En e ffet, pour procder a cette tuerie, elle aurait rassembl grand nombre de protestants Paris pour ensuite ordonner de tous les tuer.
Cet acte peut tre peru comme un pige tendu par la femme catholique : faire croire lÕacceptation du protestantisme pour leur tendre un traquenard.
Par la suite de cet vnement, Catherine contraindra les protestants revenir la religion catholique, ce qui ne fera que conforter dÕAubign dans ses penses (et ses crits).
Dans ces premiers vers, dÕAubign utilise principalement des Þgures dÕinsistance.
Cela lui permet dÕappuyer ses propos, dÕattirer lÕattention du lecteur sur une ide bien prcise ou sur un message important que le pote souhaite vhiculer.
Ë travers ces Þgures dÕinstance, dÕAubign met en valeur ses ides, contraires celles de Catherine, ce qui.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LES TRAGIQUES Livre Premier : Misères AGRIPPA D'AUBIGNÉ v. 1271-1300 (Explication littéraire)
- Les Tragiques d'Agrippa d'Aubigné (première édition en 1616) évoquent :a)
- Agrippa d'Aubigné : Les Tragiques
- Théodore Agrippa d'AUBIGNÉ, L'Hécatombe à Diane, « N'a doncques peu l'amour d'une mignarde rage ». Commentaire
- AGRIPPA D'AUBIGNÉ