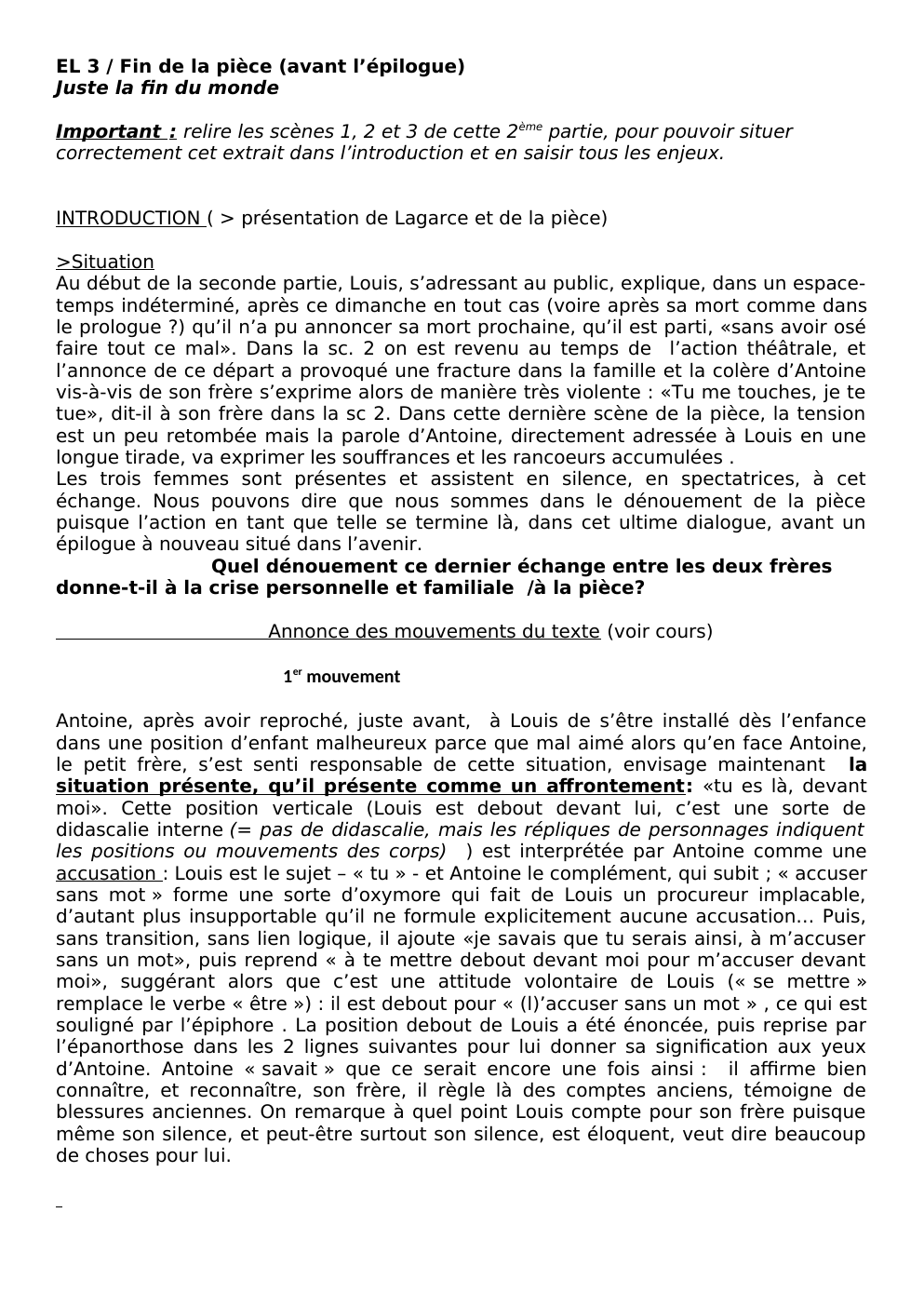Juste la fin du monde Scène 3 première partie
Publié le 13/02/2024
Extrait du document
«
EL 3 / Fin de la pièce (avant l’épilogue)
Juste la fin du monde
Important : relire les scènes 1, 2 et 3 de cette 2ème partie, pour pouvoir situer
correctement cet extrait dans l’introduction et en saisir tous les enjeux.
INTRODUCTION ( > présentation de Lagarce et de la pièce)
>Situation
Au début de la seconde partie, Louis, s’adressant au public, explique, dans un espacetemps indéterminé, après ce dimanche en tout cas (voire après sa mort comme dans
le prologue ?) qu’il n’a pu annoncer sa mort prochaine, qu’il est parti, «sans avoir osé
faire tout ce mal».
Dans la sc.
2 on est revenu au temps de l’action théâtrale, et
l’annonce de ce départ a provoqué une fracture dans la famille et la colère d’Antoine
vis-à-vis de son frère s’exprime alors de manière très violente : «Tu me touches, je te
tue», dit-il à son frère dans la sc 2.
Dans cette dernière scène de la pièce, la tension
est un peu retombée mais la parole d’Antoine, directement adressée à Louis en une
longue tirade, va exprimer les souffrances et les rancoeurs accumulées .
Les trois femmes sont présentes et assistent en silence, en spectatrices, à cet
échange.
Nous pouvons dire que nous sommes dans le dénouement de la pièce
puisque l’action en tant que telle se termine là, dans cet ultime dialogue, avant un
épilogue à nouveau situé dans l’avenir.
Quel dénouement ce dernier échange entre les deux frères
donne-t-il à la crise personnelle et familiale /à la pièce?
Annonce des mouvements du texte (voir cours)
1er mouvement
Antoine, après avoir reproché, juste avant, à Louis de s’être installé dès l’enfance
dans une position d’enfant malheureux parce que mal aimé alors qu’en face Antoine,
le petit frère, s’est senti responsable de cette situation, envisage maintenant la
situation présente, qu’il présente comme un affrontement: «tu es là, devant
moi».
Cette position verticale (Louis est debout devant lui, c’est une sorte de
didascalie interne (= pas de didascalie, mais les répliques de personnages indiquent
les positions ou mouvements des corps) ) est interprétée par Antoine comme une
accusation : Louis est le sujet – « tu » - et Antoine le complément, qui subit ; « accuser
sans mot » forme une sorte d’oxymore qui fait de Louis un procureur implacable,
d’autant plus insupportable qu’il ne formule explicitement aucune accusation… Puis,
sans transition, sans lien logique, il ajoute «je savais que tu serais ainsi, à m’accuser
sans un mot», puis reprend « à te mettre debout devant moi pour m’accuser devant
moi», suggérant alors que c’est une attitude volontaire de Louis (« se mettre »
remplace le verbe « être ») : il est debout pour « (l)’accuser sans un mot » , ce qui est
souligné par l’épiphore .
La position debout de Louis a été énoncée, puis reprise par
l’épanorthose dans les 2 lignes suivantes pour lui donner sa signification aux yeux
d’Antoine.
Antoine « savait » que ce serait encore une fois ainsi : il affirme bien
connaître, et reconnaître, son frère, il règle là des comptes anciens, témoigne de
blessures anciennes.
On remarque à quel point Louis compte pour son frère puisque
même son silence, et peut-être surtout son silence, est éloquent, veut dire beaucoup
de choses pour lui.
Ce qui frappe ensuite, c’est la confusion des sentiments qu’il cherche à expliciter,
à expliquer : en multipliant les répétitions de «et» (une sorte d’hyperbate), il
énumère, pêle-mêle, des sentiments d’une extrême variété : la compassion («Je te
plains»), qu’il amplifie ensuite en «pitié», mot répété deux fois avec insistance , puis
«la peur», «l’inquiétude» ,«la colère» et « le reproche » qu’il se fait à lui-même, une
forme de culpabilité.
Désordre des sentiments.
On perçoit que ces sentiments sont
complexes, et pourraient paraître contradictoires -« colère »contre son frère et
« reproche » contre lui-même par exemple ; il l’explicite d’ailleurs avec la concession
« malgré toute cette colère » – mais en réalité ils témoignent bien des noeuds
familiaux que révèle ce moment de crise familiale.
Ce mouvement se termine pourtant, comme le marque la pause typographique (= le
blanc typographique) sur le souci qu’a Antoine de son frère : ce souci est
développé, sur quelques lignes, contrairement aux autres sentiments et il « se
reproche déjà ( (il) n’es(t) pas encore parti ) le mal qu’(il lui) fait » : les mots blessent,
Antoine le sait bien.
Et la phrase « j’espère qu’il ne t’arrive rien de mal» résonne
singulièrement , grâce à la double énonciation, créant une forme d’ironie tragique
[1er niveau d’énonciation : les personnages se parlent ; 2ème
niveau : l’auteur
s’adresse au public ; grâce à la double énonciation, parfois le spectateur, qui a assisté
à toute la pièce, en sait plus , comprend plus que certains personnages.
= ici on sait
que Louis va mourir, pas Antoine).
Compte-tenu de la situation, Antoine aurait-il deviné, avec beaucoup de finesse, que
son frère est venu pour une mauvaise nouvelle, à l’approche de la mort ?.
Sinon,
simple bienveillance, expression de son affection, de la part d’Antoine (souci
protecteur hérité de l’enfance).
2ème mouvement
Ce début de deuxième mouvement reprend tout ce qu’Antoine avait jeté, pêle-mêle,
dans le mouvement précédent, en le précisant , comme si ce début fonctionnait
comme une longue épanorthose:
a) Il reprend , grâce à l’anaphore qui rythme sa tirade « Tu es là » en début de
tirade, et à nouveau associe cette position à une accusation de Louis.
Il répète
par deux fois «Tu m’accables» , qui est encore plus fort que « tu m’accuses »
(accabler = écraser par sa seule présence), qu’il élargit là encore en «tu nous
accables» (du « je » au « nous ») = comme si toute la famille souffrait depuis
longtemps de la manière d’être de Louis avec eux.
Comme s’il parlait ici au nom
de sa mère et de sa sœur, s’en faisait le porte-parole.
Il précise donc
l’accusation dont la famille se sent victime.
Il commente d’ailleurs : « tu m ‘accables, on ne peut plus dire ça », à rapprocher de
« la pitié, c’est un vieux mot», mais reprend pourtant ce même verbe, comme s’il ne
pouvait s’en empêcher, comme si les mots qu’il utilisait malgré lui avec son frère
manifestaient qu’il est toujours, face à lui, dans le passé.
Comme si il ne pouvait sortir
des rôles dans lesquels l’enfance les a enfermés, lui et son frère.
Des mots dépassés
et obsolètes.
b) ensuite il réaffirme et précise sa peur en évoquant une forme de panique et
de terreur profonde qu’il ne contrôle pas : «J’ai encore plus peur pour toi que
lorsque j’étais enfant».
Antoine encore prisonnier d’un rôle imposé dès
l’enfance… Encore une fois, sentirait-il son frère en danger ?
c) De même, il reprend son remords.
Il reprend finalement le schéma initial de
l’enfance : dévalorisation de ses propres émotions face à son frère, le seul à
connaître une vraie souffrance – alors que l’existence d’Antoine est « paisible et
douce » - le seul à être intelligent aussi, Antoine se voyant comme un « mauvais
imbécile », l’épithète « mauvais » connotant aussi la méchanceté, le mal par
opposition au bien, comme si cela s’ajoutait à sa supposée bêtise.
On constate encore la complexité des sentiments familiaux : « Je ne suis qu’un
mauvais imbécile qui se reproche déjà d’avoir failli se lamenter » : il se reproche
sincèrement de se plaindre alors que sa vie est facile et trnaquille, mais il sousentend peut-être qu’il souffre d’être dans le rôle de celui qui va bien, celui qui
n’est pas torturé – contrairement à Louis – et donc celui qui devrait « se
reprocher d’avoir failli se lamenter », comme si les schémas familiaux lui
interdisaient le droit à la souffrance, comme si seule la souffrance de son frère
était noble, et donc permise.
A l’opposé, Antoine affirme aussi la supériorité de Louis,
- toujours qualifié par son silence et sa générosité : l’expression est clairement
redondante (« silencieux, ô tellement silencieux » ), Antoine souffrant à la fois du
silence de son frère – qui pourrait être interprété comme de l’indifférence – et de sa
« générosité » qui fait apparaître Antoine comme encore plus mesquin.
L’expression
« bon, plein de bonté », elle aussi redondante, présente Louis comme un modèle
moral, représentant le bien absolu.
- Il présente finalement Louis comme une sorte de divinité, une sorte de Christ
souffrant très supérieur à tous : « alors que toi , silencieux, ô tellement silencieux, tu
attends, replié sur ton infinie douleur intérieure dont je ne saurais pas même imaginer
le début du début.
» : encore une fois auto-dépréciation : la souffrance de Louis est
« infinie », l’hyperbole lui donnant une grandeur évidente, une forme de noblesse
dont l ‘ « imbécile », terme, lui, fortement péjoratif, ne « saurai(t) pas même
imaginer le début du début » : par cette répétition hyperbolique, Antoine se déprécie
complètement....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Lecture Linaire n*3 Introduction : Juste la fin du monde Deuxième partie scène 3 « tu es là »
- O.E.2: Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle / E.O.I. Juste la fin du monde (1990) de Jean-Luc LAGARCE ORAL LECTURE LINÉAIRE n°7, extrait de la Première partie, scène 8 – LA MÈRE
- Jean Luc Lagarce, Juste la fin du monde (1990) 1999 Deuxième partie, scène 3
- Lecture linéaire Juste la fin du monde, scène 3, partie 1
- JUSTE LA FIN DU MONDE, JEAN LUC LAGARCE, ANALYSE LINÉAIRE SCÈNE 4, PARTIE I