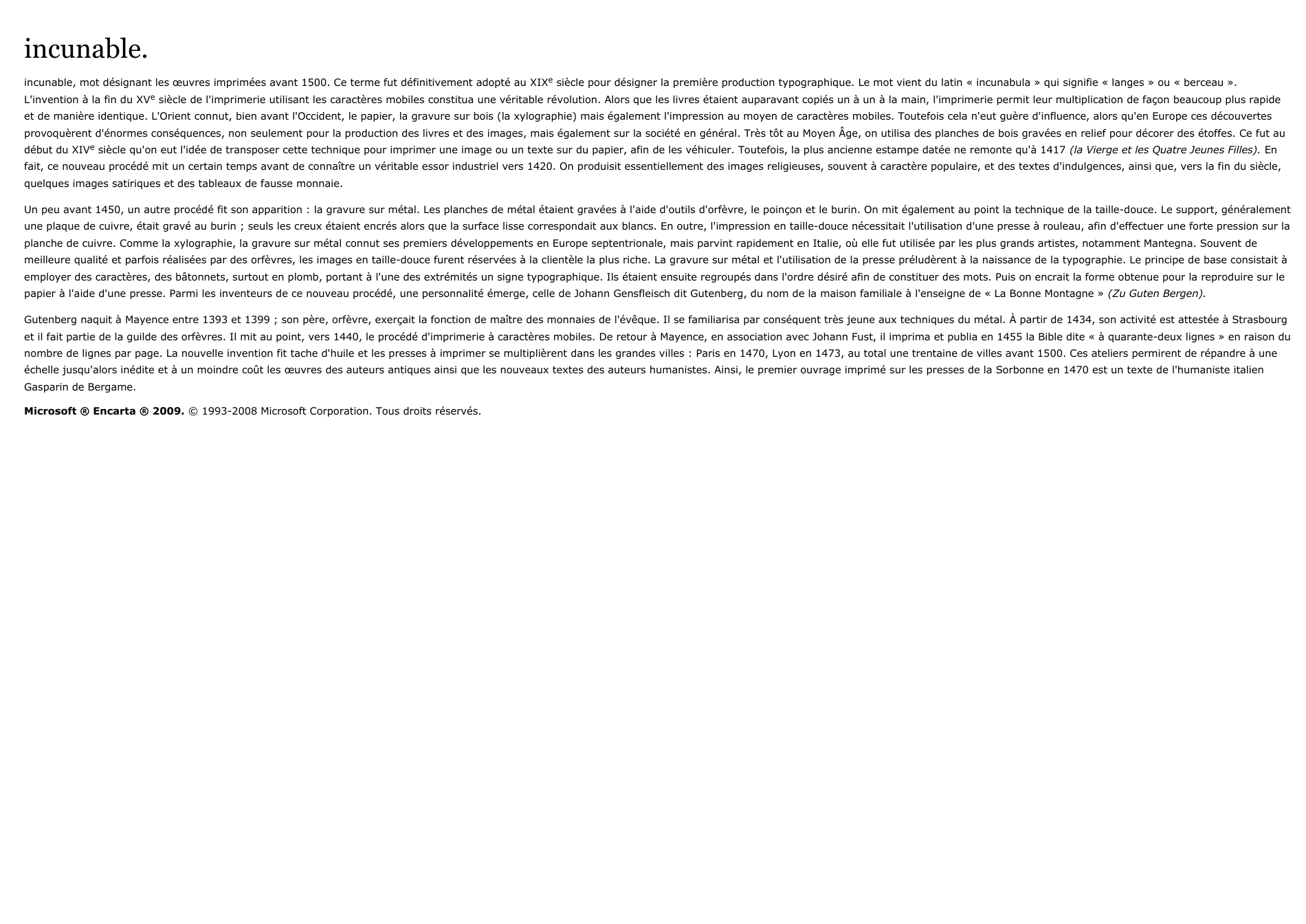incunable.
Publié le 06/12/2021

Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : incunable.. Ce document contient 657 mots. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système d’échange gratuit de ressources numériques ou achetez-le pour la modique somme d’un euro symbolique. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en : Echange
incunable.
incunable, mot désignant les oeuvres imprimées avant 1500. Ce terme fut définitivement adopté au XIXe siècle pour désigner la première production typographique. Le mot vient du latin « incunabula « qui signifie « langes « ou « berceau «.
L'invention à la fin du XVe siècle de l'imprimerie utilisant les caractères mobiles constitua une véritable révolution. Alors que les livres étaient auparavant copiés un à un à la main, l'imprimerie permit leur multiplication de façon beaucoup plus rapide
et de manière identique. L'Orient connut, bien avant l'Occident, le papier, la gravure sur bois (la xylographie) mais également l'impression au moyen de caractères mobiles. Toutefois cela n'eut guère d'influence, alors qu'en Europe ces découvertes
provoquèrent d'énormes conséquences, non seulement pour la production des livres et des images, mais également sur la société en général. Très tôt au Moyen Âge, on utilisa des planches de bois gravées en relief pour décorer des étoffes. Ce fut au
début du XIVe siècle qu'on eut l'idée de transposer cette technique pour imprimer une image ou un texte sur du papier, afin de les véhiculer. Toutefois, la plus ancienne estampe datée ne remonte qu'à 1417 (la Vierge et les Quatre Jeunes Filles). En
fait, ce nouveau procédé mit un certain temps avant de connaître un véritable essor industriel vers 1420. On produisit essentiellement des images religieuses, souvent à caractère populaire, et des textes d'indulgences, ainsi que, vers la fin du siècle,
quelques images satiriques et des tableaux de fausse monnaie.
Un peu avant 1450, un autre procédé fit son apparition : la gravure sur métal. Les planches de métal étaient gravées à l'aide d'outils d'orfèvre, le poinçon et le burin. On mit également au point la technique de la taille-douce. Le support, généralement
une plaque de cuivre, était gravé au burin ; seuls les creux étaient encrés alors que la surface lisse correspondait aux blancs. En outre, l'impression en taille-douce nécessitait l'utilisation d'une presse à rouleau, afin d'effectuer une forte pression sur la
planche de cuivre. Comme la xylographie, la gravure sur métal connut ses premiers développements en Europe septentrionale, mais parvint rapidement en Italie, où elle fut utilisée par les plus grands artistes, notamment Mantegna. Souvent de
meilleure qualité et parfois réalisées par des orfèvres, les images en taille-douce furent réservées à la clientèle la plus riche. La gravure sur métal et l'utilisation de la presse préludèrent à la naissance de la typographie. Le principe de base consistait à
employer des caractères, des bâtonnets, surtout en plomb, portant à l'une des extrémités un signe typographique. Ils étaient ensuite regroupés dans l'ordre désiré afin de constituer des mots. Puis on encrait la forme obtenue pour la reproduire sur le
papier à l'aide d'une presse. Parmi les inventeurs de ce nouveau procédé, une personnalité émerge, celle de Johann Gensfleisch dit Gutenberg, du nom de la maison familiale à l'enseigne de « La Bonne Montagne « (Zu Guten Bergen).
Gutenberg naquit à Mayence entre 1393 et 1399 ; son père, orfèvre, exerçait la fonction de maître des monnaies de l'évêque. Il se familiarisa par conséquent très jeune aux techniques du métal. À partir de 1434, son activité est attestée à Strasbourg
et il fait partie de la guilde des orfèvres. Il mit au point, vers 1440, le procédé d'imprimerie à caractères mobiles. De retour à Mayence, en association avec Johann Fust, il imprima et publia en 1455 la Bible dite « à quarante-deux lignes « en raison du
nombre de lignes par page. La nouvelle invention fit tache d'huile et les presses à imprimer se multiplièrent dans les grandes villes : Paris en 1470, Lyon en 1473, au total une trentaine de villes avant 1500. Ces ateliers permirent de répandre à une
échelle jusqu'alors inédite et à un moindre coût les oeuvres des auteurs antiques ainsi que les nouveaux textes des auteurs humanistes. Ainsi, le premier ouvrage imprimé sur les presses de la Sorbonne en 1470 est un texte de l'humaniste italien
Gasparin de Bergame.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
incunable.
incunable, mot désignant les oeuvres imprimées avant 1500. Ce terme fut définitivement adopté au XIXe siècle pour désigner la première production typographique. Le mot vient du latin « incunabula « qui signifie « langes « ou « berceau «.
L'invention à la fin du XVe siècle de l'imprimerie utilisant les caractères mobiles constitua une véritable révolution. Alors que les livres étaient auparavant copiés un à un à la main, l'imprimerie permit leur multiplication de façon beaucoup plus rapide
et de manière identique. L'Orient connut, bien avant l'Occident, le papier, la gravure sur bois (la xylographie) mais également l'impression au moyen de caractères mobiles. Toutefois cela n'eut guère d'influence, alors qu'en Europe ces découvertes
provoquèrent d'énormes conséquences, non seulement pour la production des livres et des images, mais également sur la société en général. Très tôt au Moyen Âge, on utilisa des planches de bois gravées en relief pour décorer des étoffes. Ce fut au
début du XIVe siècle qu'on eut l'idée de transposer cette technique pour imprimer une image ou un texte sur du papier, afin de les véhiculer. Toutefois, la plus ancienne estampe datée ne remonte qu'à 1417 (la Vierge et les Quatre Jeunes Filles). En
fait, ce nouveau procédé mit un certain temps avant de connaître un véritable essor industriel vers 1420. On produisit essentiellement des images religieuses, souvent à caractère populaire, et des textes d'indulgences, ainsi que, vers la fin du siècle,
quelques images satiriques et des tableaux de fausse monnaie.
Un peu avant 1450, un autre procédé fit son apparition : la gravure sur métal. Les planches de métal étaient gravées à l'aide d'outils d'orfèvre, le poinçon et le burin. On mit également au point la technique de la taille-douce. Le support, généralement
une plaque de cuivre, était gravé au burin ; seuls les creux étaient encrés alors que la surface lisse correspondait aux blancs. En outre, l'impression en taille-douce nécessitait l'utilisation d'une presse à rouleau, afin d'effectuer une forte pression sur la
planche de cuivre. Comme la xylographie, la gravure sur métal connut ses premiers développements en Europe septentrionale, mais parvint rapidement en Italie, où elle fut utilisée par les plus grands artistes, notamment Mantegna. Souvent de
meilleure qualité et parfois réalisées par des orfèvres, les images en taille-douce furent réservées à la clientèle la plus riche. La gravure sur métal et l'utilisation de la presse préludèrent à la naissance de la typographie. Le principe de base consistait à
employer des caractères, des bâtonnets, surtout en plomb, portant à l'une des extrémités un signe typographique. Ils étaient ensuite regroupés dans l'ordre désiré afin de constituer des mots. Puis on encrait la forme obtenue pour la reproduire sur le
papier à l'aide d'une presse. Parmi les inventeurs de ce nouveau procédé, une personnalité émerge, celle de Johann Gensfleisch dit Gutenberg, du nom de la maison familiale à l'enseigne de « La Bonne Montagne « (Zu Guten Bergen).
Gutenberg naquit à Mayence entre 1393 et 1399 ; son père, orfèvre, exerçait la fonction de maître des monnaies de l'évêque. Il se familiarisa par conséquent très jeune aux techniques du métal. À partir de 1434, son activité est attestée à Strasbourg
et il fait partie de la guilde des orfèvres. Il mit au point, vers 1440, le procédé d'imprimerie à caractères mobiles. De retour à Mayence, en association avec Johann Fust, il imprima et publia en 1455 la Bible dite « à quarante-deux lignes « en raison du
nombre de lignes par page. La nouvelle invention fit tache d'huile et les presses à imprimer se multiplièrent dans les grandes villes : Paris en 1470, Lyon en 1473, au total une trentaine de villes avant 1500. Ces ateliers permirent de répandre à une
échelle jusqu'alors inédite et à un moindre coût les oeuvres des auteurs antiques ainsi que les nouveaux textes des auteurs humanistes. Ainsi, le premier ouvrage imprimé sur les presses de la Sorbonne en 1470 est un texte de l'humaniste italien
Gasparin de Bergame.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓