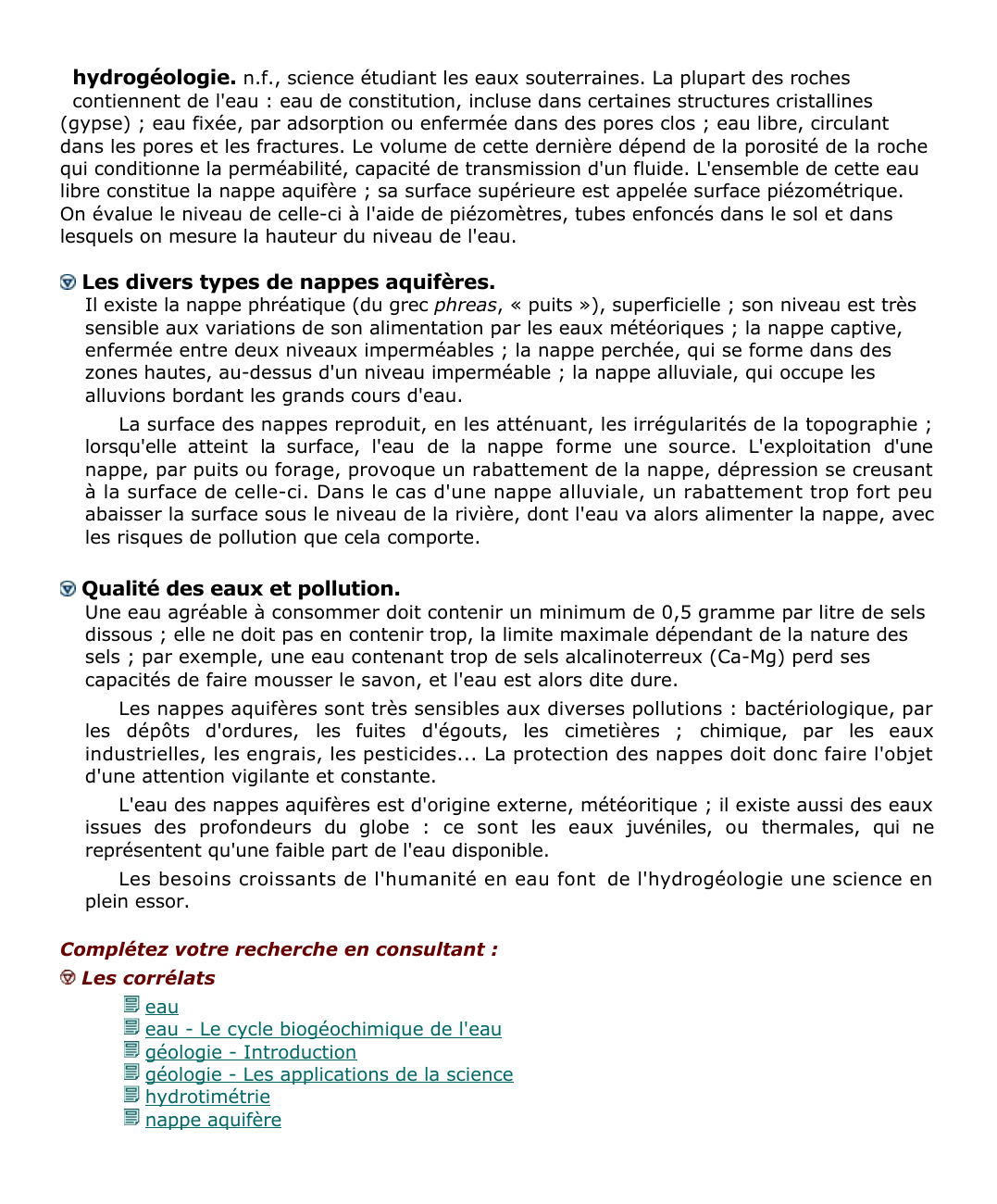hydrogéologie.
Publié le 08/12/2021

Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : hydrogéologie.. Ce document contient 427 mots. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système d’échange gratuit de ressources numériques ou achetez-le pour la modique somme d’un euro symbolique. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en : Encyclopédie
hydrogéologie. n.f., science étudiant les eaux souterraines. La plupart des roches
contiennent de l'eau : eau de constitution, incluse dans certaines structures cristallines
(gypse) ; eau fixée, par adsorption ou enfermée dans des pores clos ; eau libre, circulant
dans les pores et les fractures. Le volume de cette dernière dépend de la porosité de la roche
qui conditionne la perméabilité, capacité de transmission d'un fluide. L'ensemble de cette eau
libre constitue la nappe aquifère ; sa surface supérieure est appelée surface piézométrique.
On évalue le niveau de celle-ci à l'aide de piézomètres, tubes enfoncés dans le sol et dans
lesquels on mesure la hauteur du niveau de l'eau.
Les divers types de nappes aquifères.
Il existe la nappe phréatique (du grec phreas, « puits «), superficielle ; son niveau est très
sensible aux variations de son alimentation par les eaux météoriques ; la nappe captive,
enfermée entre deux niveaux imperméables ; la nappe perchée, qui se forme dans des
zones hautes, au-dessus d'un niveau imperméable ; la nappe alluviale, qui occupe les
alluvions bordant les grands cours d'eau.
La surface des nappes reproduit, en les atténuant, les irrégularités de la topographie ;
lorsqu'elle atteint la surface, l'eau de la nappe forme une source. L'exploitation d'une
nappe, par puits ou forage, provoque un rabattement de la nappe, dépression se creusant
à la surface de celle-ci. Dans le cas d'une nappe alluviale, un rabattement trop fort peu
abaisser la surface sous le niveau de la rivière, dont l'eau va alors alimenter la nappe, avec
les risques de pollution que cela comporte.
Qualité des eaux et pollution.
Une eau agréable à consommer doit contenir un minimum de 0,5 gramme par litre de sels
dissous ; elle ne doit pas en contenir trop, la limite maximale dépendant de la nature des
sels ; par exemple, une eau contenant trop de sels alcalinoterreux (Ca-Mg) perd ses
capacités de faire mousser le savon, et l'eau est alors dite dure.
Les nappes aquifères sont très sensibles aux diverses pollutions : bactériologique, par
les dépôts d'ordures, les fuites d'égouts, les cimetières ; chimique, par les eaux
industrielles, les engrais, les pesticides... La protection des nappes doit donc faire l'objet
d'une attention vigilante et constante.
L'eau des nappes aquifères est d'origine externe, météoritique ; il existe aussi des eaux
issues des profondeurs du globe : ce sont les eaux juvéniles, ou thermales, qui ne
représentent qu'une faible part de l'eau disponible.
Les besoins croissants de l'humanité en eau font de l'hydrogéologie une science en
plein essor.
Complétez votre recherche en consultant :
Les corrélats
eau
eau - Le cycle biogéochimique de l'eau
géologie - Introduction
géologie - Les applications de la science
hydrotimétrie
nappe aquifère
hydrogéologie. n.f., science étudiant les eaux souterraines. La plupart des roches
contiennent de l'eau : eau de constitution, incluse dans certaines structures cristallines
(gypse) ; eau fixée, par adsorption ou enfermée dans des pores clos ; eau libre, circulant
dans les pores et les fractures. Le volume de cette dernière dépend de la porosité de la roche
qui conditionne la perméabilité, capacité de transmission d'un fluide. L'ensemble de cette eau
libre constitue la nappe aquifère ; sa surface supérieure est appelée surface piézométrique.
On évalue le niveau de celle-ci à l'aide de piézomètres, tubes enfoncés dans le sol et dans
lesquels on mesure la hauteur du niveau de l'eau.
Les divers types de nappes aquifères.
Il existe la nappe phréatique (du grec phreas, « puits «), superficielle ; son niveau est très
sensible aux variations de son alimentation par les eaux météoriques ; la nappe captive,
enfermée entre deux niveaux imperméables ; la nappe perchée, qui se forme dans des
zones hautes, au-dessus d'un niveau imperméable ; la nappe alluviale, qui occupe les
alluvions bordant les grands cours d'eau.
La surface des nappes reproduit, en les atténuant, les irrégularités de la topographie ;
lorsqu'elle atteint la surface, l'eau de la nappe forme une source. L'exploitation d'une
nappe, par puits ou forage, provoque un rabattement de la nappe, dépression se creusant
à la surface de celle-ci. Dans le cas d'une nappe alluviale, un rabattement trop fort peu
abaisser la surface sous le niveau de la rivière, dont l'eau va alors alimenter la nappe, avec
les risques de pollution que cela comporte.
Qualité des eaux et pollution.
Une eau agréable à consommer doit contenir un minimum de 0,5 gramme par litre de sels
dissous ; elle ne doit pas en contenir trop, la limite maximale dépendant de la nature des
sels ; par exemple, une eau contenant trop de sels alcalinoterreux (Ca-Mg) perd ses
capacités de faire mousser le savon, et l'eau est alors dite dure.
Les nappes aquifères sont très sensibles aux diverses pollutions : bactériologique, par
les dépôts d'ordures, les fuites d'égouts, les cimetières ; chimique, par les eaux
industrielles, les engrais, les pesticides... La protection des nappes doit donc faire l'objet
d'une attention vigilante et constante.
L'eau des nappes aquifères est d'origine externe, météoritique ; il existe aussi des eaux
issues des profondeurs du globe : ce sont les eaux juvéniles, ou thermales, qui ne
représentent qu'une faible part de l'eau disponible.
Les besoins croissants de l'humanité en eau font de l'hydrogéologie une science en
plein essor.
Complétez votre recherche en consultant :
Les corrélats
eau
eau - Le cycle biogéochimique de l'eau
géologie - Introduction
géologie - Les applications de la science
hydrotimétrie
nappe aquifère
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓