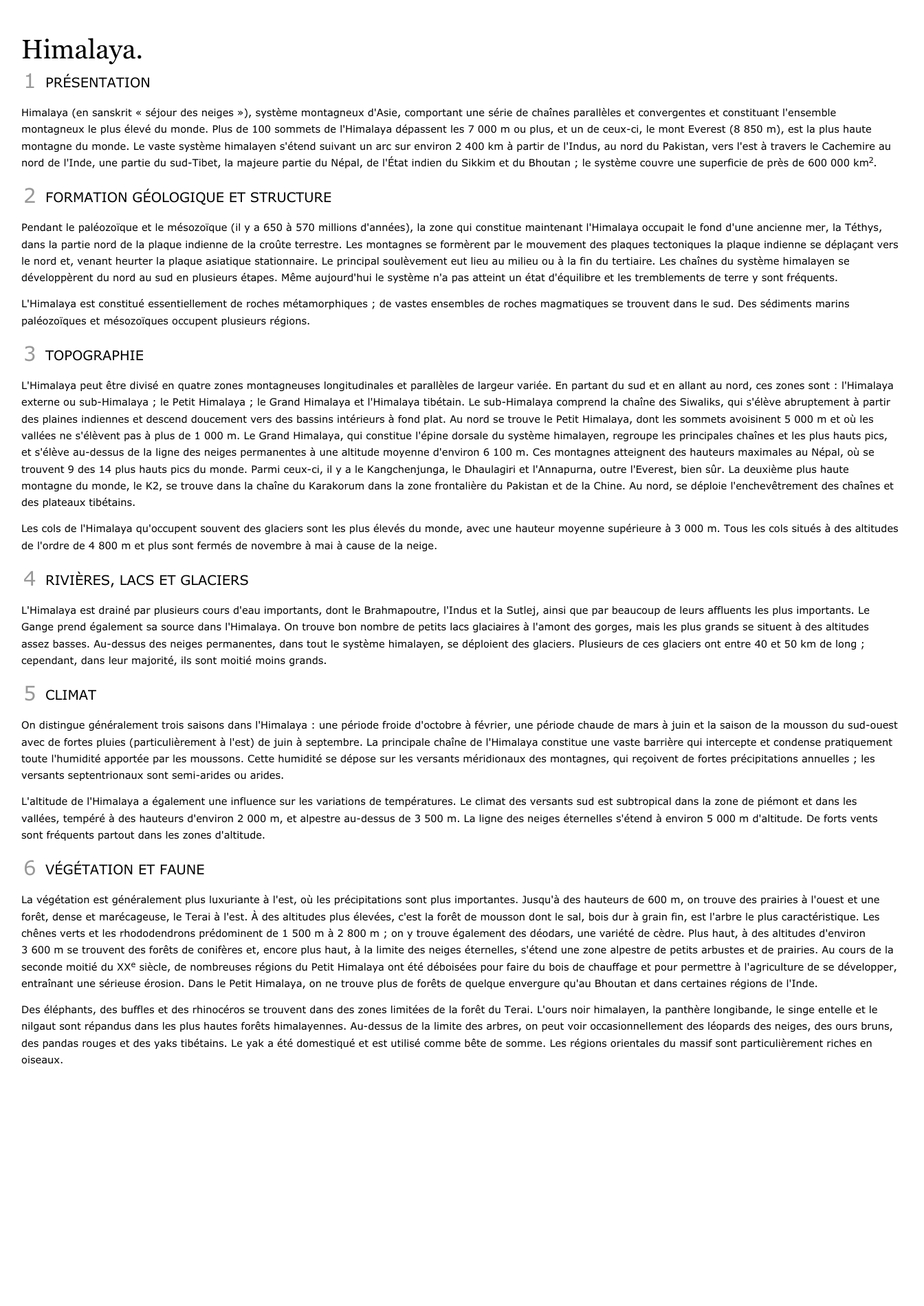Himalaya.
Publié le 06/12/2021

Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Himalaya.. Ce document contient 1018 mots. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système d’échange gratuit de ressources numériques ou achetez-le pour la modique somme d’un euro symbolique. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en : Echange
Himalaya.
1
PRÉSENTATION
Himalaya (en sanskrit « séjour des neiges «), système montagneux d'Asie, comportant une série de chaînes parallèles et convergentes et constituant l'ensemble
montagneux le plus élevé du monde. Plus de 100 sommets de l'Himalaya dépassent les 7 000 m ou plus, et un de ceux-ci, le mont Everest (8 850 m), est la plus haute
montagne du monde. Le vaste système himalayen s'étend suivant un arc sur environ 2 400 km à partir de l'Indus, au nord du Pakistan, vers l'est à travers le Cachemire au
nord de l'Inde, une partie du sud-Tibet, la majeure partie du Népal, de l'État indien du Sikkim et du Bhoutan ; le système couvre une superficie de près de 600 000 km2.
2
FORMATION GÉOLOGIQUE ET STRUCTURE
Pendant le paléozoïque et le mésozoïque (il y a 650 à 570 millions d'années), la zone qui constitue maintenant l'Himalaya occupait le fond d'une ancienne mer, la Téthys,
dans la partie nord de la plaque indienne de la croûte terrestre. Les montagnes se formèrent par le mouvement des plaques tectoniques la plaque indienne se déplaçant vers
le nord et, venant heurter la plaque asiatique stationnaire. Le principal soulèvement eut lieu au milieu ou à la fin du tertiaire. Les chaînes du système himalayen se
développèrent du nord au sud en plusieurs étapes. Même aujourd'hui le système n'a pas atteint un état d'équilibre et les tremblements de terre y sont fréquents.
L'Himalaya est constitué essentiellement de roches métamorphiques ; de vastes ensembles de roches magmatiques se trouvent dans le sud. Des sédiments marins
paléozoïques et mésozoïques occupent plusieurs régions.
3
TOPOGRAPHIE
L'Himalaya peut être divisé en quatre zones montagneuses longitudinales et parallèles de largeur variée. En partant du sud et en allant au nord, ces zones sont : l'Himalaya
externe ou sub-Himalaya ; le Petit Himalaya ; le Grand Himalaya et l'Himalaya tibétain. Le sub-Himalaya comprend la chaîne des Siwaliks, qui s'élève abruptement à partir
des plaines indiennes et descend doucement vers des bassins intérieurs à fond plat. Au nord se trouve le Petit Himalaya, dont les sommets avoisinent 5 000 m et où les
vallées ne s'élèvent pas à plus de 1 000 m. Le Grand Himalaya, qui constitue l'épine dorsale du système himalayen, regroupe les principales chaînes et les plus hauts pics,
et s'élève au-dessus de la ligne des neiges permanentes à une altitude moyenne d'environ 6 100 m. Ces montagnes atteignent des hauteurs maximales au Népal, où se
trouvent 9 des 14 plus hauts pics du monde. Parmi ceux-ci, il y a le Kangchenjunga, le Dhaulagiri et l'Annapurna, outre l'Everest, bien sûr. La deuxième plus haute
montagne du monde, le K2, se trouve dans la chaîne du Karakorum dans la zone frontalière du Pakistan et de la Chine. Au nord, se déploie l'enchevêtrement des chaînes et
des plateaux tibétains.
Les cols de l'Himalaya qu'occupent souvent des glaciers sont les plus élevés du monde, avec une hauteur moyenne supérieure à 3 000 m. Tous les cols situés à des altitudes
de l'ordre de 4 800 m et plus sont fermés de novembre à mai à cause de la neige.
4
RIVIÈRES, LACS ET GLACIERS
L'Himalaya est drainé par plusieurs cours d'eau importants, dont le Brahmapoutre, l'Indus et la Sutlej, ainsi que par beaucoup de leurs affluents les plus importants. Le
Gange prend également sa source dans l'Himalaya. On trouve bon nombre de petits lacs glaciaires à l'amont des gorges, mais les plus grands se situent à des altitudes
assez basses. Au-dessus des neiges permanentes, dans tout le système himalayen, se déploient des glaciers. Plusieurs de ces glaciers ont entre 40 et 50 km de long ;
cependant, dans leur majorité, ils sont moitié moins grands.
5
CLIMAT
On distingue généralement trois saisons dans l'Himalaya : une période froide d'octobre à février, une période chaude de mars à juin et la saison de la mousson du sud-ouest
avec de fortes pluies (particulièrement à l'est) de juin à septembre. La principale chaîne de l'Himalaya constitue une vaste barrière qui intercepte et condense pratiquement
toute l'humidité apportée par les moussons. Cette humidité se dépose sur les versants méridionaux des montagnes, qui reçoivent de fortes précipitations annuelles ; les
versants septentrionaux sont semi-arides ou arides.
L'altitude de l'Himalaya a également une influence sur les variations de températures. Le climat des versants sud est subtropical dans la zone de piémont et dans les
vallées, tempéré à des hauteurs d'environ 2 000 m, et alpestre au-dessus de 3 500 m. La ligne des neiges éternelles s'étend à environ 5 000 m d'altitude. De forts vents
sont fréquents partout dans les zones d'altitude.
6
VÉGÉTATION ET FAUNE
La végétation est généralement plus luxuriante à l'est, où les précipitations sont plus importantes. Jusqu'à des hauteurs de 600 m, on trouve des prairies à l'ouest et une
forêt, dense et marécageuse, le Terai à l'est. À des altitudes plus élevées, c'est la forêt de mousson dont le sal, bois dur à grain fin, est l'arbre le plus caractéristique. Les
chênes verts et les rhododendrons prédominent de 1 500 m à 2 800 m ; on y trouve également des déodars, une variété de cèdre. Plus haut, à des altitudes d'environ
3 600 m se trouvent des forêts de conifères et, encore plus haut, à la limite des neiges éternelles, s'étend une zone alpestre de petits arbustes et de prairies. Au cours de la
seconde moitié du XXe siècle, de nombreuses régions du Petit Himalaya ont été déboisées pour faire du bois de chauffage et pour permettre à l'agriculture de se développer,
entraînant une sérieuse érosion. Dans le Petit Himalaya, on ne trouve plus de forêts de quelque envergure qu'au Bhoutan et dans certaines régions de l'Inde.
Des éléphants, des buffles et des rhinocéros se trouvent dans des zones limitées de la forêt du Terai. L'ours noir himalayen, la panthère longibande, le singe entelle et le
nilgaut sont répandus dans les plus hautes forêts himalayennes. Au-dessus de la limite des arbres, on peut voir occasionnellement des léopards des neiges, des ours bruns,
des pandas rouges et des yaks tibétains. Le yak a été domestiqué et est utilisé comme bête de somme. Les régions orientales du massif sont particulièrement riches en
oiseaux.
Himalaya.
1
PRÉSENTATION
Himalaya (en sanskrit « séjour des neiges «), système montagneux d'Asie, comportant une série de chaînes parallèles et convergentes et constituant l'ensemble
montagneux le plus élevé du monde. Plus de 100 sommets de l'Himalaya dépassent les 7 000 m ou plus, et un de ceux-ci, le mont Everest (8 850 m), est la plus haute
montagne du monde. Le vaste système himalayen s'étend suivant un arc sur environ 2 400 km à partir de l'Indus, au nord du Pakistan, vers l'est à travers le Cachemire au
nord de l'Inde, une partie du sud-Tibet, la majeure partie du Népal, de l'État indien du Sikkim et du Bhoutan ; le système couvre une superficie de près de 600 000 km2.
2
FORMATION GÉOLOGIQUE ET STRUCTURE
Pendant le paléozoïque et le mésozoïque (il y a 650 à 570 millions d'années), la zone qui constitue maintenant l'Himalaya occupait le fond d'une ancienne mer, la Téthys,
dans la partie nord de la plaque indienne de la croûte terrestre. Les montagnes se formèrent par le mouvement des plaques tectoniques la plaque indienne se déplaçant vers
le nord et, venant heurter la plaque asiatique stationnaire. Le principal soulèvement eut lieu au milieu ou à la fin du tertiaire. Les chaînes du système himalayen se
développèrent du nord au sud en plusieurs étapes. Même aujourd'hui le système n'a pas atteint un état d'équilibre et les tremblements de terre y sont fréquents.
L'Himalaya est constitué essentiellement de roches métamorphiques ; de vastes ensembles de roches magmatiques se trouvent dans le sud. Des sédiments marins
paléozoïques et mésozoïques occupent plusieurs régions.
3
TOPOGRAPHIE
L'Himalaya peut être divisé en quatre zones montagneuses longitudinales et parallèles de largeur variée. En partant du sud et en allant au nord, ces zones sont : l'Himalaya
externe ou sub-Himalaya ; le Petit Himalaya ; le Grand Himalaya et l'Himalaya tibétain. Le sub-Himalaya comprend la chaîne des Siwaliks, qui s'élève abruptement à partir
des plaines indiennes et descend doucement vers des bassins intérieurs à fond plat. Au nord se trouve le Petit Himalaya, dont les sommets avoisinent 5 000 m et où les
vallées ne s'élèvent pas à plus de 1 000 m. Le Grand Himalaya, qui constitue l'épine dorsale du système himalayen, regroupe les principales chaînes et les plus hauts pics,
et s'élève au-dessus de la ligne des neiges permanentes à une altitude moyenne d'environ 6 100 m. Ces montagnes atteignent des hauteurs maximales au Népal, où se
trouvent 9 des 14 plus hauts pics du monde. Parmi ceux-ci, il y a le Kangchenjunga, le Dhaulagiri et l'Annapurna, outre l'Everest, bien sûr. La deuxième plus haute
montagne du monde, le K2, se trouve dans la chaîne du Karakorum dans la zone frontalière du Pakistan et de la Chine. Au nord, se déploie l'enchevêtrement des chaînes et
des plateaux tibétains.
Les cols de l'Himalaya qu'occupent souvent des glaciers sont les plus élevés du monde, avec une hauteur moyenne supérieure à 3 000 m. Tous les cols situés à des altitudes
de l'ordre de 4 800 m et plus sont fermés de novembre à mai à cause de la neige.
4
RIVIÈRES, LACS ET GLACIERS
L'Himalaya est drainé par plusieurs cours d'eau importants, dont le Brahmapoutre, l'Indus et la Sutlej, ainsi que par beaucoup de leurs affluents les plus importants. Le
Gange prend également sa source dans l'Himalaya. On trouve bon nombre de petits lacs glaciaires à l'amont des gorges, mais les plus grands se situent à des altitudes
assez basses. Au-dessus des neiges permanentes, dans tout le système himalayen, se déploient des glaciers. Plusieurs de ces glaciers ont entre 40 et 50 km de long ;
cependant, dans leur majorité, ils sont moitié moins grands.
5
CLIMAT
On distingue généralement trois saisons dans l'Himalaya : une période froide d'octobre à février, une période chaude de mars à juin et la saison de la mousson du sud-ouest
avec de fortes pluies (particulièrement à l'est) de juin à septembre. La principale chaîne de l'Himalaya constitue une vaste barrière qui intercepte et condense pratiquement
toute l'humidité apportée par les moussons. Cette humidité se dépose sur les versants méridionaux des montagnes, qui reçoivent de fortes précipitations annuelles ; les
versants septentrionaux sont semi-arides ou arides.
L'altitude de l'Himalaya a également une influence sur les variations de températures. Le climat des versants sud est subtropical dans la zone de piémont et dans les
vallées, tempéré à des hauteurs d'environ 2 000 m, et alpestre au-dessus de 3 500 m. La ligne des neiges éternelles s'étend à environ 5 000 m d'altitude. De forts vents
sont fréquents partout dans les zones d'altitude.
6
VÉGÉTATION ET FAUNE
La végétation est généralement plus luxuriante à l'est, où les précipitations sont plus importantes. Jusqu'à des hauteurs de 600 m, on trouve des prairies à l'ouest et une
forêt, dense et marécageuse, le Terai à l'est. À des altitudes plus élevées, c'est la forêt de mousson dont le sal, bois dur à grain fin, est l'arbre le plus caractéristique. Les
chênes verts et les rhododendrons prédominent de 1 500 m à 2 800 m ; on y trouve également des déodars, une variété de cèdre. Plus haut, à des altitudes d'environ
3 600 m se trouvent des forêts de conifères et, encore plus haut, à la limite des neiges éternelles, s'étend une zone alpestre de petits arbustes et de prairies. Au cours de la
seconde moitié du XXe siècle, de nombreuses régions du Petit Himalaya ont été déboisées pour faire du bois de chauffage et pour permettre à l'agriculture de se développer,
entraînant une sérieuse érosion. Dans le Petit Himalaya, on ne trouve plus de forêts de quelque envergure qu'au Bhoutan et dans certaines régions de l'Inde.
Des éléphants, des buffles et des rhinocéros se trouvent dans des zones limitées de la forêt du Terai. L'ours noir himalayen, la panthère longibande, le singe entelle et le
nilgaut sont répandus dans les plus hautes forêts himalayennes. Au-dessus de la limite des arbres, on peut voir occasionnellement des léopards des neiges, des ours bruns,
des pandas rouges et des yaks tibétains. Le yak a été domestiqué et est utilisé comme bête de somme. Les régions orientales du massif sont particulièrement riches en
oiseaux.
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Ours de l'Himalaya:Une réputation de férocité mal établie.
- Ours de l'Himalaya:Une réputation de férocité mal établie.