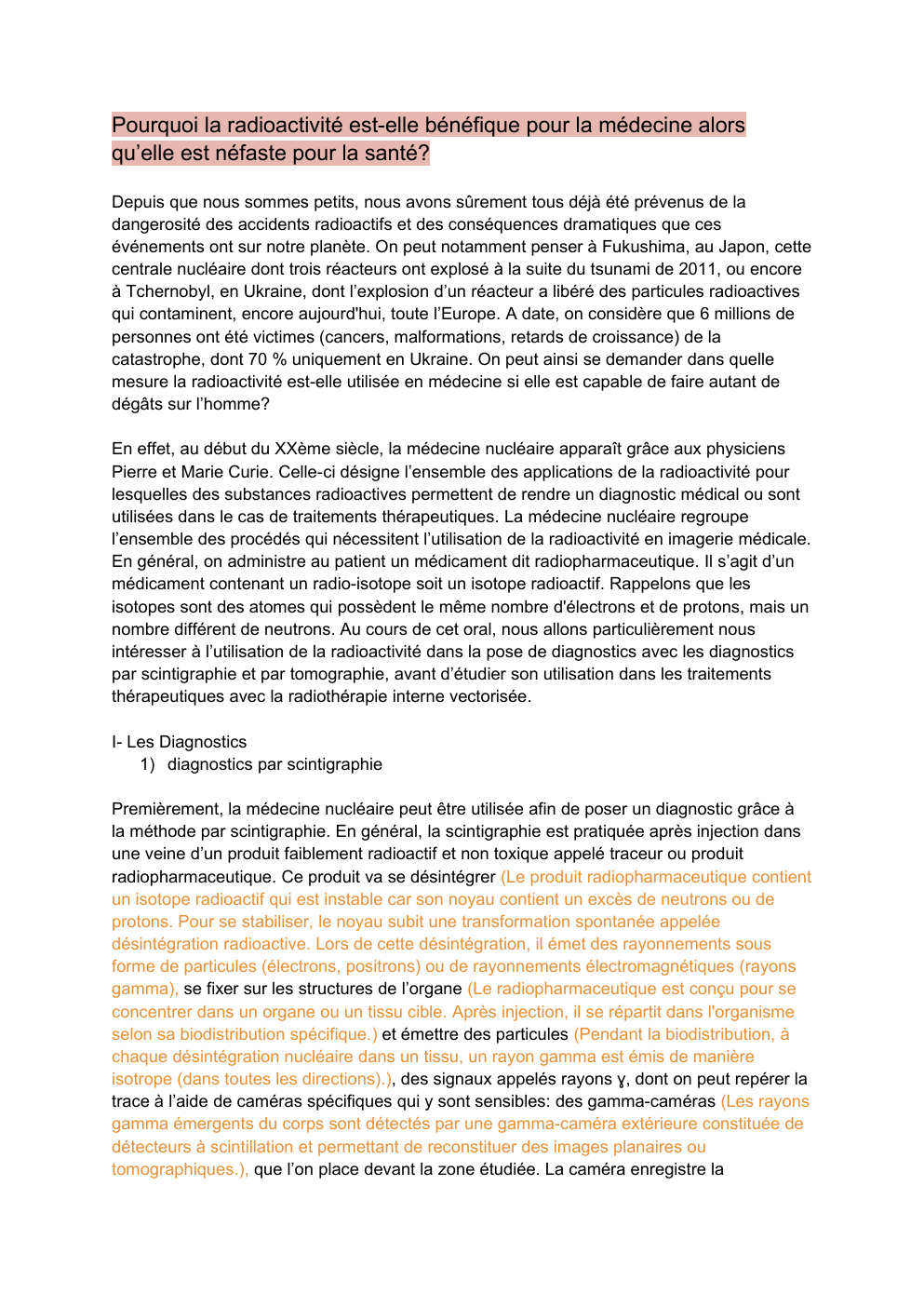Grand oral physique Pourquoi la radioactivité est-elle bénéfique pour la médecine alors qu’elle est néfaste pour la santé?
Publié le 20/06/2025
Extrait du document
«
Pourquoi la radioactivité est-elle bénéfique pour la médecine alors
qu’elle est néfaste pour la santé?
Depuis que nous sommes petits, nous avons sûrement tous déjà été prévenus de la
dangerosité des accidents radioactifs et des conséquences dramatiques que ces
événements ont sur notre planète.
On peut notamment penser à Fukushima, au Japon, cette
centrale nucléaire dont trois réacteurs ont explosé à la suite du tsunami de 2011, ou encore
à Tchernobyl, en Ukraine, dont l’explosion d’un réacteur a libéré des particules radioactives
qui contaminent, encore aujourd'hui, toute l’Europe.
A date, on considère que 6 millions de
personnes ont été victimes (cancers, malformations, retards de croissance) de la
catastrophe, dont 70 % uniquement en Ukraine.
On peut ainsi se demander dans quelle
mesure la radioactivité est-elle utilisée en médecine si elle est capable de faire autant de
dégâts sur l’homme?
En effet, au début du XXème siècle, la médecine nucléaire apparaît grâce aux physiciens
Pierre et Marie Curie.
Celle-ci désigne l’ensemble des applications de la radioactivité pour
lesquelles des substances radioactives permettent de rendre un diagnostic médical ou sont
utilisées dans le cas de traitements thérapeutiques.
La médecine nucléaire regroupe
l’ensemble des procédés qui nécessitent l’utilisation de la radioactivité en imagerie médicale.
En général, on administre au patient un médicament dit radiopharmaceutique.
Il s’agit d’un
médicament contenant un radio-isotope soit un isotope radioactif.
Rappelons que les
isotopes sont des atomes qui possèdent le même nombre d'électrons et de protons, mais un
nombre différent de neutrons.
Au cours de cet oral, nous allons particulièrement nous
intéresser à l’utilisation de la radioactivité dans la pose de diagnostics avec les diagnostics
par scintigraphie et par tomographie, avant d’étudier son utilisation dans les traitements
thérapeutiques avec la radiothérapie interne vectorisée.
I- Les Diagnostics
1) diagnostics par scintigraphie
Premièrement, la médecine nucléaire peut être utilisée afin de poser un diagnostic grâce à
la méthode par scintigraphie.
En général, la scintigraphie est pratiquée après injection dans
une veine d’un produit faiblement radioactif et non toxique appelé traceur ou produit
radiopharmaceutique.
Ce produit va se désintégrer (Le produit radiopharmaceutique contient
un isotope radioactif qui est instable car son noyau contient un excès de neutrons ou de
protons.
Pour se stabiliser, le noyau subit une transformation spontanée appelée
désintégration radioactive.
Lors de cette désintégration, il émet des rayonnements sous
forme de particules (électrons, positrons) ou de rayonnements électromagnétiques (rayons
gamma), se fixer sur les structures de l’organe (Le radiopharmaceutique est conçu pour se
concentrer dans un organe ou un tissu cible.
Après injection, il se répartit dans l'organisme
selon sa biodistribution spécifique.) et émettre des particules (Pendant la biodistribution, à
chaque désintégration nucléaire dans un tissu, un rayon gamma est émis de manière
isotrope (dans toutes les directions).), des signaux appelés rayons ɣ, dont on peut repérer la
trace à l’aide de caméras spécifiques qui y sont sensibles: des gamma-caméras (Les rayons
gamma émergents du corps sont détectés par une gamma-caméra extérieure constituée de
détecteurs à scintillation et permettant de reconstituer des images planaires ou
tomographiques.), que l’on place devant la zone étudiée.
La caméra enregistre la
concentration du produit radioactif dans les différentes parties de l’organe concerné.
Sur un
écran d’ordinateur relié à la caméra, on visualise ensuite la radioactivité présente dans le
corps du patient sous forme de points scintillant.
De cette façon, il est possible de visualiser
les tissus et les organes ciblés afin de donner un diagnostic précis sur l’état du patient.
En
effet, le nombre de points scintillants est plus important dans les zones dites d’hyperfixation.
On peut alors faire l’hypothèse d’un foyer infectieux, d’une tumeur, ou encore d’un
remaniement osseux.
A l’inverse, le nombre de points scintillants est moins important dans
les zones dites d’hypofixation.
On peut alors faire l’hypothèse de la présence d’un tissu
détruit ou mal irrigué par les vaisseaux sanguins.
La scintigraphie peut concerner par exemple les os, la thyroïde ou le cœur et la nature du
traceur diffère selon l’organe étudié.
Exemple: pour effectuer une scintigraphie thyroïdienne par exemple, on injecte le traceur
radioactif, ici l’iode 123.
En effet, l'iode étant un élément naturellement concentré par la
glande thyroïde, l'iode-123 se fixe préférentiellement dans la thyroïde, permettant de
visualiser sa forme, sa taille et son fonctionnement à l'aide des images scintigraphiques.
Celui-ci se fixe sur les cellules thyroïdiennes de façon plus ou moins importante et se
désintègre en émettant des particules β- et ɣ permettant de visualiser des zones
d’hyperfixation «zones chaudes» et des zones d’hypofixation «zones froides» à travers une
caméra sensible aux rayonnements ɣ.
L'équation de réaction de désintégration de l'iode-123
est la suivante :
⁵³123I → ⁵ 123Te* + β⁻
Où :
- ⁵³123I représente le noyau d'iode-123 (isotope parent radioactif)
- ⁵³123Te* représente le noyau de tellure-123 dans un état excité (isotope fils)
- β⁻ représente l'électron émis (particule bêta moins)
Ensuite, le noyau de tellure-123 excité se désexcite rapidement en émettant des rayons
gamma selon l'équation :
⁵ 123Te* → ⁵ 123Te + γ (159 kilo électronVolt)
Ce sont ces rayons gamma de 159 keV émis par l'iode-123 qui sont détectés par la gammacaméra lors de la scintigraphie thyroïdienne.
2) diagnostics par tomographie par émission de positons (TEP)
Il existe également une méthode par scintigraphie que l’on appelle la tomographie par
émission de positons (TEP).
Il s’agit d’une méthode d’imagerie médicale permettant de
mesurer en trois dimensions l’activité métabolique ou moléculaire d’un organe particulier
grâce aux émissions produites par les positons issus de la désintégration d’un produit
radioactif préalablement injecté.
En effet, on injecte d’abord au patient un produit
radiopharmaceutique, qui est un composé chimique couplé à un isotope radioactif émetteur
de rayons gamma fixé à une substance du corps, habituellement un sucre (glucose).
Ce
radiotraceur se concentre et s’accumule de manière préférentielle dans l'organe ou la région
d'intérêt, notamment dans les cellules qui consomment beaucoup d’énergie, comme les
cellules cancéreuses.
Une fois injecté, l’atome radioactif (carbone, fluor, azote, oxygène ou
autre) émet une minuscule particule chargée positivement (positon): β+.
Celle-ci va se
désintégrer avec un électron et produire deux photons ɣ.
Le patient est ensuite placé dans
un système d'imagerie TEP, qui est composé de un ou plusieurs détecteurs ɣ sensibles aux
rayons ɣ émis par le radiotraceur.
Ces détecteurs tournent autour du patient, capturant les
rayons ɣ sous....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Grand oral chimie: : Dans quelles mesures la radioactivité est-elle utilisée en médecine nucléaire ?
- Grand Oral de Physique-Chimie : Améliorer les Imageries par Résonance Magnétique (IRM)
- Sujet Grand Oral Physique : Comment la physique a-t-elle contribué à l’évolution de l'aviation ?
- grand oral : physique : comment les loi de newton entre elle en compte dans un atterrissage sur mars,
- grand oral physique: L'eau est une ressource vitale pour l'homme