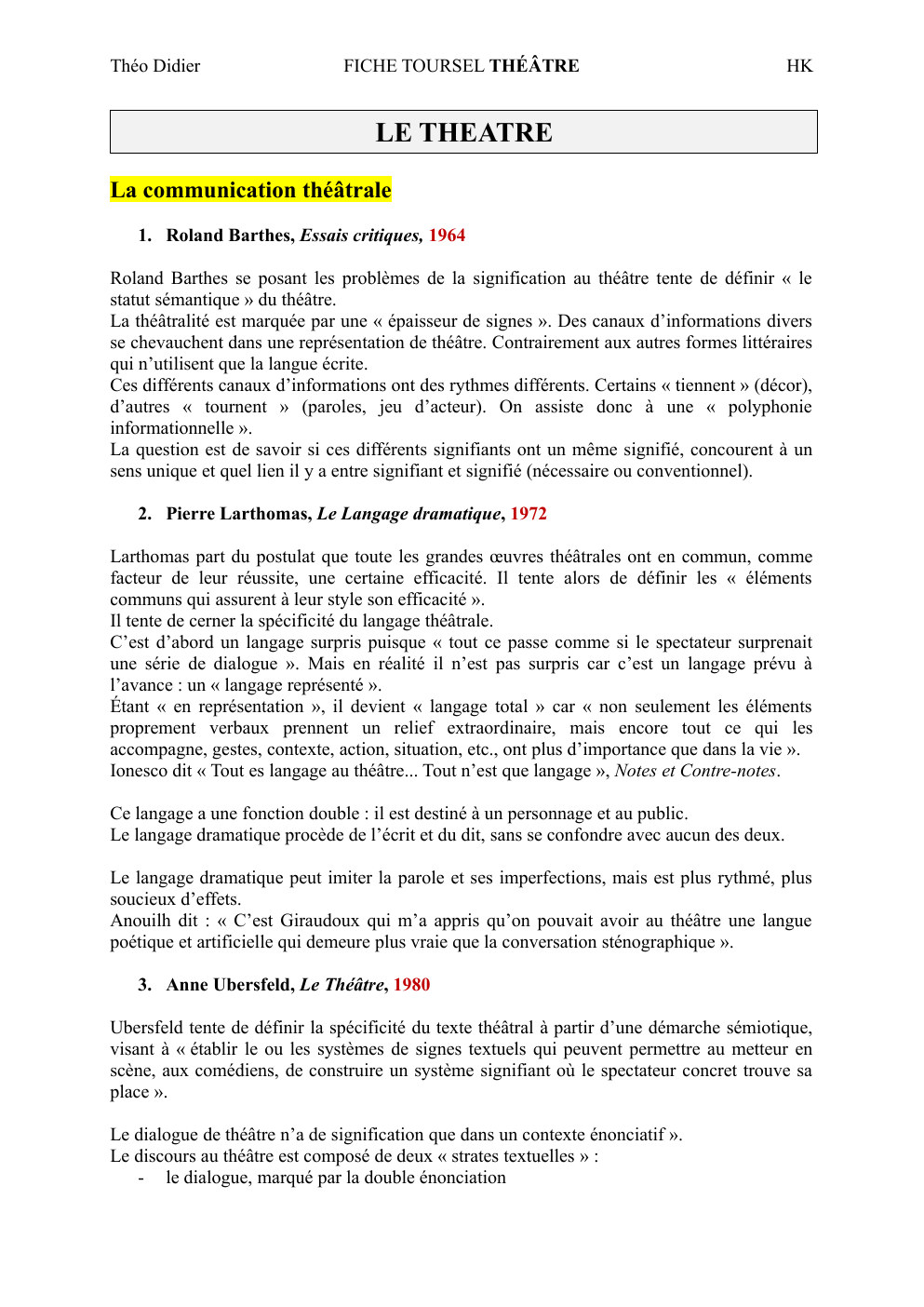Fiche du Toursel et Vassevière sur le THÉÂTRE
Publié le 01/01/2024
Extrait du document
«
Théo Didier
FICHE TOURSEL THÉÂTRE
HK
LE THEATRE
La communication théâtrale
1.
Roland Barthes, Essais critiques, 1964
Roland Barthes se posant les problèmes de la signification au théâtre tente de définir « le
statut sémantique » du théâtre.
La théâtralité est marquée par une « épaisseur de signes ».
Des canaux d’informations divers
se chevauchent dans une représentation de théâtre.
Contrairement aux autres formes littéraires
qui n’utilisent que la langue écrite.
Ces différents canaux d’informations ont des rythmes différents.
Certains « tiennent » (décor),
d’autres « tournent » (paroles, jeu d’acteur).
On assiste donc à une « polyphonie
informationnelle ».
La question est de savoir si ces différents signifiants ont un même signifié, concourent à un
sens unique et quel lien il y a entre signifiant et signifié (nécessaire ou conventionnel).
2.
Pierre Larthomas, Le Langage dramatique, 1972
Larthomas part du postulat que toute les grandes œuvres théâtrales ont en commun, comme
facteur de leur réussite, une certaine efficacité.
Il tente alors de définir les « éléments
communs qui assurent à leur style son efficacité ».
Il tente de cerner la spécificité du langage théâtrale.
C’est d’abord un langage surpris puisque « tout ce passe comme si le spectateur surprenait
une série de dialogue ».
Mais en réalité il n’est pas surpris car c’est un langage prévu à
l’avance : un « langage représenté ».
Étant « en représentation », il devient « langage total » car « non seulement les éléments
proprement verbaux prennent un relief extraordinaire, mais encore tout ce qui les
accompagne, gestes, contexte, action, situation, etc., ont plus d’importance que dans la vie ».
Ionesco dit « Tout es langage au théâtre...
Tout n’est que langage », Notes et Contre-notes.
Ce langage a une fonction double : il est destiné à un personnage et au public.
Le langage dramatique procède de l’écrit et du dit, sans se confondre avec aucun des deux.
Le langage dramatique peut imiter la parole et ses imperfections, mais est plus rythmé, plus
soucieux d’effets.
Anouilh dit : « C’est Giraudoux qui m’a appris qu’on pouvait avoir au théâtre une langue
poétique et artificielle qui demeure plus vraie que la conversation sténographique ».
3.
Anne Ubersfeld, Le Théâtre, 1980
Ubersfeld tente de définir la spécificité du texte théâtral à partir d’une démarche sémiotique,
visant à « établir le ou les systèmes de signes textuels qui peuvent permettre au metteur en
scène, aux comédiens, de construire un système signifiant où le spectateur concret trouve sa
place ».
Le dialogue de théâtre n’a de signification que dans un contexte énonciatif ».
Le discours au théâtre est composé de deux « strates textuelles » :
- le dialogue, marqué par la double énonciation
Théo Didier
-
FICHE TOURSEL THÉÂTRE
HK
les didascalies, destinées au metteur en scène et aux comédiens, transmises au public
par des signes non-verbaux.
Le texte théâtral est « troué », laissant une grande liberté au metteur en scène et aux
comédiens.
La description précise est incompatible avec les possibilités de la scène : il faut que la pièce
puisse être jouée n’importe où et par n’importe qui.
Exemple : le début du Misanthrope.
Ni l’âge, ni la manière d’arriver, ni les liens
entre les personnages ne sont décrits.
Le texte reste résolument muet.
Pourtant ces éléments
sont fondamentaux quant au sens du personnage d’Alceste et du rapport Alceste-Philinte.
Le metteur en scène se trouve donc obligé de prendre parti.
Molière, L’Amour médecin, « Au lecteur » : « On sait bien que les comédies ne sont faites que
pour être jouées, et je ne conseille de lire celle-ci qu’aux personnes qui ont des yeux pour
découvrir dans la lecture tout le jeu du théâtre.
»
Tragédie et comédie
1.
Christian Biet, La Tragédie, 1997
Jusqu’au XIXe, les théoriciens de la tragédie ne font presque pas référence au tragique.
Depuis la préface de Cromwell de V.
Hugo, les auteurs s’autorisant le mélange des genres
n’appellent plus leur pièces « tragédie », mais le tragique reste.
Exemple : La machine infernale de Cocteau : « Regarde spectateur, remontée à
bloc, de telle sorte que le ressort se déroule avec lenteur tout au long d’une vie humaine, une
des plus parfaites machines construites par les dieux infernaux pour l’anéantissement d’un
mortel »
Giraudoux, parlant du destin : « c’est simplement la forme accélérée du temps.
C’est épouvantable »
Henri Gouhier prenant exemple d’Oedipe-Roi : « Il y a tragédie par la présence
d’une transcendance, quelle que soit cette transcendance »
La transcendance n’est pas fatalité qui est « anti-tragique dans la mesure où elle est
nécessitée.
Elle ne conserve une valeur tragique qu’en se posant comme une transcendance.
»
Pour Gouhier : « Il n’y a donc pas de tragédie sans liberté, puisque le rayonnement tragique
de la fatalité tient à sa transcendance et que cette transcendance transcende une liberté.
»
Pour Biet, la vraie valeur morale dans la tragédie française est le rappel de lois essentielles
après une interrogation « sur Dieu, sur la loi et sur l’homme », occasionnée par la
confrontation entre l’homme et le monde.
Le théâtre de Corneille par exemple, se termine souvent par une fin résolutive pour l’État.
Mais si elle « se finissent bien », cette résolution finale est contestée par le plaisir du public à
constater les méandres des actions humaines.
Le théâtre de Corneille oscille entre le plaisir de
la résolution et le plaisir du doute et de la complexité.
Le théâtre de Racine est contradictoire : il montre l’horreur à s’affranchir du monde et des
interdits, mais il la représente jusqu’à ne plus en voir les leçons.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’essence de la tragédie n’est pas la conscience tragique de l’homme déchiré entre sa liberté
et des lois qui le dépassent comme le remarque Georges Forestier : « Pour Corneille, comme
pour Aristote, l’essence de la tragédie réside […] dans le plaisir paradoxal qu’elle procure.
Théo Didier
FICHE TOURSEL THÉÂTRE
HK
Selon Christian Biet : « La tragédie […] est d’abord définie par sa forme, par le haut registre
de langue qu’elle emploie, par le fait que ses personnages ne sont ni populaires ni communs,
par le péril de mort inscrit dans l’intrigue et/ou par la possibilité d’une ou plusieurs issues
sanglantes.
»
« Il y a sûrement un sens du tragique chez Beckett ou Ionesco, comme il y en eut un chez
Sartre et chez Camus, tous différents.
Il faudrait dès lors étendre la définition de la tragédie à
toutes sortes de formes en la refondant sur chacune des options prises sur le tragique par
chacun des auteurs.
»
2.
Georges Forestier, Essai de génétique théâtrale, 1996
Forestier s’intéresse à la manière dont Corneille construit une tragédie.
De manière générale,
il définit la tragédie comme « un genre fondé sur le principe d’une cause finale ».
Les tragédies de Corneille et de Racine sont faites à partir du dénouement « qui est en même
temps le sujet de l’œuvre »
Corneille construit ses tragédies selon un « principe de composition régressive ».
Autrement
dit, il part d’un dénouement historique est construit l’intrigue pour qu’elle amène logiquement
à celui-ci, d’où les libertés prises sur la vérité historique.
Le tragique est « dans la manière dont un auteur construit l’enchaînement des actions qui
découle de la cause finale »
Le dramaturge est contraint : 1 : par le genre qui commande que la pièce suscite au public
crainte et pitié ; 2 : par le type de personnage qu’autorise le genre.
L’objectif du dramaturge classique n’est pas de donner le sentiment du tragique mais du
pathétique.
Corneille pense le faire en mettant ses personnages dans des situations bloquées ;
Racine en jouant sur des enchaînements.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La tragédie classique est liée au sublime.
Cette notion complexe est définie dans Le traité du
sublime ou Du merveilleux dans le discours, œuvre d’un auteur grec inconnu du Ier siècle,
dans le chapitre premier ainsi :
« Le sublime est […] ce qui forme l’excellence et la souveraine perfection du discours […].
Car il ne persuade pas proprement, mais il ravit, il transporte, et produit en nous une certaine
admiration mêlée d’étonnement et de surprise, qui est tout autre chose que de plaire
seulement, ou de persuader.
[…] il donne au discours une certaine vigueur noble, une force
invisible, qui enlève l’âme de quiconque nous écoute.
[…] Quand le sublime vient à paraître
où il faut, il renverse tout comme un foudre, et présente d’abord toutes les forces de l’Orateur
ramassées ensemble.
»
Selon Forestier : « Le sublime est le ravissement vers la grandeur par la violence de la
beauté »
Les cinq sources du sublimes définies dans le chapitre 6 ont comme fondement commun
« une faculté de bien parler ».
Il y a : 1- « une certaine élévation de l’esprit qui nous fait
penser heureusement les choses » ; 2- le « pathétique, cet enthousiasme, et cette véhémence
naturelle qui touche et qui émeut » ; 3- les figures rhétoriques ; 4- « la....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche : Le Théâtre Introduction / Entrée
- - FICHE BILAN SUR LE THEATRE – 1/6Le théâtre est un genre littéraire particulier.
- Théâtre et son double, le [Antonin Artaud] - Fiche de lecture.
- Fiche de lecture, Arthur Rimbaud, Cahiers de Douai.
- fiche question examinateur: Pourquoi ce recueil s'appelle-t-il Les Cahiers de Douai ?