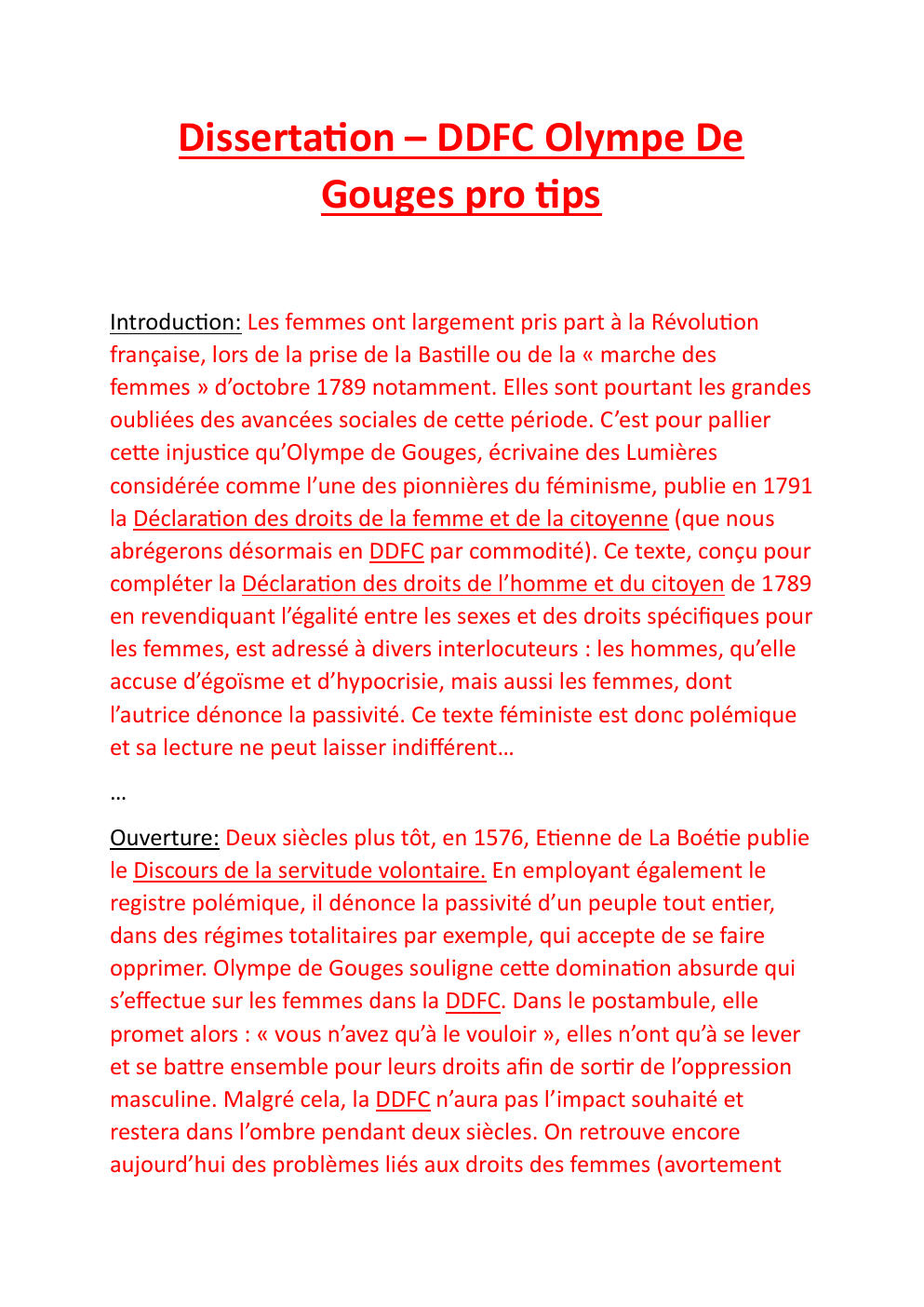Fiche de révision Olympe de Gouges DDFC Français 1ère
Publié le 25/04/2025
Extrait du document
«
Disserta on – DDFC Olympe De
Gouges pro ps
Introduc on: Les femmes ont largement pris part à la Révolu on
française, lors de la prise de la Bas lle ou de la « marche des
femmes » d’octobre 1789 notamment.
Elles sont pourtant les grandes
oubliées des avancées sociales de ce e période.
C’est pour pallier
ce e injus ce qu’Olympe de Gouges, écrivaine des Lumières
considérée comme l’une des pionnières du féminisme, publie en 1791
la Déclara on des droits de la femme et de la citoyenne (que nous
abrégerons désormais en DDFC par commodité).
Ce texte, conçu pour
compléter la Déclara on des droits de l’homme et du citoyen de 1789
en revendiquant l’égalité entre les sexes et des droits spécifiques pour
les femmes, est adressé à divers interlocuteurs : les hommes, qu’elle
accuse d’égoïsme et d’hypocrisie, mais aussi les femmes, dont
l’autrice dénonce la passivité.
Ce texte féministe est donc polémique
et sa lecture ne peut laisser indifférent…
…
Ouverture: Deux siècles plus tôt, en 1576, E enne de La Boé e publie
le Discours de la servitude volontaire.
En employant également le
registre polémique, il dénonce la passivité d’un peuple tout en er,
dans des régimes totalitaires par exemple, qui accepte de se faire
opprimer.
Olympe de Gouges souligne ce e domina on absurde qui
s’effectue sur les femmes dans la DDFC.
Dans le postambule, elle
promet alors : « vous n’avez qu’à le vouloir », elles n’ont qu’à se lever
et se ba re ensemble pour leurs droits afin de sor r de l’oppression
masculine.
Malgré cela, la DDFC n’aura pas l’impact souhaité et
restera dans l’ombre pendant deux siècles.
On retrouve encore
aujourd’hui des problèmes liés aux droits des femmes (avortement
par exemple), témoignant le combat long et difficile auquel Olympe
de Gouges, et d’autres femmes plus tard, se sont ba ues et
con nuent à se ba re.
À retenir
La réécriture: est symbolique, elle démontre avec des
arguments précis que ce e R n’est pas si juste et bonne que ce
qu’elle laisse penser.
Elle donne à son texte un ton solennel et
une force juridique -> le texte est mis en forme pour être voté à
l’Assemblée (ce qui ne se passera pas).
Elle est inclusive pour
rajouter les femmes dans la DDHC et re rer toute confusion et
pour les introduire dans des problèmes qui les touche elles
comme les droits rela fs à la maternité -> faire reconnaître un
enfant : « j’ai un enfant qui vous appar ent »,« sans préjugé
barbare » -> discours direct moins solennel plus vivant (art11),
elle raconte une anecdote du cocher qui a voulu l’escroquer
pour exemplifier son propos de manière pragma que, ou
justement demander la protec on des enfants « de quelques
lits qu’ils sortent ».
Il ne s’agit pas là d’être agressif mais de
demander jus ce.
Le registre polémique: art 4: « l’exercice des droits naturels de la
femme n’a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l’homme
lui oppose » -> ironie grinçante qui prend à par les hommes et
qui les confronte directement.
Dans le postambule elle écrit de
manière vigoureuse : « méprisable et respecté et depuis la
Révolu on, respectable et méprisé » -> chiasme puissant qui
montre la situa on paradoxale : les femmes avaient une
meilleure condi on sous l’Ancien régime car elles avaient un
minimum d’influence sur les hommes (« Dans les siècles de
corrup on vous n’avez régné que sur la faiblesse des hommes »
-> pour la R mais pour en faire une au sein de celle-ci) ce
qu’elles ont perdu -> choquant.
Ce texte peut être cri qué, mais
il défend une noble cause et a aque au plus à la hauteur de
l’injus ce -> il faut convaincre et persuader pour faire changer
les choses.
Défier son auditoire : malgré le ton conciliant (« moi seule, […]
j’ai eu la force de prendre votre défense ») avec la reine MarieAntoine e dans « À la reine », Olympe de Gouges n’hésite pas à
la menacer « notre vie est bien peu de choses, surtout pour une
reine » et se met à égalité avec elle « Madame ».
OG lui promet
du succès poli que « vous aurez bientôt pour vous une moi é
du royaume, et au moins un ers de l’autre » mais elle
deviendra son ennemi si elle décide de s’opposer à la
Révolu on.
Elle confronte de même les hommes « C’est une
femme qui t’en fait la ques on » -> il semble y avoir deux par s
bien opposés avec par exemple « mon sexe » vs « ta force »
déterminants possessifs.
Les ques ons rhétoriques : procédé puissant, il affirme en
posant une ques on : « Ô femmes, femmes quand cesserezvous d’être aveugles ? » apostrophe marquante, avec une
tonalité tragique pour la situa on, pour faire bouger les choses.
« Homme, es-tu capable d’être juste ? » première phrase qui fait
l’apostrophe de l’homme au singulier (pour s’adresser à tous
sans dis nc on) de manière provocatrice qui affirme que non.
Le mariage : « le mariage est le tombeau de la confiance et de
l’amour » (postambule), assez percutant, elle expose des
alterna ves face à celui-ci qu’elle trouve....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Littérature D'idée, Olympe de Gouges Fiche de revision
- fiche olympe de gouges: préambule
- Fiche de révision - La laitière et le pot au lait - Bac Français
- Analyse du préambule +4 articles de la DDFC d'Olympe de Gouges
- Fiche de révision - Le Malade Imaginaire acte 2 scène 5 - Bac Français: En quoi cette scène constitue-t-elle un spectacle comique ?