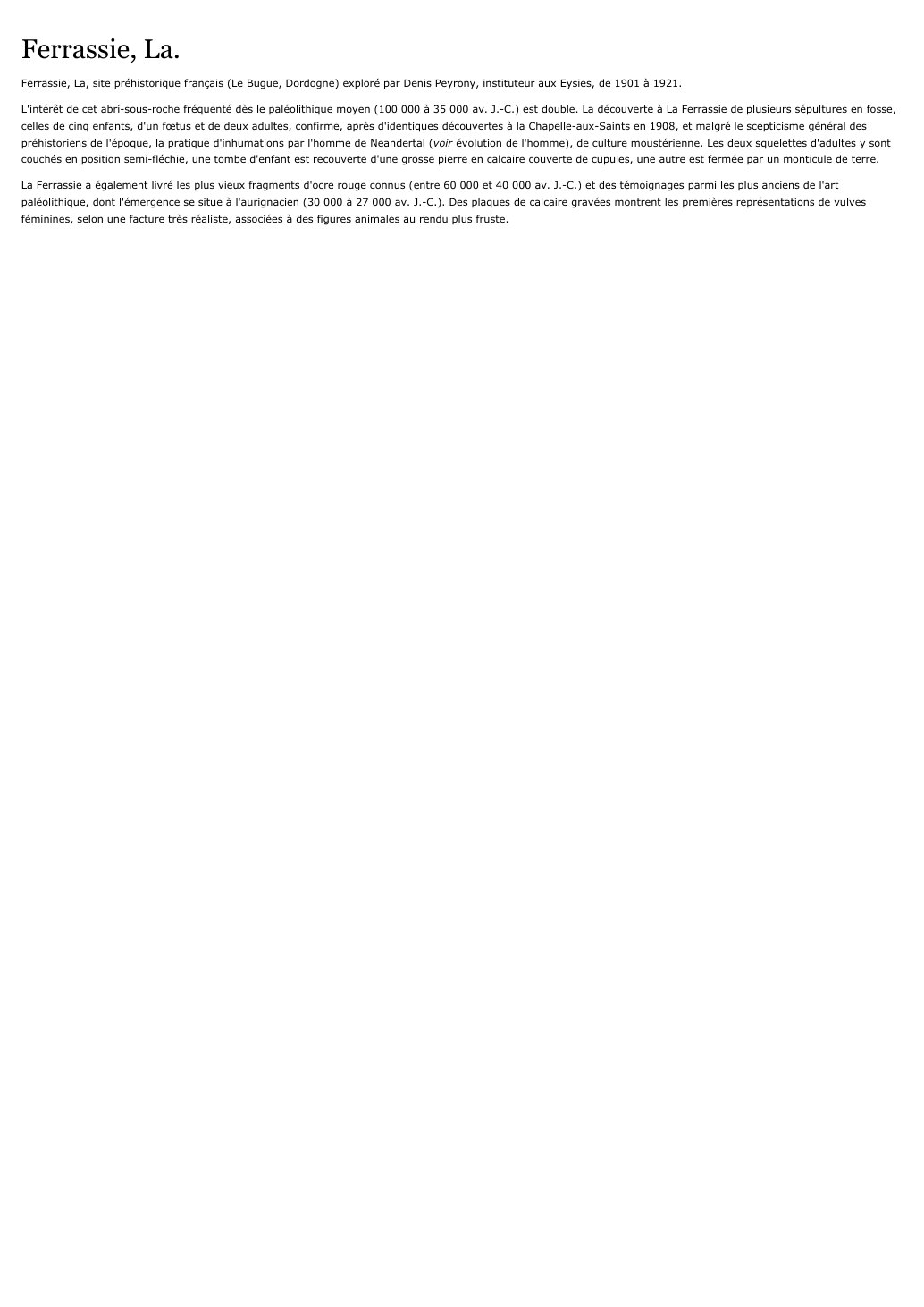Ferrassie, La.
Publié le 06/12/2021
Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Ferrassie, La.. Ce document contient 192 mots. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système d’échange gratuit de ressources numériques ou achetez-le pour la modique somme d’un euro symbolique. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en : Echange
Ferrassie, La.
Ferrassie, La, site préhistorique français (Le Bugue, Dordogne) exploré par Denis Peyrony, instituteur aux Eysies, de 1901 à 1921.
L'intérêt de cet abri-sous-roche fréquenté dès le paléolithique moyen (100 000 à 35 000 av. J.-C.) est double. La découverte à La Ferrassie de plusieurs sépultures en fosse,
celles de cinq enfants, d'un foetus et de deux adultes, confirme, après d'identiques découvertes à la Chapelle-aux-Saints en 1908, et malgré le scepticisme général des
préhistoriens de l'époque, la pratique d'inhumations par l'homme de Neandertal (voir évolution de l'homme), de culture moustérienne. Les deux squelettes d'adultes y sont
couchés en position semi-fléchie, une tombe d'enfant est recouverte d'une grosse pierre en calcaire couverte de cupules, une autre est fermée par un monticule de terre.
La Ferrassie a également livré les plus vieux fragments d'ocre rouge connus (entre 60 000 et 40 000 av. J.-C.) et des témoignages parmi les plus anciens de l'art
paléolithique, dont l'émergence se situe à l'aurignacien (30 000 à 27 000 av. J.-C.). Des plaques de calcaire gravées montrent les premières représentations de vulves
féminines, selon une facture très réaliste, associées à des figures animales au rendu plus fruste.
Ferrassie, La.
Ferrassie, La, site préhistorique français (Le Bugue, Dordogne) exploré par Denis Peyrony, instituteur aux Eysies, de 1901 à 1921.
L'intérêt de cet abri-sous-roche fréquenté dès le paléolithique moyen (100 000 à 35 000 av. J.-C.) est double. La découverte à La Ferrassie de plusieurs sépultures en fosse,
celles de cinq enfants, d'un foetus et de deux adultes, confirme, après d'identiques découvertes à la Chapelle-aux-Saints en 1908, et malgré le scepticisme général des
préhistoriens de l'époque, la pratique d'inhumations par l'homme de Neandertal (voir évolution de l'homme), de culture moustérienne. Les deux squelettes d'adultes y sont
couchés en position semi-fléchie, une tombe d'enfant est recouverte d'une grosse pierre en calcaire couverte de cupules, une autre est fermée par un monticule de terre.
La Ferrassie a également livré les plus vieux fragments d'ocre rouge connus (entre 60 000 et 40 000 av. J.-C.) et des témoignages parmi les plus anciens de l'art
paléolithique, dont l'émergence se situe à l'aurignacien (30 000 à 27 000 av. J.-C.). Des plaques de calcaire gravées montrent les premières représentations de vulves
féminines, selon une facture très réaliste, associées à des figures animales au rendu plus fruste.
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓