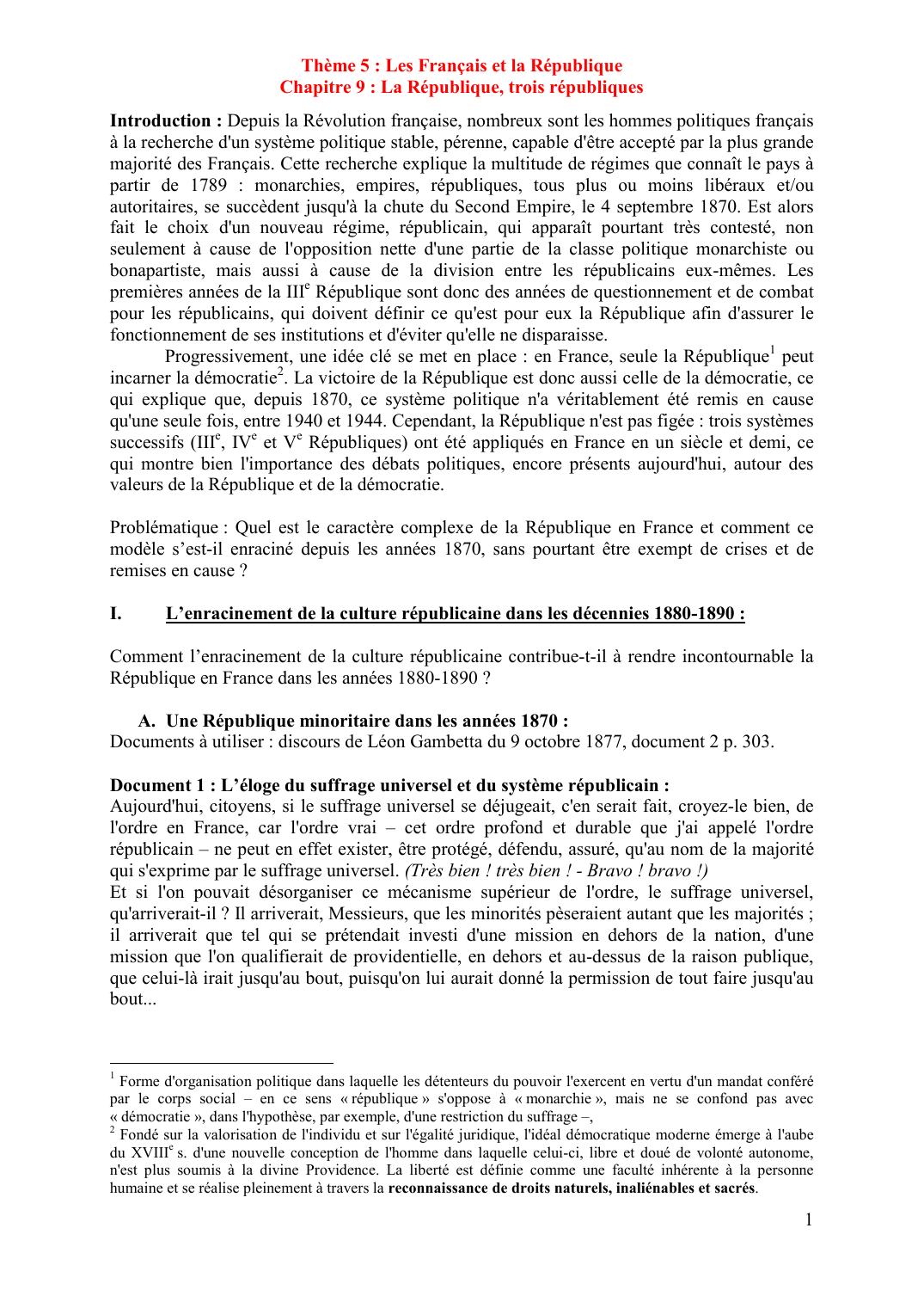Cours français
Publié le 22/05/2020

Extrait du document
«
Thème 5 : Les Français et la République
Chapitre 9 : La République, trois républiques
1
Introduction :
Depuis la Révolution française, nombreux sont les h ommes politiques français
à la recherche d'un système politique stable, péren ne, capable d'être accepté par la plus grande
majorité des Français.
Cette recherche explique la multitude de régimes que connaît le pays à
partir de 1789 : monarchies, empires, républiques, tous plus ou moins libéraux et/ou
autoritaires, se succèdent jusqu'à la chute du Seco nd Empire, le 4 septembre 1870.
Est alors
fait le choix d'un nouveau régime, républicain, qui apparaît pourtant très contesté, non
seulement à cause de l'opposition nette d'une parti e de la classe politique monarchiste ou
bonapartiste, mais aussi à cause de la division ent re les républicains eux-mêmes.
Les
premières années de la III
e République sont donc des années de questionnement et de combat
pour les républicains, qui doivent définir ce qu'es t pour eux la République afin d'assurer le
fonctionnement de ses institutions et d'éviter qu'e lle ne disparaisse.
Progressivement, une idée clé se met en place : en France, seule la République
1 peut
incarner la démocratie 2.
La victoire de la République est donc aussi celle d e la démocratie, ce
qui explique que, depuis 1870, ce système politique n'a véritablement été remis en cause
qu'une seule fois, entre 1940 et 1944.
Cependant, l a République n'est pas figée : trois systèmes
successifs (III
e, IV e et V e Républiques) ont été appliqués en France en un siè cle et demi, ce
qui montre bien l'importance des débats politiques, encore présents aujourd'hui, autour des
valeurs de la République et de la démocratie.
Problématique : Quel est le caractère complexe de l a République en France et comment ce
modèle s’est-il enraciné depuis les années 1870, sa ns pourtant être exempt de crises et de
remises en cause ?
I.
L’enracinement de la culture républicaine dans les décennies 1880-1890 :
Comment l’enracinement de la culture républicaine c ontribue-t-il à rendre incontournable la
République en France dans les années 1880-1890 ?
A.
Une République minoritaire dans les années 1870 :
Documents à utiliser : discours de Léon Gambetta du 9 octobre 1877, document 2 p.
303.
Document 1 : L’éloge du suffrage universel et du sy stème républicain :
Aujourd'hui, citoyens, si le suffrage universel se déjugeait, c'en serait fait, croyez-le bien, de
l'ordre en France, car l'ordre vrai – cet ordre pro fond et durable que j'ai appelé l'ordre
républicain – ne peut en effet exister, être protég é, défendu, assuré, qu'au nom de la majorité
qui s'exprime par le suffrage universel.
(Très bien ! très bien ! - Bravo ! bravo !)
Et si l'on pouvait désorganiser ce mécanisme supéri eur de l'ordre, le suffrage universel,
qu'arriverait-il ? Il arriverait, Messieurs, que le s minorités pèseraient autant que les majorités ;
il arriverait que tel qui se prétendait investi d'u ne mission en dehors de la nation, d'une
mission que l'on qualifierait de providentielle, en dehors et au-dessus de la raison publique,
que celui-là irait jusqu'au bout, puisqu'on lui aur ait donné la permission de tout faire jusqu'au
bout...
1 Forme d'organisation politique dans laquelle les d étenteurs du pouvoir l'exercent en vertu d'un manda t conféré
par le corps social – en ce sens « république » s'o ppose à « monarchie », mais ne se confond pas avec
« démocratie », dans l'hypothèse, par exemple, d'un e restriction du suffrage –,
2 Fondé sur la valorisation de l'individu et sur l'égalité juridique, l'idéal démocratique moderne émer ge à l'aube
du XVIII e s.
d'une nouvelle conception de l'homme dans laque lle celui-ci, libre et doué de volonté autonome,
n'est plus soumis à la divine Providence.
La libert é est définie comme une faculté inhérente à la pers onne
humaine et se réalise pleinement à travers la reconnaissance de droits naturels, inaliénables et sacrés..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Cours de Français sur: L'apologue.
- Cours de Français sur: Le discours délibératif.
- Cours bac Français : Poésie
- Cours de français sur la poésie de Prépa Sup
- Cours de Français sur: LA POESIE.