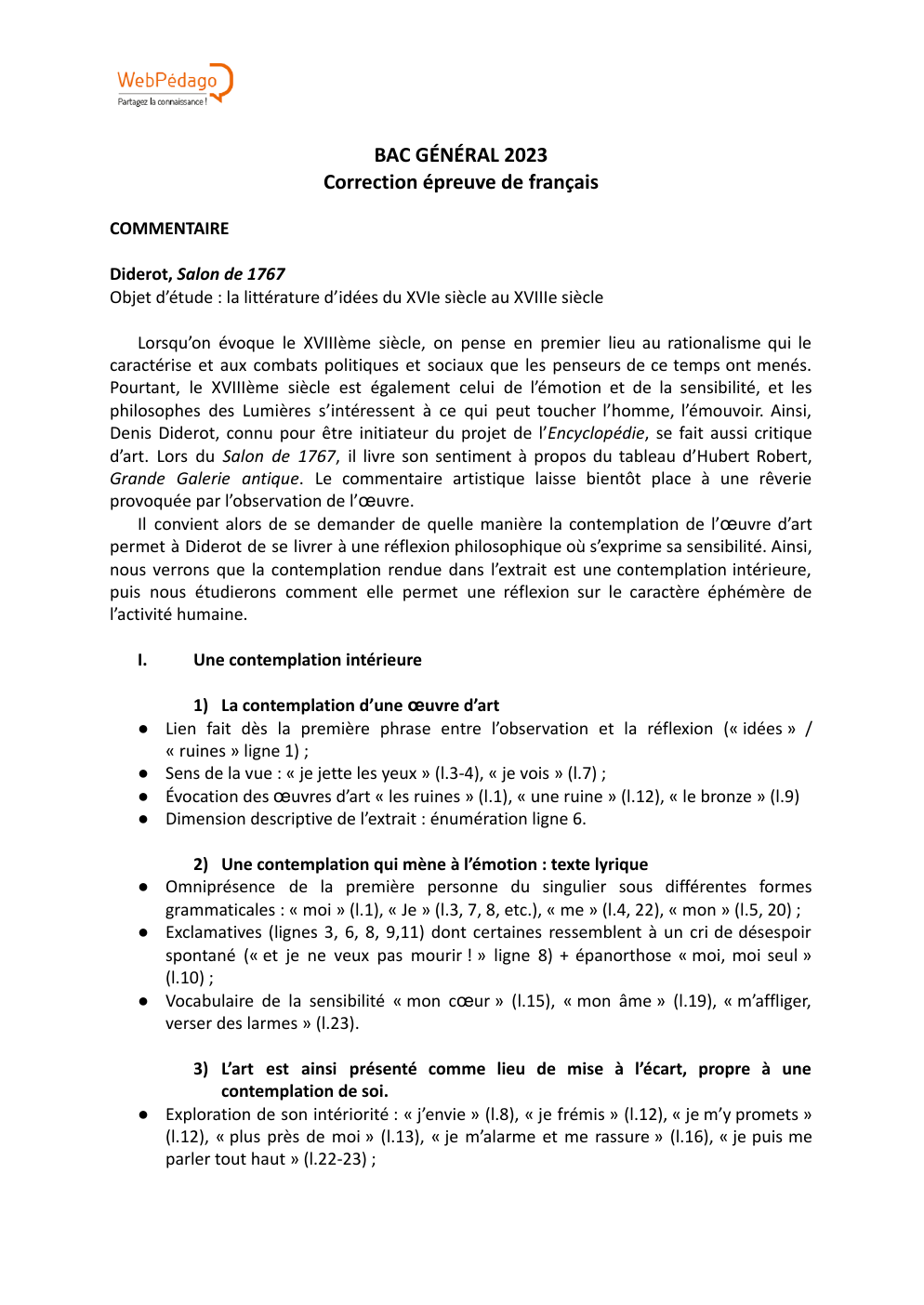Correction Commentaire Compose Denis DIDEROT, Salon de 1767 Litterature d'idees
Publié le 12/06/2025
Extrait du document
«
BAC GÉNÉRAL 2023
Correction épreuve de français
COMMENTAIRE
Diderot, Salon de 1767
Objet d’étude : la littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle
Lorsqu’on évoque le XVIIIème siècle, on pense en premier lieu au rationalisme qui le
caractérise et aux combats politiques et sociaux que les penseurs de ce temps ont menés.
Pourtant, le XVIIIème siècle est également celui de l’émotion et de la sensibilité, et les
philosophes des Lumières s’intéressent à ce qui peut toucher l’homme, l’émouvoir.
Ainsi,
Denis Diderot, connu pour être initiateur du projet de l’Encyclopédie, se fait aussi critique
d’art.
Lors du Salon de 1767, il livre son sentiment à propos du tableau d’Hubert Robert,
Grande Galerie antique.
Le commentaire artistique laisse bientôt place à une rêverie
provoquée par l’observation de l’œuvre.
Il convient alors de se demander de quelle manière la contemplation de l’œuvre d’art
permet à Diderot de se livrer à une réflexion philosophique où s’exprime sa sensibilité.
Ainsi,
nous verrons que la contemplation rendue dans l’extrait est une contemplation intérieure,
puis nous étudierons comment elle permet une réflexion sur le caractère éphémère de
l’activité humaine.
I.
●
●
●
●
Une contemplation intérieure
1) La contemplation d’une œuvre d’art
Lien fait dès la première phrase entre l’observation et la réflexion (« idées » /
« ruines » ligne 1) ;
Sens de la vue : « je jette les yeux » (l.3-4), « je vois » (l.7) ;
Évocation des œuvres d’art « les ruines » (l.1), « une ruine » (l.12), « le bronze » (l.9)
Dimension descriptive de l’extrait : énumération ligne 6.
2) Une contemplation qui mène à l’émotion : texte lyrique
● Omniprésence de la première personne du singulier sous différentes formes
grammaticales : « moi » (l.1), « Je » (l.3, 7, 8, etc.), « me » (l.4, 22), « mon » (l.5, 20) ;
● Exclamatives (lignes 3, 6, 8, 9,11) dont certaines ressemblent à un cri de désespoir
spontané (« et je ne veux pas mourir ! » ligne 8) + épanorthose « moi, moi seul »
(l.10) ;
● Vocabulaire de la sensibilité « mon cœur » (l.15), « mon âme » (l.19), « m’affliger,
verser des larmes » (l.23).
3) L’art est ainsi présenté comme lieu de mise à l’écart, propre à une
contemplation de soi.
● Exploration de son intériorité : « j’envie » (l.8), « je frémis » (l.12), « je m’y promets »
(l.12), « plus près de moi » (l.13), « je m’alarme et me rassure » (l.16), « je puis me
parler tout haut » (l.22-23) ;
● Un lieu vers lequel aller (« je marche », l.3) et mis en valeur : anaphore des
présentatifs (« c’est là », l.13-16) ;
● Un lieu solitaire : énumération de groupes prépositionnels négatifs introduits
par « sans » (l.14-15), en opposition avec le « tumulte » des villes et des foules
(énumération voire accumulation l.17-18) ;
● Gradation croissante : à la ligne 13, retour vers soi presque physique ;
● Retour vers soi qui permet aussi de créer un lien profond et vrai avec l’autre :
paradoxe entre l’expression « je regrette mon amie » et l’expression « nous
jouirons de nous » (l.14).
II.
●
●
●
●
Une réflexion philosophique sur le caractère éphémère de l’activité humaine
1) Les ruines comme symbole du temps qui passe et détruit toute construction
humaine.
Gradation décroissante (l.1-2) qui fait le lien entre temps et anéantissement ;
Parallélisme de construction à la ligne 2 avec deux négations restrictives et des verbes
synonymes ;
Rien n’est épargné par le temps : même le « marbre des tombeaux » (l.7-8), pourtant
symbole d’éternité (marbre = matériau dur, qui ne s’érode pas ; tombeaux = mort,
éternité), « tomb(e) en poussière ».
C’est une référence à la mythologie biblique +
aux vanités ;
Le passage du temps est montré dans son processus grâce à l’accumulation de verbes
montrant l’effet du temps sur le monde et la nature : « s’affaisse », « se creuse »,
« chancelle », « s’ébranlent » aux lignes 6 et 7
2) La place de l’homme dans l’éternité
● Image à la ligne 3 : « je marche entre deux éternités », on est à la limite de l’allégorie
de la condition humaine ;
● Interrogation fondamentale exprimée dans la seule phrase interrogative du texte,
ligne 7 : « Qu’est-ce que mon existence éphémère … ? » ;
● Une réflexion qui se construit de l’observation (premier paragraphe) à l’hypothèse
(systèmes hypothétiques ligne 12 et ligne 19) pour interroger sa propre place dans
l’éternité.
3) La sensibilité comme voie vers la liberté et le bonheur.
● Progression dans l’extrait, d’une émotion qui apparaît comme réaction spontanée à la
vue de l’œuvre jusqu’à une sensibilité sans contrainte, expression d’une liberté :
« qu’il est vieux ce monde ! » (l.2-3) à « verser des larmes sans contrainte » (l.23) ;
● Des « tombeaux » (l.8) à « la douceur de son repos » (l.20) ;
● L’affliction et la solitude sont l’expression d’une âme apaisée, libérée du tumulte.
Diderot livre ici un texte qui semble s’éloigner de la critique d’art et de la réflexion rationnelle
mais qui, pour autant, propose une réflexion philosophique dans laquelle la sensibilité joue
un rôle premier.
Cette page profonde et touchante semble préromantique et nous fait penser
à une Rêverie du promeneur solitaire de Rousseau.
DISSERTATION
Sujet A - Abbé Prévost, Manon Lescaut
Parcours : personnages en marge, plaisirs du romanesque
Le plaisir de lire Manon Lescaut ne tient-il qu’au récit d’une passion amoureuse ?
On prête à Antoine François Prévost une vie pleine de rebondissements qui peut
sembler bien éloignée de son statut ecclésiastique.
La passion amoureuse aurait souvent
guidé ses choix, associée à un désir fort de liberté.
Ainsi L’histoire du chevalier des Grieux et
de Manon Lescaut publiée en 1731, serait partiellement inspirée de l’existence tumultueuse
de son auteur qui s’est plus d’une fois écarté des valeurs portées par son éducation, sa
fonction et son origine sociale.
Il est certain que le récit que le jeune Des Grieux fait au
marquis de Renoncour donne la primauté aux aventures engendrées par l’amour fou que le
jeune homme de bonne famille a éprouvé pour la belle Manon.
Mais le plaisir du lecteur ne
tient-il qu’au récit d’une passion amoureuse ? N’y a-t-il pas d’autres ressorts romanesques
ainsi qu’une dimension réflexive qui séduisent tout autant le public ?
Nous verrons tout d’abord que l’histoire d’une passion amoureuse entre deux amants
que tout opposait charme le lecteur, puis que ce roman mobilise tous les plaisirs engendrés
par le roman d’aventures.
Enfin, guidé par les propos de l’auteur dans l’Avis liminaire, nous
comprendrons qu’« outre le plaisir d'une lecture agréable, on y trouvera peu d'événements
qui ne puissent servir à l'instruction des mœurs ».
Nous verrons que cette dimension
réflexive participe également au plaisir de la lecture.
I.
Le récit plaisant d’une passion amoureuse
1) L’amour au premier regard
Deux jeunes gens, très beaux, se rencontrent de manière parfaitement fortuite.
Des Grieux est immédiatement séduit : « elle me parut si charmante (…) que je me trouvais
enflammé jusqu’au transport ».
Topos amoureux du coup de foudre.
Exemple :
- Manon : « Je te jure, mon cher chevalier, que tu es l’idole de mon cœur, et qu’il n’y a
que toi au monde que je puisse aimer de la façon dont je t’aime »
// Flaubert, L’Education sentimentale, coup de foudre de Frédéric pour Mme Arnoux : « Ce
fut comme une apparition »
2) L’idylle
Un roman aux grandes envolées lyriques qui dit l’amour, ses joies et ses peines.
Les
personnages exultent de joie, pleurent, se déclarent un amour éternel, se déchirent
également.
Émotivité exacerbée.
Exemples :
- un amour sensuel irrésistible dès la première nuit partagée (« nous fraudâmes les
droits de l’église ») ;
- le trouble de Des Grieux face aux démonstrations amoureuses de Manon lors des
retrouvailles au parloir : « À peine eus-je achevé ces derniers mots, qu’elle se leva avec
transport pour venir m’embrasser.
Elle m’accabla de mille caresses passionnées.
Elle
m’appela par tous les noms que l’amour invente pour exprimer ses plus vives
tendresses.
»
3) La « force des passions »
Trahisons, tromperies, disputes et retrouvailles font aussi partie des plaisirs d’une grande
histoire d’amour.
Ressorts mélodramatiques qui font vibrer le lecteur.
Exemple :
- les retrouvailles au parloir : « Le désordre de mon âme en l’écoutant ne saurait être
exprimé.
»
// Dans Le Confident d’Hélène Grémillon, passion interdite entre Annie et Paul.
La trahison
que représente cette passion adultère pour l’épouse de Paul, confidente et amie d’Annie.
II.
Le plaisir de lecture : les ressorts romanesques du roman d’aventures et du
roman en général
1) Des aventures rocambolesques – des rebondissements
Le roman est sans cesse rythmé par des aventures qui tiennent le lecteur en haleine.
Exemple :
- le meurtre de Lescaut, le travestissement de Manon pour s’évader de Saint Lazare,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- TEXTE DE COMMENTAIRE COMPOSE ET CORRECTION: MON PAYS
- commentaire regrets sur ma vieille robe de chambre diderot
- oral bac: Commentaire du texte : DIDEROT Encyclopédie article « Raison »
- commentaire Diderot Supplément au voyage de Bougainville: bon sauvage et colonialisme
- LECTURE LINEAIRE 4: extrait du roman de Denis Diderot, JACQUES LE FATALISTE ET SON MAITRE, « histoire de Mme de la Pommmeraye »