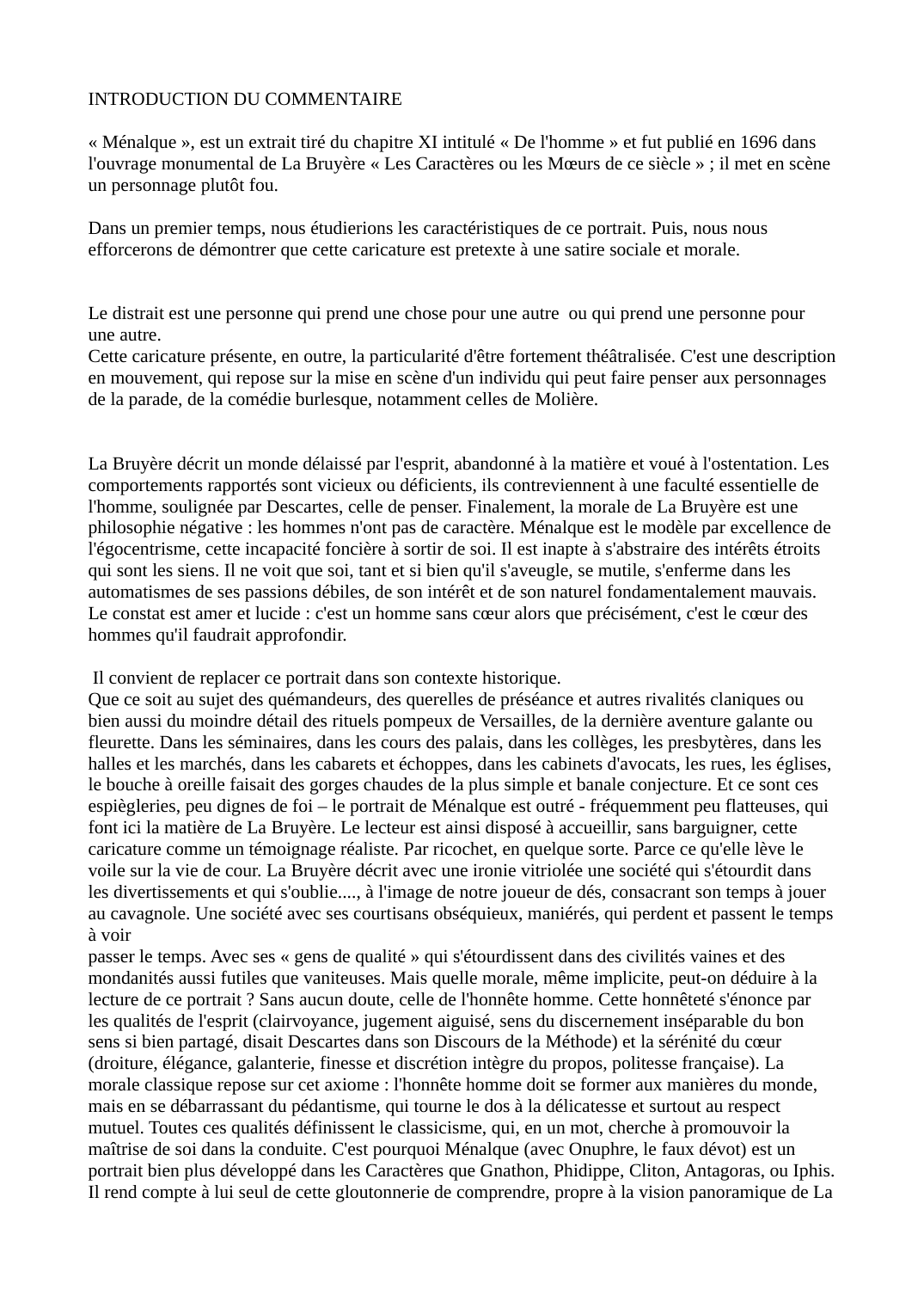commentaire Ménalque
Publié le 18/05/2020

Extrait du document
«
INTRODUCTION DU COMMENTAIRE
« Ménalque », est un extrait tiré du chapitre XI intitulé « De l'homme » et fut publié en 1696 dans
l'ouvrage monumental de La Bruyère « Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle » ; il met en scène
un personnage plutôt fou.
Dans un premier temps, nous étudierions les caractéristiques de ce portrait.
Puis, nous nous
efforcerons de démontrer que cette caricature est pretexte à une satire sociale et morale.
Le distrait est une personne qui prend une chose pour une autre ou qui prend une personne pour
une autre.
Cette caricature présente, en outre, la particularité d'être fortement théâtralisée.
C'est une description
en mouvement, qui repose sur la mise en scène d'un individu qui peut faire penser aux personnages
de la parade, de la comédie burlesque, notamment celles de Molière.
La Bruyère décrit un monde délaissé par l'esprit, abandonné à la matière et voué à l'ostentation.
Les
comportements rapportés sont vicieux ou déficients, ils contreviennent à une faculté essentielle de
l'homme, soulignée par Descartes, celle de penser.
Finalement, la morale de La Bruyère est une
philosophie négative : les hommes n'ont pas de caractère.
Ménalque est le modèle par excellence de
l'égocentrisme, cette incapacité foncière à sortir de soi.
Il est inapte à s'abstraire des intérêts étroits
qui sont les siens.
Il ne voit que soi, tant et si bien qu'il s'aveugle, se mutile, s'enferme dans les
automatismes de ses passions débiles, de son intérêt et de son naturel fondamentalement mauvais.
Le constat est amer et lucide : c'est un homme sans cœur alors que précisément, c'est le cœur des
hommes qu'il faudrait approfondir.
Il convient de replacer ce portrait dans son contexte historique.
Que ce soit au sujet des quémandeurs, des querelles de préséance et autres rivalités claniques ou
bien aussi du moindre détail des rituels pompeux de Versailles, de la dernière aventure galante ou
fleurette.
Dans les séminaires, dans les cours des palais, dans les collèges, les presbytères, dans les
halles et les marchés, dans les cabarets et échoppes, dans les cabinets d'avocats, les rues, les églises,
le bouche à oreille faisait des gorges chaudes de la plus simple et banale conjecture.
Et ce sont ces
espiègleries, peu dignes de foi – le portrait de Ménalque est outré - fréquemment peu flatteuses, qui
font ici la matière de La Bruyère.
Le lecteur est ainsi disposé à accueillir, sans barguigner, cette
caricature comme un témoignage réaliste.
Par ricochet, en quelque sorte.
Parce ce qu'elle lève le
voile sur la vie de cour.
La Bruyère décrit avec une ironie vitriolée une société qui s'étourdit dans
les divertissements et qui s'oublie...., à l'image de notre joueur de dés, consacrant son temps à jouer
au cavagnole.
Une société avec ses courtisans obséquieux, maniérés, qui perdent et passent le temps
à voir
passer le temps.
Avec ses « gens de qualité » qui s'étourdissent dans des civilités vaines et des
mondanités aussi futiles que vaniteuses.
Mais quelle morale, même implicite, peut-on déduire à la
lecture de ce portrait ? Sans aucun doute, celle de l'honnête homme.
Cette honnêteté s'énonce par
les qualités de l'esprit (clairvoyance, jugement aiguisé, sens du discernement inséparable du bon
sens si bien partagé, disait Descartes dans son Discours de la Méthode) et la sérénité du cœur
(droiture, élégance, galanterie, finesse et discrétion intègre du propos, politesse française).
La
morale classique repose sur cet axiome : l'honnête homme doit se former aux manières du monde,
mais en se débarrassant du pédantisme, qui tourne le dos à la délicatesse et surtout au respect
mutuel.
Toutes ces qualités définissent le classicisme, qui, en un mot, cherche à promouvoir la
maîtrise de soi dans la conduite.
C'est pourquoi Ménalque (avec Onuphre, le faux dévot) est un
portrait bien plus développé dans les Caractères que Gnathon, Phidippe, Cliton, Antagoras, ou Iphis.
Il rend compte à lui seul de cette gloutonnerie de comprendre, propre à la vision panoramique de La.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire d'Histoire de l'art sur le Galate mourant
- COMMENTAIRE DE TEXTE : “Stances à Marquise”, Pierre Corneille (1658)
- commentaire regrets sur ma vieille robe de chambre diderot
- Commentaire de texte Olympe de Gouges - A partir de « Homme, es tu capable d’être juste ? »
- Commentaire de texte, Bardamu à la guerre de Céline