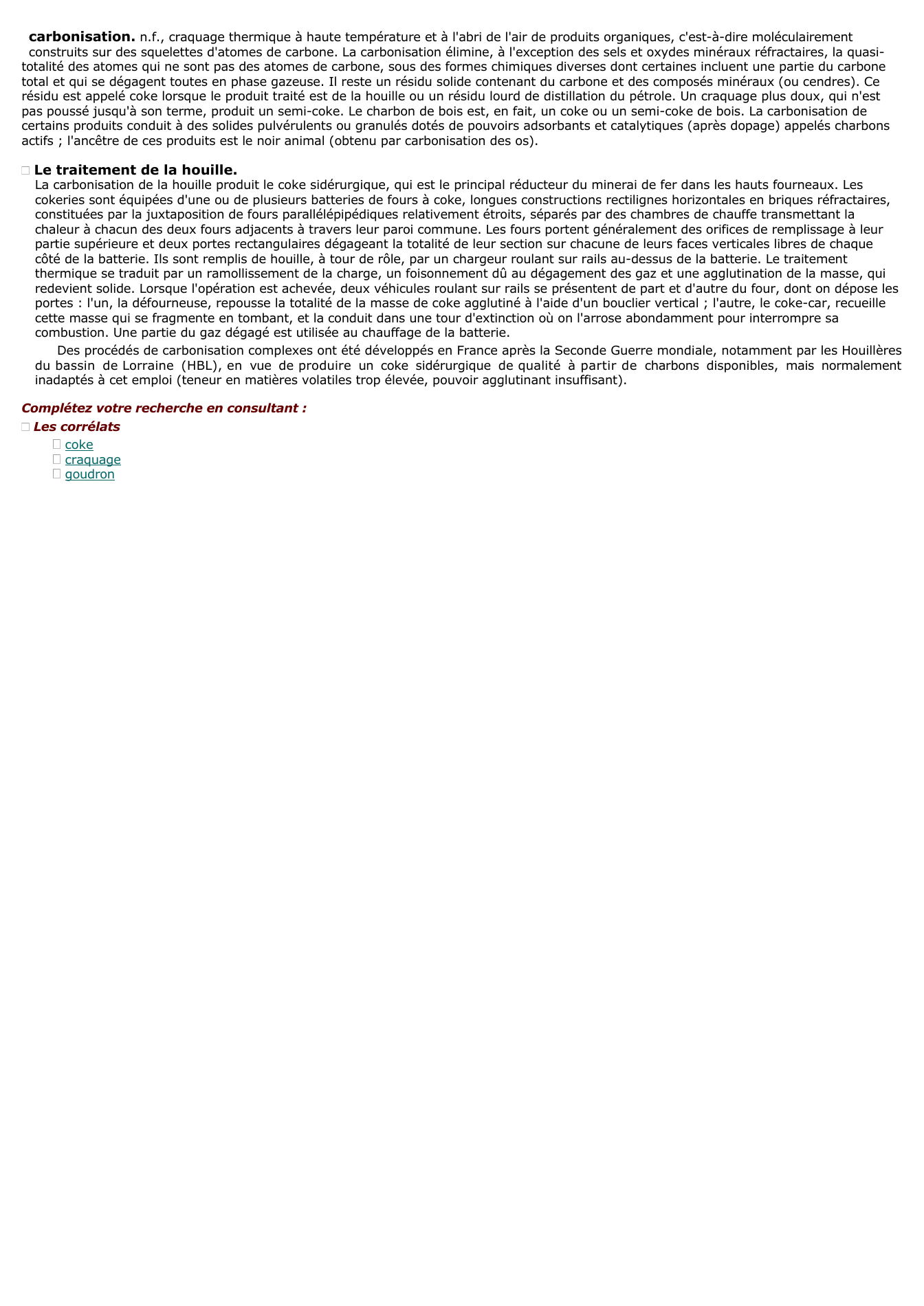carbonisation.
Publié le 07/12/2021

Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : carbonisation.. Ce document contient 464 mots. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système d’échange gratuit de ressources numériques ou achetez-le pour la modique somme d’un euro symbolique. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en : Dictionnaire
carbonisation. n.f., craquage thermique à haute température et à l'abri de l'air de produits organiques, c'est-à-dire moléculairement
construits sur des squelettes d'atomes de carbone. La carbonisation élimine, à l'exception des sels et oxydes minéraux réfractaires, la quasitotalité des atomes qui ne sont pas des atomes de carbone, sous des formes chimiques diverses dont certaines incluent une partie du carbone
total et qui se dégagent toutes en phase gazeuse. Il reste un résidu solide contenant du carbone et des composés minéraux (ou cendres). Ce
résidu est appelé coke lorsque le produit traité est de la houille ou un résidu lourd de distillation du pétrole. Un craquage plus doux, qui n'est
pas poussé jusqu'à son terme, produit un semi-coke. Le charbon de bois est, en fait, un coke ou un semi-coke de bois. La carbonisation de
certains produits conduit à des solides pulvérulents ou granulés dotés de pouvoirs adsorbants et catalytiques (après dopage) appelés charbons
actifs ; l'ancêtre de ces produits est le noir animal (obtenu par carbonisation des os).
Le traitement de la houille.
La carbonisation de la houille produit le coke sidérurgique, qui est le principal réducteur du minerai de fer dans les hauts fourneaux. Les
cokeries sont équipées d'une ou de plusieurs batteries de fours à coke, longues constructions rectilignes horizontales en briques réfractaires,
constituées par la juxtaposition de fours parallélépipédiques relativement étroits, séparés par des chambres de chauffe transmettant la
chaleur à chacun des deux fours adjacents à travers leur paroi commune. Les fours portent généralement des orifices de remplissage à leur
partie supérieure et deux portes rectangulaires dégageant la totalité de leur section sur chacune de leurs faces verticales libres de chaque
côté de la batterie. Ils sont remplis de houille, à tour de rôle, par un chargeur roulant sur rails au-dessus de la batterie. Le traitement
thermique se traduit par un ramollissement de la charge, un foisonnement dû au dégagement des gaz et une agglutination de la masse, qui
redevient solide. Lorsque l'opération est achevée, deux véhicules roulant sur rails se présentent de part et d'autre du four, dont on dépose les
portes : l'un, la défourneuse, repousse la totalité de la masse de coke agglutiné à l'aide d'un bouclier vertical ; l'autre, le coke-car, recueille
cette masse qui se fragmente en tombant, et la conduit dans une tour d'extinction où on l'arrose abondamment pour interrompre sa
combustion. Une partie du gaz dégagé est utilisée au chauffage de la batterie.
Des procédés de carbonisation complexes ont été développés en France après la Seconde Guerre mondiale, notamment par les Houillères
du bassin de Lorraine (HBL), en vue de produire un coke sidérurgique de qualité à partir de charbons disponibles, mais normalement
inadaptés à cet emploi (teneur en matières volatiles trop élevée, pouvoir agglutinant insuffisant).
Complétez votre recherche en consultant :
Les corrélats
coke
craquage
goudron
carbonisation. n.f., craquage thermique à haute température et à l'abri de l'air de produits organiques, c'est-à-dire moléculairement
construits sur des squelettes d'atomes de carbone. La carbonisation élimine, à l'exception des sels et oxydes minéraux réfractaires, la quasitotalité des atomes qui ne sont pas des atomes de carbone, sous des formes chimiques diverses dont certaines incluent une partie du carbone
total et qui se dégagent toutes en phase gazeuse. Il reste un résidu solide contenant du carbone et des composés minéraux (ou cendres). Ce
résidu est appelé coke lorsque le produit traité est de la houille ou un résidu lourd de distillation du pétrole. Un craquage plus doux, qui n'est
pas poussé jusqu'à son terme, produit un semi-coke. Le charbon de bois est, en fait, un coke ou un semi-coke de bois. La carbonisation de
certains produits conduit à des solides pulvérulents ou granulés dotés de pouvoirs adsorbants et catalytiques (après dopage) appelés charbons
actifs ; l'ancêtre de ces produits est le noir animal (obtenu par carbonisation des os).
Le traitement de la houille.
La carbonisation de la houille produit le coke sidérurgique, qui est le principal réducteur du minerai de fer dans les hauts fourneaux. Les
cokeries sont équipées d'une ou de plusieurs batteries de fours à coke, longues constructions rectilignes horizontales en briques réfractaires,
constituées par la juxtaposition de fours parallélépipédiques relativement étroits, séparés par des chambres de chauffe transmettant la
chaleur à chacun des deux fours adjacents à travers leur paroi commune. Les fours portent généralement des orifices de remplissage à leur
partie supérieure et deux portes rectangulaires dégageant la totalité de leur section sur chacune de leurs faces verticales libres de chaque
côté de la batterie. Ils sont remplis de houille, à tour de rôle, par un chargeur roulant sur rails au-dessus de la batterie. Le traitement
thermique se traduit par un ramollissement de la charge, un foisonnement dû au dégagement des gaz et une agglutination de la masse, qui
redevient solide. Lorsque l'opération est achevée, deux véhicules roulant sur rails se présentent de part et d'autre du four, dont on dépose les
portes : l'un, la défourneuse, repousse la totalité de la masse de coke agglutiné à l'aide d'un bouclier vertical ; l'autre, le coke-car, recueille
cette masse qui se fragmente en tombant, et la conduit dans une tour d'extinction où on l'arrose abondamment pour interrompre sa
combustion. Une partie du gaz dégagé est utilisée au chauffage de la batterie.
Des procédés de carbonisation complexes ont été développés en France après la Seconde Guerre mondiale, notamment par les Houillères
du bassin de Lorraine (HBL), en vue de produire un coke sidérurgique de qualité à partir de charbons disponibles, mais normalement
inadaptés à cet emploi (teneur en matières volatiles trop élevée, pouvoir agglutinant insuffisant).
Complétez votre recherche en consultant :
Les corrélats
coke
craquage
goudron
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓