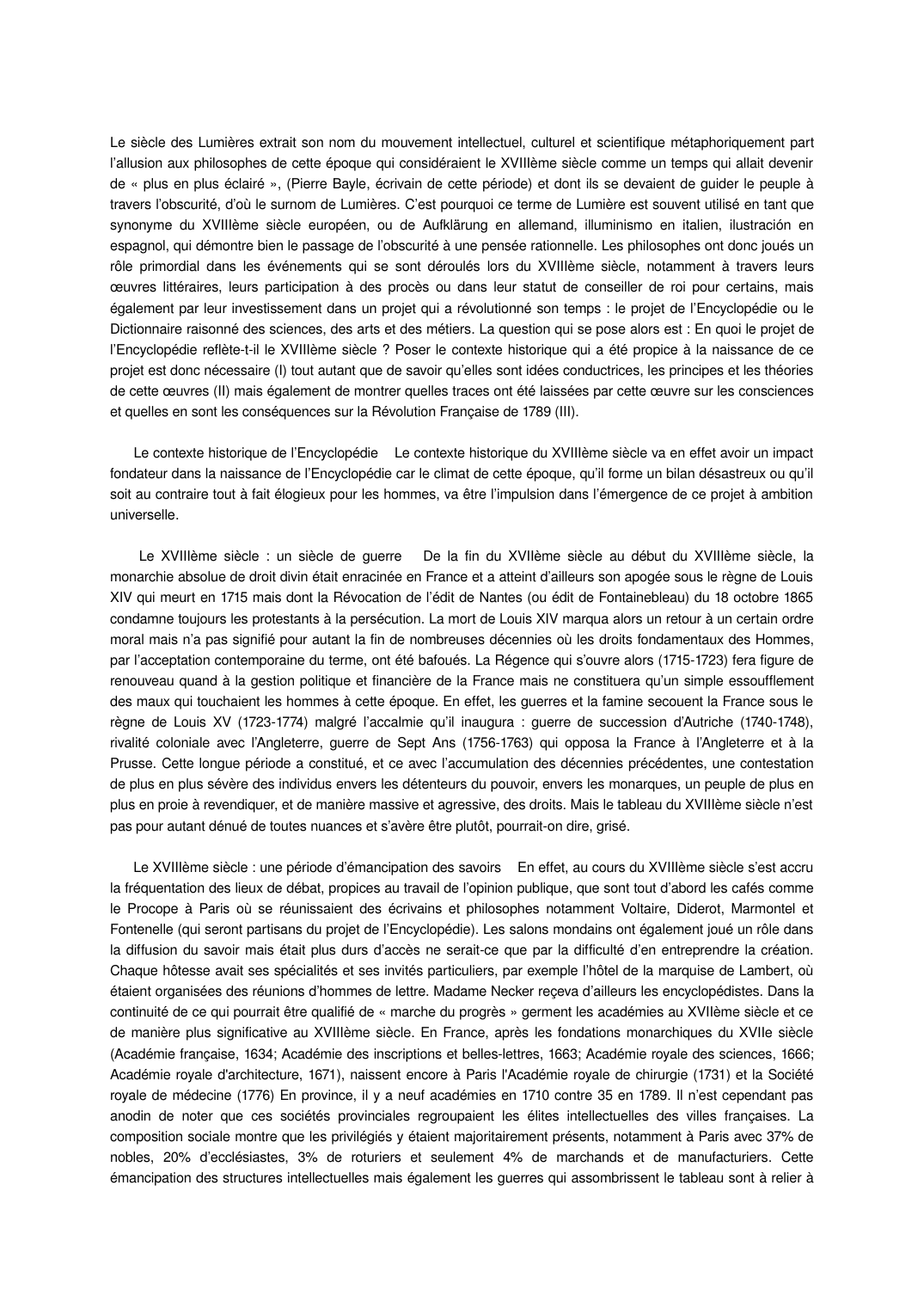blex
Publié le 18/05/2020

Extrait du document
«
Le siècle des Lumi ères extrait son nom du mouvement intellectuel, culturel et scientifique m étaphoriquement part
l’allusion aux philosophes de cette
époque qui consid éraient le XVIII ème si ècle comme un temps qui allait devenir
de « plus en plus
éclair é », (Pierre Bayle, écrivain de cette p ériode) et dont ils se devaient de guider le peuple à
travers l’obscurit
é, d’o ù le surnom de Lumi ères. C’est pourquoi ce terme de Lumi ère est souvent utilis é en tant que
synonyme du XVIII
ème si ècle europ éen, ou de Aufkl ärung en allemand, illuminismo en italien, ilustraci ón en
espagnol, qui d
émontre bien le passage de l’obscurit é à une pens ée rationnelle. Les philosophes ont donc jou és un
r
ôle primordial dans les événements qui se sont d éroul és lors du XVIII ème si ècle, notamment à travers leurs
œuvres litt
éraires, leurs participation à des proc ès ou dans leur statut de conseiller de roi pour certains, mais
é
galement par leur investissement dans un projet qui a r évolutionn é son temps : le projet de l’Encyclop édie ou le
Dictionnaire raisonn
é des sciences, des arts et des m étiers. La question qui se pose alors est : En quoi le projet de
l’Encyclop
édie refl ètetil le XVIII ème si ècle ? Poser le contexte historique qui a été propice à la naissance de ce
projet est donc n
écessaire (I) tout autant que de savoir qu’elles sont id ées conductrices, les principes et les th éories
de cette œuvres (II) mais
également de montrer quelles traces ont été laiss ées par cette œuvre sur les consciences
et quelles en sont les cons
équences sur la R évolution Fran çaise de 1789 (III).
Le contexte historique de l’Encyclop
édie Le contexte historique du XVIII ème si ècle va en effet avoir un impact
fondateur dans la naissance de l’Encyclop
édie car le climat de cette époque, qu’il forme un bilan d ésastreux ou qu’il
soit au contraire tout
à fait élogieux pour les hommes, va être l’impulsion dans l’ émergence de ce projet à ambition
universelle.
Le XVIII
ème si ècle : un si ècle de guerre De la fin du XVII ème si ècle au d ébut du XVIII ème si ècle, la
monarchie absolue de droit divin
était enracin ée en France et a atteint d’ailleurs son apog ée sous le r ègne de Louis
XIV qui meurt en 1715 mais dont la R
évocation de l’ édit de Nantes (ou édit de Fontainebleau) du 18 octobre 1865
condamne toujours les protestants
à la pers écution. La mort de Louis XIV marqua alors un retour à un certain ordre
moral mais n’a pas signifi
é pour autant la fin de nombreuses d écennies o ù les droits fondamentaux des Hommes,
par l’acceptation contemporaine du terme, ont
été bafou és. La R égence qui s’ouvre alors (17151723) fera figure de
renouveau quand
à la gestion politique et financi ère de la France mais ne constituera qu’un simple essoufflement
des maux qui touchaient les hommes
à cette époque. En effet, les guerres et la famine secouent la France sous le
r
ègne de Louis XV (17231774) malgr é l’accalmie qu’il inaugura : guerre de succession d’Autriche (17401748),
rivalit
é coloniale avec l’Angleterre, guerre de Sept Ans (17561763) qui opposa la France à l’Angleterre et à la
Prusse. Cette longue p
ériode a constitu é, et ce avec l’accumulation des d écennies pr écédentes, une contestation
de plus en plus s
évère des individus envers les d étenteurs du pouvoir, envers les monarques, un peuple de plus en
plus en proie
à revendiquer, et de mani ère massive et agressive, des droits. Mais le tableau du XVIII ème si ècle n’est
pas pour autant d
énué de toutes nuances et s’av ère être plut ôt, pourraiton dire, gris é.
Le XVIII
ème si ècle : une p ériode d’ émancipation des savoirs En effet, au cours du XVIII ème si ècle s’est accru
la fr
équentation des lieux de d ébat, propices au travail de l’opinion publique, que sont tout d’abord les caf és comme
le Procope
à Paris o ù se r éunissaient des écrivains et philosophes notamment Voltaire, Diderot, Marmontel et
Fontenelle (qui seront partisans du projet de l’Encyclop
édie). Les salons mondains ont également jou é un r ôle dans
la diffusion du savoir mais
était plus durs d’acc ès ne seraitce que par la difficult é d’en entreprendre la cr éation.
Chaque h
ôtesse avait ses sp écialit és et ses invit és particuliers, par exemple l’h ôtel de la marquise de Lambert, o ù
é
taient organis ées des r éunions d’hommes de lettre. Madame Necker re çeva d’ailleurs les encyclop édistes. Dans la
continuit
é de ce qui pourrait être qualifi é de « marche du progr ès » germent les acad émies au XVII ème si ècle et ce
de mani
ère plus significative au XVIII ème si ècle.
En France, apr ès les fondations monarchiques du XVIIe si ècle
(Acad
émie fran çaise, 1634; Acad émie des inscriptions et belleslettres, 1663; Acad émie royale des sciences, 1666;
Acad
émie royale d'architecture, 1671), naissent encore à Paris l'Acad émie royale de chirurgie (1731) et la Soci été
royale de m
édecine (1776) En province, il y a neuf acad émies en 1710 contre 35 en 1789. Il n’est cependant pas
anodin de noter que ces soci
étés provinciales regroupaient les élites intellectuelles des villes fran çaises.
La
composition sociale montre que les privil
égiés y étaient majoritairement pr ésents, notamment à Paris avec 37% de
nobles, 20% d’eccl
ésiastes, 3% de roturiers et seulement 4% de marchands et de manufacturiers.
Cette
é
mancipation des structures intellectuelles mais également les guerres qui assombrissent le tableau sont à relier à .
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓