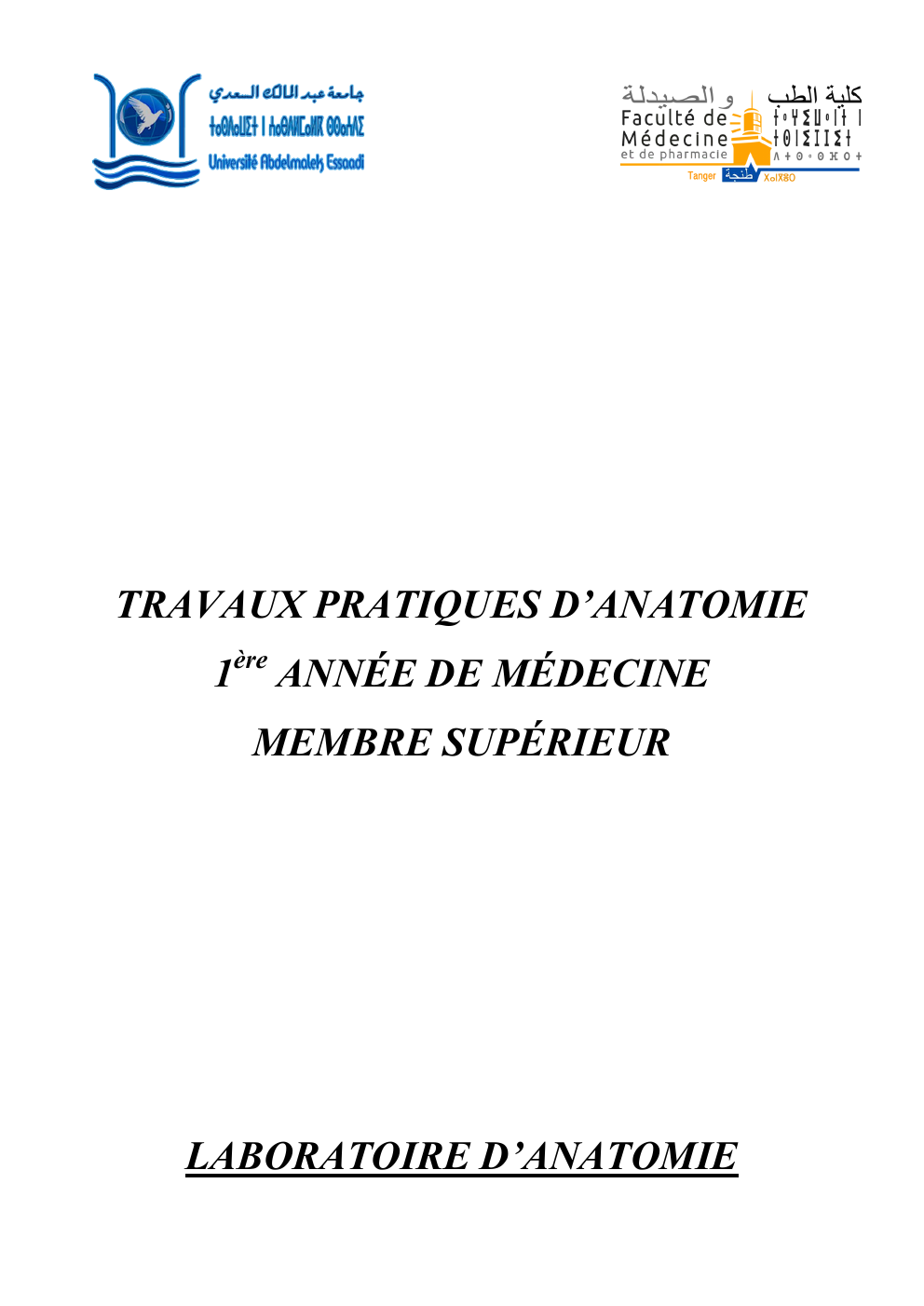anatomie MEMBRE SUPÉRIEUR LABORATOIRE D’ANATOMIE
Publié le 23/02/2025
Extrait du document
«
TRAVAUX PRATIQUES D’ANATOMIE
1ère ANNÉE DE MÉDECINE
MEMBRE SUPÉRIEUR
LABORATOIRE D’ANATOMIE
LA CLAVICULE
I.
Définition :
Os allongé en forme de « S » étiré, la clavicule est l’élément antérieur des os du
squelette de la ceinture scapulaire.
II.
Situation :
Elle s’articule :
En dedans avec le sternum
En dehors avec la scapula
III.
Orientation :
L’extrémité volumineuse est médiale
La face inférieure est rugueuse
La grande convexité est médiale et antérieure.
IV.
Forme anatomique générale :
A.
Le corps
Comprend 2 faces et 2 bords
a.
Les faces :
Face supérieure(1)Lisse, sous cutanée, palpable et saillante chez les sujets amaigris.
Face inférieure(2)Rugueuse, centrée par une gouttière(3) où s’insère le muscle
subclavier.
De chaque côté de cette gouttière existe une zone d’insertion ligamentaire
avec :
o En dedans : l’empreinte du ligamentcosto-claviculaire(4)
o En dehors : l’empreinte desligaments coraco-claviculaires (5) avec ses 2
tubercules :
Conoïde(6)en arrière,
Trapézoïde(7) en avant.
b.
Les bords :
Bord antérieur : (8)
- Dans sa partie médiale, il est convexe et donne insertion au muscle grand
pectoral(9).
- Dans sa partie latérale, il est concave et donne insertion au muscle deltoïde(10).
UPR d’anatomie
Laboratoire d’anatomie
Page 2
Bord postérieur : (11)
- Dans sa partie médiale, il est concave et donne insertion au muscle sterno-cléïdomastoïdien(12).
- Dans sa partie latérale, il est convexe et donne insertion au muscle trapèze(13).
B.
Les épiphyses
Epiphyse médiale ou sternale(14) :Volumineuse, arrondie, comprend une surface
articulaire(15) avec le sternum.
Epiphyse latérale ou acromiale(16) :Mince, aplatie dans le sens vertical, porte une
facette articulaire (17) avec l’acromion.
V.
Repères anatomiques palpables :
Os sous cutané, entièrement palpable sauf sur sa face inférieure.
VI.
Applications cliniques
Fracture de la clavicule, fréquente lors des accidents de la voie publique
1- fracture de la clavicule
Fréquence : Les fractures de la clavicule sont fréquentes, notamment lors des accidents de la voie publique ou
des chutes.
Localisation : La majorité des fractures se produisent au tiers moyen de la clavicule.
Symptômes : Douleur intense, déformation visible, et difficulté à bouger le bras.
2-luxation acromio-claviculaire
Description : Cette luxation se produit lorsque l'extrémité latérale de la clavicule se sépare de l'acromion de la
scapula.
Causes : Souvent causée par un traumatisme direct à l'épaule, comme une chute sur le côté.
Symptômes : Douleur à l'épaule, gonflement, et une bosse visible à l'extrémité de la clavicule.
3- syndrome de la pince costo claviculaire
Description : Ce syndrome se produit lorsque la clavicule comprime les structures neurovasculaires entre elle
et la première côte.
Symptômes : Douleur, engourdissement, et faiblesse dans le bras et la main.
4- ossification et croissance
Ossification : La clavicule est le premier os à commencer l'ossification (vers le 30ème jour in utero) et le
dernier à la terminer (vers 25 ans).
Applications : Les anomalies de l'ossification peuvent entraîner des malformations ou des fragilités osseuses,
nécessitant une surveillance et un traitement approprié.
UPR d’anatomie
Laboratoire d’anatomie
Page 3
UPR d’anatomie
Laboratoire d’anatomie
Page 4
LA SCAPULA
I.
Définition :
C’est un os plat et triangulaire de la ceinture scapulaire.
Situé dans la région postérosupérieure du thorax.
II.
Situation :
La scapula est amarrée par des muscles à la paroi thoracique postérieure, en regard de la
2e à la 7e cote.
Elle s’articule :En dehors avec l’humérus.
III.
IV.
Orientation :
La face antérieure ou costale est concave.
La cavité glénoïdale est supérieure et latérale.
Forme anatomique générale :
La scapula présente deux faces, trois bords et trois angles :
A.
Faces :
1.
Face costale (antérieure) : (1)
Excavée, elle constitue la fosse subscapulaire.
Donne insertion :Aumuscle subscapulaire, sur sa plus grande surface.
2.
Face postérieure (dorsale) : (2)
Elle est divisée en deux fosses, supra-épineuse et infra-épineuse, par l’épine de la
scapula :
a.
L’épine de la scapula (3)
Aplatie et triangulaire, est implantée perpendiculairement au niveau du
quart supérieur de la face postérieure.
Elle présente deux lèvres :
o Supérieure (4)où s’insère le muscle trapèze.
o Inférieure (5)où s’insère le muscle deltoïde.
Elle se termine latéralement par l’acromion (6)qui est un volumineux
processus projeté en avant, au dessus de la cavité glénoïdale.
b.
La fosse supra-épineuse (7) : Donne insertion au muscle supra-épineux.
c.
La fosse infra-épineuse (8) : Présente, le long du bord axillaire, une crête
qui limite :
Une aire médiale, où s’insère le muscle infra-épineux.
Une aire latérale, où s’insère les muscles, petit et grand ronds.
UPR d’anatomie
Laboratoire d’anatomie
Page 5
B.
Bords :
1.
Le bord supérieur ou cervical(9)
Mince et séparé du processus coracoïde par l’incisure scapulaire(10).
Dans cette incisure passe l’artère et le nerf supra-scapulaire.
Donne insertion au muscle omo-hyoïdien.
2.
Le bord médial ou spinal(11) : Sur son versant postérieur, s’insèrent le muscle
élévateur de la scapula au dessus de l’épine, et les muscles petit et grand
rhomboïde au dessous de l’épine.
3.
Le bord latéralou axillaire (12) : Mince, il s’épaissit au niveau du col de la
scapula.
C.
Angles :
4.
L’angle supérieur(13) : Il est presque droit, et donne insertion au muscle
angulaire
5.
L’angle inférieur(14) : Il est arrondi et se projette en regard de la septième
vertèbre thoracique (T7)
6.
L’angle latéral : Il présente le processus coracoïde et la cavité glénoïdale
portée par le col de la scapula.
o
a.
Processus coracoïde(15)
Donne insertion auxmuscles coraco-brachial, court chef du biceps
brachial et le muscle petit pectoral.
o
o
b.
La cavité glénoïdale(16)
Orientée en avant et latéralement, s’articule avec la tête humérale
Ovalaire, à grosse extrémité inférieure, en son centre le tubercule
glénoïdale.
o
V.
c.
Le col de la scapula(17)
Epais, présente le tubercule supra glénoïdal(18) et infra
glénoïdal(19)qui donnent insertion respectivement aux chefs longs du
biceps brachial et du triceps brachial.
Repères anatomiques palpables :
L’épine, l’acromion, la pointe inférieure, le bord médial et le processus coracoïde.
VI.
Applications cliniques :
Fracture du col de la scapula (intervention chirurgicale parfois nécessaire).
L’acromion est un point de repère anatomique dans l’abord chirurgical de l’épaule.
UPR d’anatomie
Laboratoire d’anatomie
Page 6
UPR d’anatomie
Laboratoire d’anatomie
Page 7
UPR d’anatomie
Laboratoire d’anatomie
Page 8
L’ HUMERUS
I.
Définition :
Os long, pair, asymétrique qui constitue le squelette du bras, formé d’une diaphyse et deux
épiphyses.
II.
Situation :
Il s’articule en haut, en dedans et en arrière avec la cavité glénoïdale de la scapula et en bas
avec les deux os de l’avant-bras.
III.
Orientation :
La surface sphérique en haut et en dedans.
la fosse olécranienne en bas et en arrière.
IV.
Forme anatomique générale :
A.
Epiphyse proximale :
Volumineuse, elle comprend la tête humérale, le col anatomique, le col chirurgical, les
tubercules majeur et mineur, et le sillon intertuberculaire
a.
La tête humérale (1)
Saillie articulaire, elle correspond au tiers d’une sphère.
Regarde médialement, en haut et légèrement en arrière.
Son axe d’orientation forme avec l’axe de la diaphyse un angle de 130°
b.
Le col anatomique (2)
Discret rétrécissement, il sépare la tête humérale des tubercules.
Donne insertion à la capsule articulaire.
c.
Le col chirurgical : (3)Union de l’épiphyse proximale et de la diaphyse.
d.
Le tubercule majeur : (4)
Grosse saillie latérale.
Donne insertion aux muscles supra-épineux, infra-épineux, petit rond
et au ligament coraco-huméral.
e.
le tubercule mineur :(5) Petite saillie antérieure qui donne insertion au muscle
subscapulaire, et au ligament coraco-huméral.
f.
le sillon intertuberculaire : (6)
Parcouru par le long chef du muscle biceps brachial.
Présente deux lèvres, où s’insèrent trois muscles :
o le muscle grand pectoralsur la lèvre latérale,
o le muscle grand dorsal, et le muscle grand rondsur la lèvre
médiale.
UPR d’anatomie
Laboratoire d’anatomie
Page 9
B.
Diaphyse :
Triangulaire à la coupe, possède trois faces et trois bords.
a) La face antéro-médiale : (7)
A sa partie moyenne s’insère le muscle coraco-brachial
Sur sa moitié inférieure, s’insère le muscle brachial.
b) La face antéro-latérale : (8)
Caractérisée dans sa partie supérieure par une empreinte en forme de « V », appeléele
« V » deltoïdien ou tubérosité deltoïdienne(9) qui donne insertion au muscle
deltoïde.Sur sa moitié inférieure s’insère le muscle brachial.
c) La face postérieure : (10)
Sa partie moyenne est creusée par le sillon du nerf radial (ou sillon spiral)(11).
Oblique en bas et latéralement, il est parcouru par le nerf radialet les vaisseaux
brachiaux profonds.
Au dessus de ce sillon s’insère le chef latéral du muscle triceps brachial.
Au dessous de ce sillon s’insère le chef médial du muscle triceps brachial.
d) Le bord antérieur :(12)
Formé en haut par la lèvre latérale du sillon intertuberculaire, puis la branche
médiale du « V » deltoïdien, il devient mousse dans sa partie inférieure et se termine
en deux branches qui limitent la fossette coronoïde(13).
e) Le bord latéral : (14)
Se prolonge du....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Anatomie : La ceinture pelvienne du membre inférieurOstélogie :La ceinture du membre inférieur ou pelvienne est constituée par l sacrum et les deux os coxaux reliés entre euxpar les articulation sacro-iliaques et a symphyse pubienne.
- 03/01/11 DEMONDION Anatomie Arthrologie du membre inférieur I- Articulation coxo-fémorale.
- Médecine première annéeAnatomieAnatomie : Membre supérieure, l'épauleI) IntroductionLe membre supérieur est encore appelé membre thoracique.
- OSTÉOLOGIE DU MEMBRE SUPÉRIEUR: LE RADIUS
- CASTELNAU, Edouard de Curières de (1851-1944)Général, il est nommé sous-chef d'état-major de l'armée, puis membre du Conseil supérieur de la guerre en 1911.