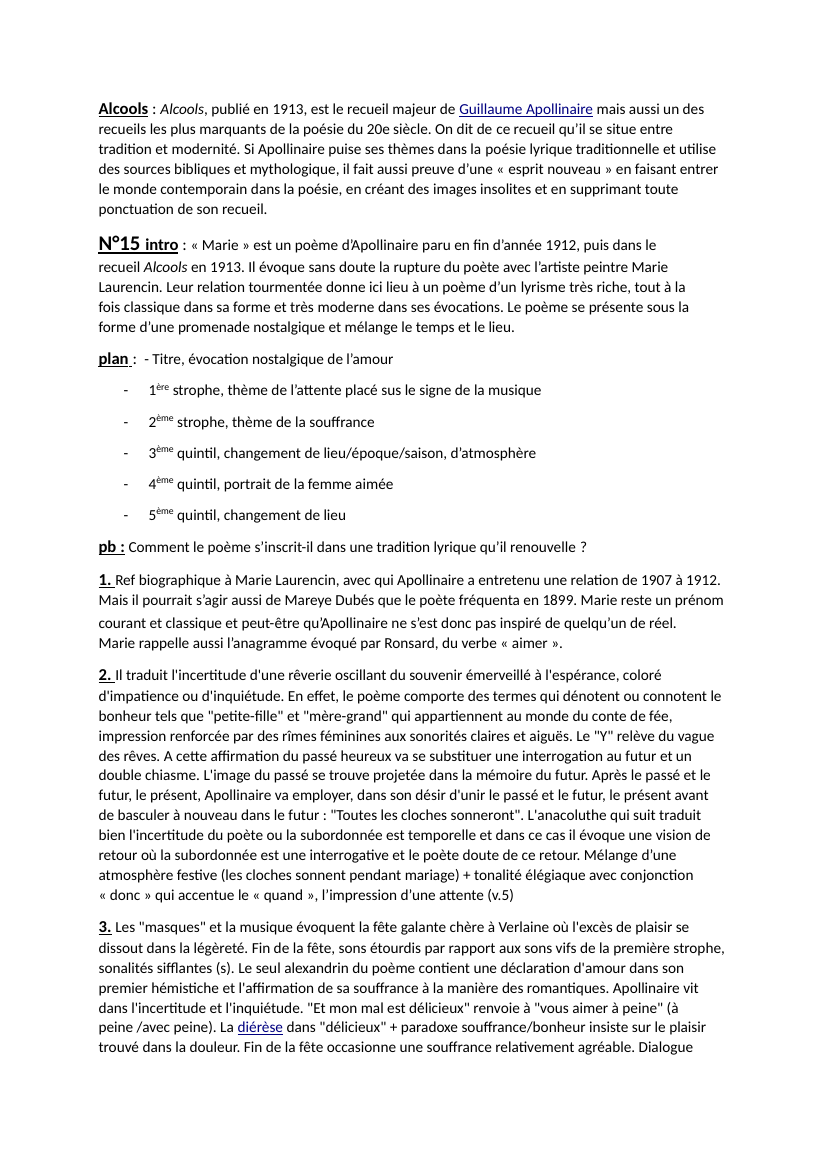analyse linéaire Marie d’Apollinaire
Publié le 15/10/2021

Extrait du document
«
Alcools : Alcools , publié en 1913, est le recueil majeur de Guillaume Apollinaire mais aussi un des
recueils les plus marquants de la poésie du 20e siècle.
On dit de ce recueil qu’il se situe entre
tradition et modernité.
Si Apollinaire puise ses thèmes dans la poésie lyrique traditionnelle et utilise
des sources bibliques et mythologique, il fait aussi preuve d’une « esprit nouveau » en faisant entrer
le monde contemporain dans la poésie, en créant des images insolites et en supprimant toute
ponctuation de son recueil.
N°15 intro : « Marie » est un poème d’Apollinaire paru en fin d’année 1912, puis dans le
recueil Alcools en 1913.
Il évoque sans doute la rupture du poète avec l’artiste peintre Marie
Laurencin.
Leur relation tourmentée donne ici lieu à un poème d’un lyrisme très riche, tout à la
fois classique dans sa forme et très moderne dans ses évocations.
Le poème se présente sous la
forme d’une promenade nostalgique et mélange le temps et le lieu.
plan : - Titre, évocation nostalgique de l’amour
- 1 ère
strophe, thème de l’attente placé sus le signe de la musique
- 2 ème
strophe, thème de la souffrance
- 3 ème
quintil, changement de lieu/époque/saison, d’atmosphère
- 4 ème
quintil, portrait de la femme aimée
- 5 ème
quintil, changement de lieu
pb : Comment le poème s’inscrit-il dans une tradition lyrique qu’il renouvelle ?
1.
Ref biographique à Marie Laurencin, avec qui Apollinaire a entretenu une relation de 1907 à 1912.
Mais il pourrait s’agir aussi de Mareye Dubés que le poète fréquenta en 1899.
Marie reste un prénom
courant et classique et peut-être qu’Apollinaire ne s’est donc pas inspiré de quelqu’un de réel.
Marie rappelle aussi l’anagramme évoqué par Ronsard, du verbe « aimer ».
2.
Il traduit l'incertitude d'une rêverie oscillant du souvenir émerveillé à l'espérance, coloré
d'impatience ou d'inquiétude.
En effet, le poème comporte des termes qui dénotent ou connotent le
bonheur tels que "petite-fille" et "mère-grand" qui appartiennent au monde du conte de fée,
impression renforcée par des rîmes féminines aux sonorités claires et aiguës.
Le "Y" relève du vague
des rêves.
A cette affirmation du passé heureux va se substituer une interrogation au futur et un
double chiasme.
L'image du passé se trouve projetée dans la mémoire du futur.
Après le passé et le
futur, le présent, Apollinaire va employer, dans son désir d'unir le passé et le futur, le présent avant
de basculer à nouveau dans le futur : "Toutes les cloches sonneront".
L'anacoluthe qui suit traduit
bien l'incertitude du poète ou la subordonnée est temporelle et dans ce cas il évoque une vision de
retour où la subordonnée est une interrogative et le poète doute de ce retour.
Mélange d’une
atmosphère festive (les cloches sonnent pendant mariage) + tonalité élégiaque avec conjonction
« donc » qui accentue le « quand », l’impression d’une attente (v.5)
3.
Les "masques" et la musique évoquent la fête galante chère à Verlaine où l'excès de plaisir se
dissout dans la légèreté.
Fin de la fête, sons étourdis par rapport aux sons vifs de la première strophe,
sonalités sifflantes (s).
Le seul alexandrin du poème contient une déclaration d'amour dans son
premier hémistiche et l'affirmation de sa souffrance à la manière des romantiques.
Apollinaire vit
dans l'incertitude et l'inquiétude.
"Et mon mal est délicieux" renvoie à "vous aimer à peine" (à
peine /avec peine).
La diérèse dans "délicieux" + paradoxe souffrance/bonheur insiste sur le plaisir
trouvé dans la douleur.
Fin de la fête occasionne une souffrance relativement agréable.
Dialogue.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse linéaire Zone G. Apollinaire
- analyse linéaire extraits de "zone" de Apollinaire
- Analyse Poème Marie Apollinaire
- Analyse linéaire Automne d'Apollinaire
- Analyse linéaire L'émigrant de Landor Road Apollinaire