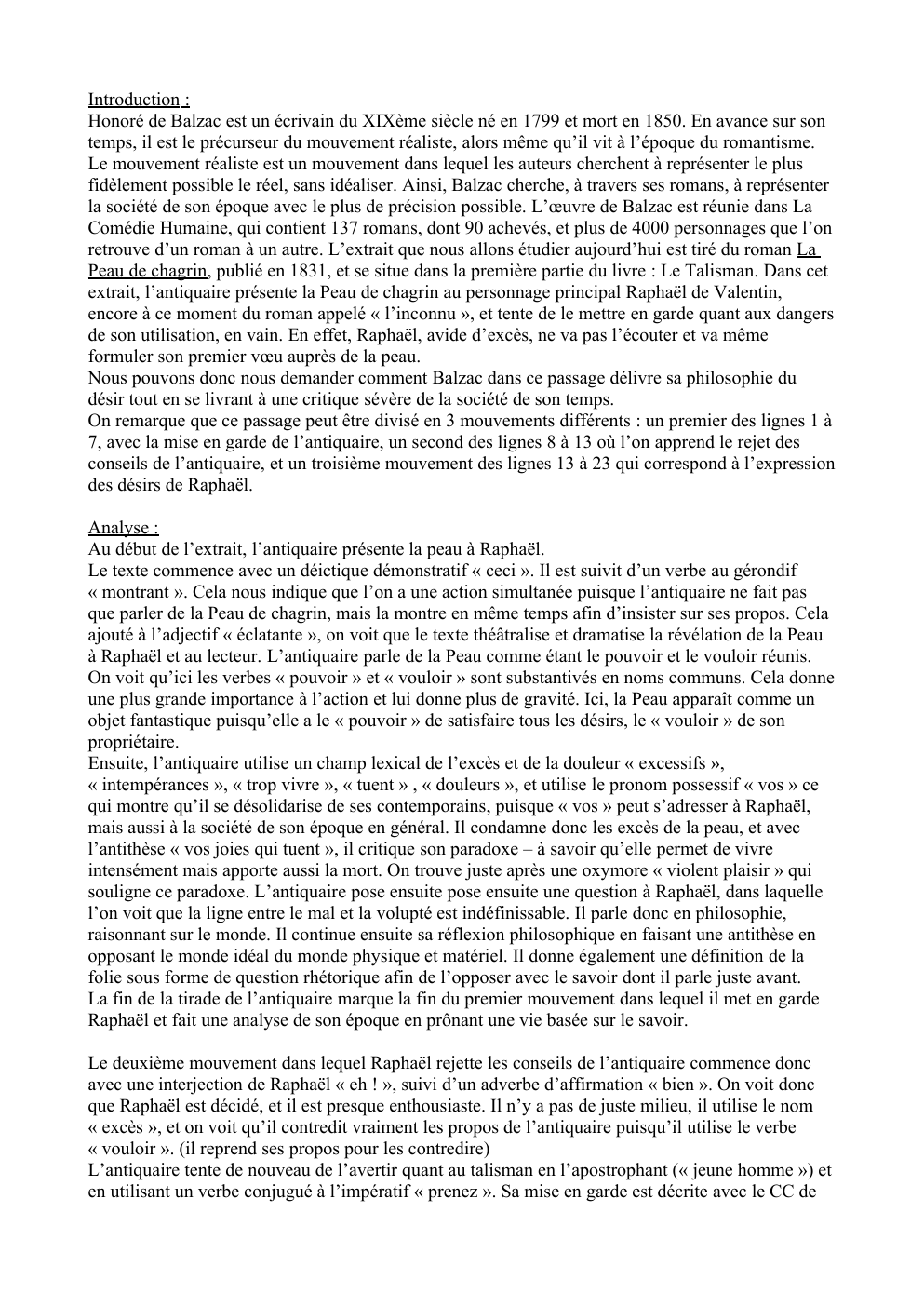Analyse linéaire français la peau de chagrin partie 1
Publié le 07/04/2025
Extrait du document
«
Introduction :
Honoré de Balzac est un écrivain du XIXème siècle né en 1799 et mort en 1850.
En avance sur son
temps, il est le précurseur du mouvement réaliste, alors même qu’il vit à l’époque du romantisme.
Le mouvement réaliste est un mouvement dans lequel les auteurs cherchent à représenter le plus
fidèlement possible le réel, sans idéaliser.
Ainsi, Balzac cherche, à travers ses romans, à représenter
la société de son époque avec le plus de précision possible.
L’œuvre de Balzac est réunie dans La
Comédie Humaine, qui contient 137 romans, dont 90 achevés, et plus de 4000 personnages que l’on
retrouve d’un roman à un autre.
L’extrait que nous allons étudier aujourd’hui est tiré du roman La
Peau de chagrin, publié en 1831, et se situe dans la première partie du livre : Le Talisman.
Dans cet
extrait, l’antiquaire présente la Peau de chagrin au personnage principal Raphaël de Valentin,
encore à ce moment du roman appelé « l’inconnu », et tente de le mettre en garde quant aux dangers
de son utilisation, en vain.
En effet, Raphaël, avide d’excès, ne va pas l’écouter et va même
formuler son premier vœu auprès de la peau.
Nous pouvons donc nous demander comment Balzac dans ce passage délivre sa philosophie du
désir tout en se livrant à une critique sévère de la société de son temps.
On remarque que ce passage peut être divisé en 3 mouvements différents : un premier des lignes 1 à
7, avec la mise en garde de l’antiquaire, un second des lignes 8 à 13 où l’on apprend le rejet des
conseils de l’antiquaire, et un troisième mouvement des lignes 13 à 23 qui correspond à l’expression
des désirs de Raphaël.
Analyse :
Au début de l’extrait, l’antiquaire présente la peau à Raphaël.
Le texte commence avec un déictique démonstratif « ceci ».
Il est suivit d’un verbe au gérondif
« montrant ».
Cela nous indique que l’on a une action simultanée puisque l’antiquaire ne fait pas
que parler de la Peau de chagrin, mais la montre en même temps afin d’insister sur ses propos.
Cela
ajouté à l’adjectif « éclatante », on voit que le texte théâtralise et dramatise la révélation de la Peau
à Raphaël et au lecteur.
L’antiquaire parle de la Peau comme étant le pouvoir et le vouloir réunis.
On voit qu’ici les verbes « pouvoir » et « vouloir » sont substantivés en noms communs.
Cela donne
une plus grande importance à l’action et lui donne plus de gravité.
Ici, la Peau apparaît comme un
objet fantastique puisqu’elle a le « pouvoir » de satisfaire tous les désirs, le « vouloir » de son
propriétaire.
Ensuite, l’antiquaire utilise un champ lexical de l’excès et de la douleur « excessifs »,
« intempérances », « trop vivre », « tuent » , « douleurs », et utilise le pronom possessif « vos » ce
qui montre qu’il se désolidarise de ses contemporains, puisque « vos » peut s’adresser à Raphaël,
mais aussi à la société de son époque en général.
Il condamne donc les excès de la peau, et avec
l’antithèse « vos joies qui tuent », il critique son paradoxe – à savoir qu’elle permet de vivre
intensément mais apporte aussi la mort.
On trouve juste après une oxymore « violent plaisir » qui
souligne ce paradoxe.
L’antiquaire pose ensuite pose ensuite une question à Raphaël, dans laquelle
l’on voit que la ligne entre le mal et la volupté est indéfinissable.
Il parle donc en philosophie,
raisonnant sur le monde.
Il continue ensuite sa réflexion philosophique en faisant une antithèse en
opposant le monde idéal du monde physique et matériel.
Il donne également une définition de la
folie sous forme de question rhétorique afin de l’opposer avec le savoir dont il parle juste avant.
La fin de la tirade de l’antiquaire marque la fin du premier mouvement dans lequel il met en garde
Raphaël et fait une analyse de son époque en prônant une vie basée sur le savoir.
Le deuxième mouvement dans lequel Raphaël rejette les conseils de l’antiquaire commence donc
avec une interjection de Raphaël « eh ! », suivi d’un adverbe d’affirmation « bien ».
On voit donc
que Raphaël est décidé, et il est presque enthousiaste.
Il n’y a pas de juste milieu, il utilise le nom
« excès », et on voit qu’il contredit vraiment les propos de l’antiquaire puisqu’il utilise le verbe
« vouloir ».
(il reprend ses propos pour les contredire)
L’antiquaire tente de nouveau de l’avertir quant au talisman en l’apostrophant (« jeune homme ») et
en utilisant un verbe conjugué à l’impératif « prenez ».
Sa mise en garde est décrite avec le CC de
manière « avec une incroyable vivacité ».
Ici, on a donc une opposition entre « vieillard » et
« vivacité », qui illustre bien la leçon de philosophie qu’il faisait plus tôt et montre que malgré son....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Préparation à l’oral du baccalauréat de français Analyse linéaire n°4 - Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, 1990 (épilogue)
- Analyse linéaire : 1ère Générale Bac de français Extrait de la Satire XI de Boileau Vers 9 à 29
- Analyse linéaire Lagarce Partie 1 scène 8
- Analyse Linéaire Mme de Bovary: Extrait du chapitre VII, Première Partie
- JUSTE LA FIN DU MONDE, JEAN LUC LAGARCE, ANALYSE LINÉAIRE SCÈNE 4, PARTIE I