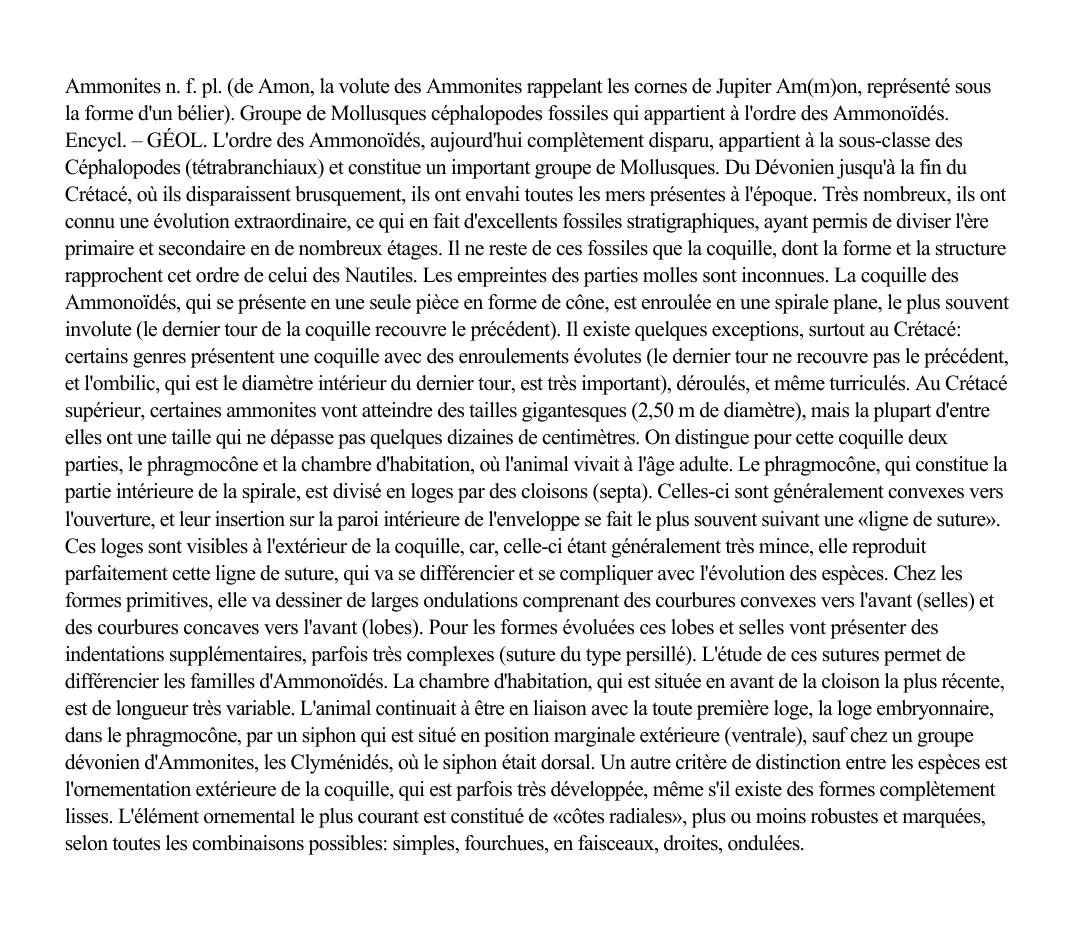Ammonites n.
Publié le 08/12/2021

Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Ammonites n.. Ce document contient 499 mots. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système d’échange gratuit de ressources numériques ou achetez-le pour la modique somme d’un euro symbolique. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en : Dictionnaire
Ammonites n. f. pl. (de Amon, la volute des Ammonites rappelant les cornes de Jupiter Am(m)on, représenté sous
la forme d'un bélier). Groupe de Mollusques céphalopodes fossiles qui appartient à l'ordre des Ammonoïdés.
Encycl. - GÉOL. L'ordre des Ammonoïdés, aujourd'hui complètement disparu, appartient à la sous-classe des
Céphalopodes (tétrabranchiaux) et constitue un important groupe de Mollusques. Du Dévonien jusqu'à la fin du
Crétacé, où ils disparaissent brusquement, ils ont envahi toutes les mers présentes à l'époque. Très nombreux, ils ont
connu une évolution extraordinaire, ce qui en fait d'excellents fossiles stratigraphiques, ayant permis de diviser l'ère
primaire et secondaire en de nombreux étages. Il ne reste de ces fossiles que la coquille, dont la forme et la structure
rapprochent cet ordre de celui des Nautiles. Les empreintes des parties molles sont inconnues. La coquille des
Ammonoïdés, qui se présente en une seule pièce en forme de cône, est enroulée en une spirale plane, le plus souvent
involute (le dernier tour de la coquille recouvre le précédent). Il existe quelques exceptions, surtout au Crétacé:
certains genres présentent une coquille avec des enroulements évolutes (le dernier tour ne recouvre pas le précédent,
et l'ombilic, qui est le diamètre intérieur du dernier tour, est très important), déroulés, et même turriculés. Au Crétacé
supérieur, certaines ammonites vont atteindre des tailles gigantesques (2,50 m de diamètre), mais la plupart d'entre
elles ont une taille qui ne dépasse pas quelques dizaines de centimètres. On distingue pour cette coquille deux
parties, le phragmocône et la chambre d'habitation, où l'animal vivait à l'âge adulte. Le phragmocône, qui constitue la
partie intérieure de la spirale, est divisé en loges par des cloisons (septa). Celles-ci sont généralement convexes vers
l'ouverture, et leur insertion sur la paroi intérieure de l'enveloppe se fait le plus souvent suivant une «ligne de suture».
Ces loges sont visibles à l'extérieur de la coquille, car, celle-ci étant généralement très mince, elle reproduit
parfaitement cette ligne de suture, qui va se différencier et se compliquer avec l'évolution des espèces. Chez les
formes primitives, elle va dessiner de larges ondulations comprenant des courbures convexes vers l'avant (selles) et
des courbures concaves vers l'avant (lobes). Pour les formes évoluées ces lobes et selles vont présenter des
indentations supplémentaires, parfois très complexes (suture du type persillé). L'étude de ces sutures permet de
différencier les familles d'Ammonoïdés. La chambre d'habitation, qui est située en avant de la cloison la plus récente,
est de longueur très variable. L'animal continuait à être en liaison avec la toute première loge, la loge embryonnaire,
dans le phragmocône, par un siphon qui est situé en position marginale extérieure (ventrale), sauf chez un groupe
dévonien d'Ammonites, les Clyménidés, où le siphon était dorsal. Un autre critère de distinction entre les espèces est
l'ornementation extérieure de la coquille, qui est parfois très développée, même s'il existe des formes complètement
lisses. L'élément ornemental le plus courant est constitué de «côtes radiales», plus ou moins robustes et marquées,
selon toutes les combinaisons possibles: simples, fourchues, en faisceaux, droites, ondulées.
Ammonites n. f. pl. (de Amon, la volute des Ammonites rappelant les cornes de Jupiter Am(m)on, représenté sous
la forme d'un bélier). Groupe de Mollusques céphalopodes fossiles qui appartient à l'ordre des Ammonoïdés.
Encycl. - GÉOL. L'ordre des Ammonoïdés, aujourd'hui complètement disparu, appartient à la sous-classe des
Céphalopodes (tétrabranchiaux) et constitue un important groupe de Mollusques. Du Dévonien jusqu'à la fin du
Crétacé, où ils disparaissent brusquement, ils ont envahi toutes les mers présentes à l'époque. Très nombreux, ils ont
connu une évolution extraordinaire, ce qui en fait d'excellents fossiles stratigraphiques, ayant permis de diviser l'ère
primaire et secondaire en de nombreux étages. Il ne reste de ces fossiles que la coquille, dont la forme et la structure
rapprochent cet ordre de celui des Nautiles. Les empreintes des parties molles sont inconnues. La coquille des
Ammonoïdés, qui se présente en une seule pièce en forme de cône, est enroulée en une spirale plane, le plus souvent
involute (le dernier tour de la coquille recouvre le précédent). Il existe quelques exceptions, surtout au Crétacé:
certains genres présentent une coquille avec des enroulements évolutes (le dernier tour ne recouvre pas le précédent,
et l'ombilic, qui est le diamètre intérieur du dernier tour, est très important), déroulés, et même turriculés. Au Crétacé
supérieur, certaines ammonites vont atteindre des tailles gigantesques (2,50 m de diamètre), mais la plupart d'entre
elles ont une taille qui ne dépasse pas quelques dizaines de centimètres. On distingue pour cette coquille deux
parties, le phragmocône et la chambre d'habitation, où l'animal vivait à l'âge adulte. Le phragmocône, qui constitue la
partie intérieure de la spirale, est divisé en loges par des cloisons (septa). Celles-ci sont généralement convexes vers
l'ouverture, et leur insertion sur la paroi intérieure de l'enveloppe se fait le plus souvent suivant une «ligne de suture».
Ces loges sont visibles à l'extérieur de la coquille, car, celle-ci étant généralement très mince, elle reproduit
parfaitement cette ligne de suture, qui va se différencier et se compliquer avec l'évolution des espèces. Chez les
formes primitives, elle va dessiner de larges ondulations comprenant des courbures convexes vers l'avant (selles) et
des courbures concaves vers l'avant (lobes). Pour les formes évoluées ces lobes et selles vont présenter des
indentations supplémentaires, parfois très complexes (suture du type persillé). L'étude de ces sutures permet de
différencier les familles d'Ammonoïdés. La chambre d'habitation, qui est située en avant de la cloison la plus récente,
est de longueur très variable. L'animal continuait à être en liaison avec la toute première loge, la loge embryonnaire,
dans le phragmocône, par un siphon qui est situé en position marginale extérieure (ventrale), sauf chez un groupe
dévonien d'Ammonites, les Clyménidés, où le siphon était dorsal. Un autre critère de distinction entre les espèces est
l'ornementation extérieure de la coquille, qui est parfois très développée, même s'il existe des formes complètement
lisses. L'élément ornemental le plus courant est constitué de «côtes radiales», plus ou moins robustes et marquées,
selon toutes les combinaisons possibles: simples, fourchues, en faisceaux, droites, ondulées.
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓