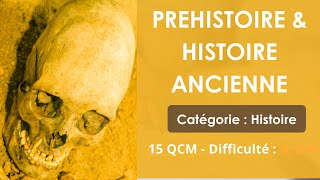BERNSTEIN Henry Léon Gustave
BERNSTEIN Henry Léon Gustave. Auteur dramatique français. Né et mort à Paris (20 juin 1876-27 novembre 1953). Fils du financier Marcel Bernstein, il eut très jeune des dispositions pour le théâtre. Étant soldat (1897) il se révélé farouche antimilitariste : après quelques mois de service, il abandonne son unité et se réfugie à Bruxelles. Amnistié, il rentre en France et se met à écrire des pièces. Découvert par le fameux Antoine, fondateur du Théâtre libre, il fit jouer d’abord Le Marché (1900), puis Le Retour (1902) et Le Bercail (1904), qui obtinrent un certain succès. Son tempérament véritable se révèle dans La Rafale (1905) que suivirent Le Voleur (1906), Samson (1907), Israël (1908) et L’Assaut (1912). Ces œuvres ressortissent au genre frénétique. En sûr technicien de la scène, l’auteur y porte au maximum l’action de choc par le moyen d’une mécanique impitoyable. Choisissant ses héros dans l’élite la plus douteuse, il met à nu toute la misère que comporte l’appétit des sens que viennent corser les jeux de la Bourse et les dessous de la politique. Ce théâtre brutal agit plus sur les nerfs que sur l’esprit du spectateur. Mais Le Secret (1913) marque un tournant dans la carrière de Bernstein. Sans tempérer, Certes, sa manière, l’auteur ne laisse pas de l’élargir jusqu’à l’étude de caractère. En 1914, il est mobilisé dans l’armée d’Orient, où il gagne l’estime de ses chefs. Il en rapportera le sujet de Judith, beau drame biblique représenté en 1922. L’évolution amorcée dans cette pièce allait dès lors se poursuivre sans interruption : c’est d’abord La Galerie des glaces (1924) puis Le Venin (1927), Mélo (1929), Espoir (1935) et Elvire (1939). Dédaignant de plus en plus l’intrigue au profit de la psychologie, Bernstein devait finir par confondre son art avec celui du romancier. Orgueilleux, difficile, conscient de sa valeur et susceptible à l’excès, il prenait mal toute critique de ses œuvres. On sait du reste qu’il eut une douzaine de duels retentissants : le dernier en date fut celui qui l’opposa à Édouard Bourdet, alors administrateur de la Comédie-Française. Remarquable épéiste, Bernstein eut souvent le dessus. Durant toute la guerre de 1940, il vécut aux États-Unis. De retour à Paris, il y fit jouer de nouvelles pièces, en tous points semblables aux précédentes et avec le même succès. Retenons La Soif (1950). On ne compte pas un seul échec dans toute la carrière de Bernstein : possédant un théâtre, il pouvait, en effet, engager les interprètes qui avaient l’oreille du public et maintenir ses œuvres à l’affiche contre la critique la plus rétive. On n’en voit pas moins le défaut de la cuirasse : habile à repérer chaque fois le sujet capable de plaire, il subordonne à l’interprète son propre système dramatique. Si bien que, souvent, ses personnages ne vivent guère dans notre esprit que l’espace d’une représentation. Cette seule remarque suffit sans doute pour indiquer les limites de son théâtre qu’il semble ne pas avoir ignorées lui-même; ayant posé encore enfant pour Claude Monet il disait sur ces vieux jours : « Ce beau portrait, c’est peut-être tout ce qui restera de moi. » ♦ « Espoir, de Bernstein, au Gymnase. Là comme dans toutes ses pièces, Henry Bernstein se roule dans les situations gênantes comme un cheval dans l’herbe. » Julien Green. ♦ .« Dans la chronique du Temps, de Brisson, lettre de Bernstein qui donne assez exactement la mesure de sa valeur. Ne pas comprendre la valeur esthétique de l’honnête homme, quelle infirmité ! Mais Berstein écrit : « Nous sommes des touristes en quête fiévreuse de pittoresque. » D'où, dans ses drames, cette esthétique de Buttes-Chaumont. » André Gide. « Il possède à un degré supérieur le don de passionner la foule. On peut critiquer ses œuvres, on peut les discuter, prendre parti à droite et à gauche; on va les voir. » Pierre Bathille. ♦ « En vérité, on peut dire qu'au purin des écuries d'Augias de ce qu'on appelle la vie parisienne, M. Henry Bernstein a largement ajouté. » Victor Basch.