BEAU
Du latin bellus, « joli », « charmant ».
Norme d’appréciation du jugement esthétique. Cette notion s’applique aux objets naturels comme aux œuvres d’art susceptibles d’éveiller chez l’homme un plaisir désintéressé, appelé « émotion esthétique ».
• Chez Platon, la beauté sensible est un écho affaibli de l'idée de beau, à laquelle l’âme humaine peut accéder en s'élevant progressivement de l’amour des beaux corps à l'amour des belles actions, puis à l'amour des belles sciences, pour contempler enfin la Beauté en soi, pure et inconditionnée. • 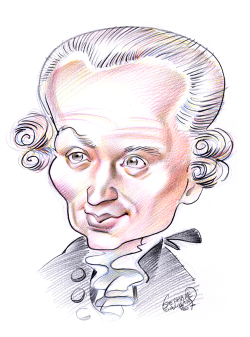 Pour Kant, « est beau ce qui plaît universellement sans concept » : le jugement esthétique prétend en effet à l'universalité (ce que je trouve beau, j'estime que tout le monde devrait le trouver beau), sans qu'il soit possible d'en prouver la validité par des arguments rationnels (cette universalité ne repose pas sur des concepts). • Dans la lignée de Platon, Hegel définit le beau comme « la manifestation sensible de l'idée » : située entre le sensible et la pensée pure, la beauté artistique nous met en présence de la vérité.
Pour Kant, « est beau ce qui plaît universellement sans concept » : le jugement esthétique prétend en effet à l'universalité (ce que je trouve beau, j'estime que tout le monde devrait le trouver beau), sans qu'il soit possible d'en prouver la validité par des arguments rationnels (cette universalité ne repose pas sur des concepts). • Dans la lignée de Platon, Hegel définit le beau comme « la manifestation sensible de l'idée » : située entre le sensible et la pensée pure, la beauté artistique nous met en présence de la vérité.
=> Agréable, art, esthétique, goût, sublime.
BEAU. adj. et n.m. Ce qui donne un plaisir désintéressé (esthétique), à la vue, à l'ouïe. La théorie du beau se trouve en particulier chez Kant. « Est beau ce qui procède d'une nécessité intérieure de l’âme (...), ce qui affine et enrichit l'âme » (Kandinsky, 1910).
BEAU, BEAUTÉ
La facilité avec laquelle la beauté peut être reconnue, indépendamment des œuvres d’art, à des choses ou des personnes spontanément qualifiées de « belles » (un beau paysage) sans même qu’elles présentent forcément un intérêt esthétique (une belle farce) laisse présager de la difficulté rencontrée lorsque la philosophie entreprend de définir le beau de façon normative.
♦ On peut, en effet, soit reconnaître un caractère de beauté aux choses de la nature aussi bien qu’à celles produites par l’homme, soit réserver le concept de beau exclusivement à celles-ci. De part et d’autre, on peut s’accorder pour admettre que le beau correspond à ce qui suscite chez l’homme une satisfaction spécifique, mais dans le deuxième cas, il faut se demander si tous les objets artistiques produits par l’ensemble des cultures humaines à travers leur histoire peuvent répondre à des normes universelles. Dans cette optique, les quatre formules avancées par Kant dans la Critique de la faculté de juger gardent une certaine portée, même si l’on est obligé de les assouplir en fonction des caractères de certaines catégories d’objets d’art : ainsi, on peut admettre que le beau est l’objet d’une satisfaction nécessaire et universelle à condition de préciser que cette universalité est de droit plus que de fait et dépend du niveau culturel des individus ; on peut aussi affirmer qu’est beau ce qui plaît « sans concept » pour souligner que l’œuvre concerne davantage la sensibilité que l’intellect (bien qu’existe dans l’art moderne un art dit « conceptuel ») ou rappeler que « le beau est la forme de la finalité d’un objet en tant qu’elle y est perçue sans représentation d’une fin » (mais il y a dans l’art du XXe siècle de nombreuses œuvres dont le principe est d’ignorer toute cohésion interne) ; il est plus difficile de maintenir que la satisfaction que procure le beau soit « désintéressée » depuis que Freud a pour sa part montré que l’œuvre d’art est le résultat d’une sublimation qui dissimule la nature sexuelle de son fondement.
BEAU
En philosophie, s’emploie comme nom : le beau.
1. Une des trois valeurs fondamentales auxquelles se réfèrent les jugements d’appréciation (le bien représente la valeur morale, le vrai la valeur intellectuelle et le beau la valeur esthétique). Le beau est relatif à la sensibilité, le bien est relatif à l’action et le vrai à l’intelligence.
2. Ce qui, par son équilibre, son harmonie, provoque une émotion esthétique (le beau se rencontre en musique comme en peinture).
3. Sens non esthétique dans l’emploi de l’adjectif pour indiquer une certaine élégance morale (un beau geste) ou pratique (une belle occasion).
BEAU (adjectif et n. m.) 1. — Norme permettant le jugement esthétique ; cf. valeur. 2. — Sens concret : objet du jugement esthétique ; ce qui provoque une émotion esthétique par l’harmonie des formes, l’équilibre des proportions. 3. — (par extension) Ce qui suscite une idée de noblesse, de supériorité morale (un beau geste). 4. — Pour Kant, le jugement de goût ne détermine pas son objet en le pensant sous un concept universel, puisqu’il porte toujours sur un cas particulier ; c’est un jugement réfléchissant dont l’universalité réside dans l’accord des sujets ; c’est pourquoi le beau est défini comme « ce qui plaît universellement sans concept » ; « la beauté est la forme de la finalité d'un objet en tant qu’elle est perçue en lui sans représentation d’une fin. »
