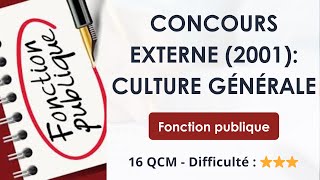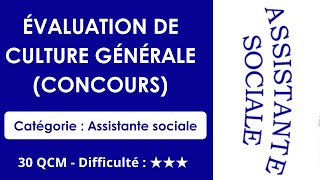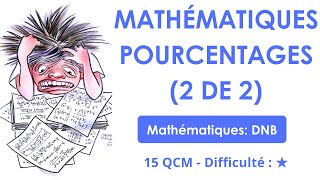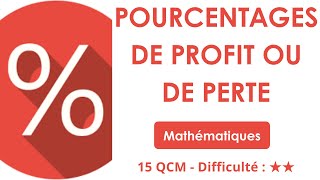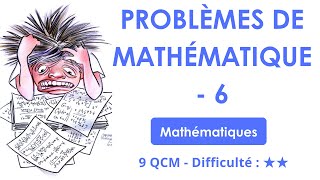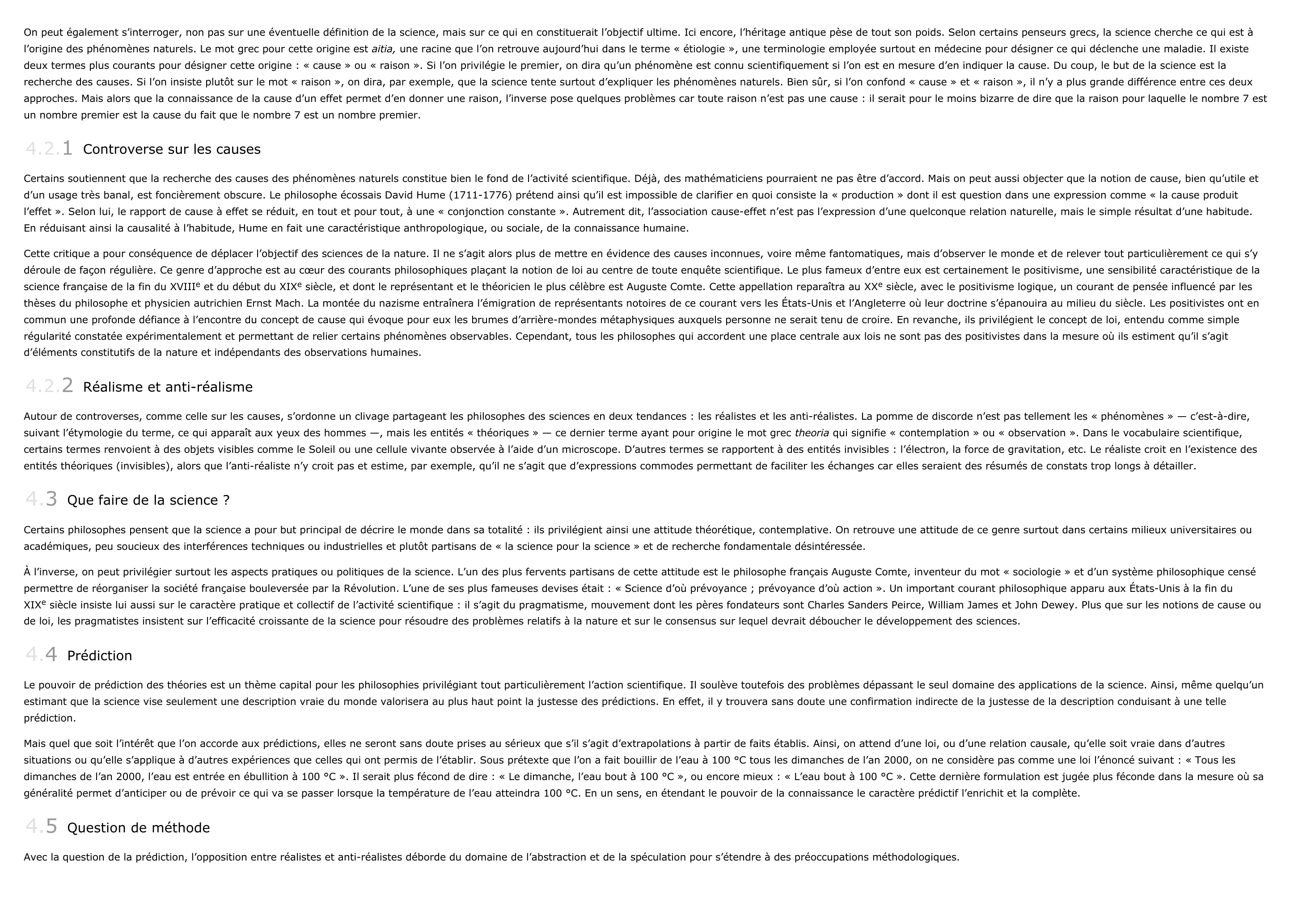sciences, philosophie des - science.
Publié le 27/04/2013
Extrait du document


«
On peut également s’interroger, non pas sur une éventuelle définition de la science, mais sur ce qui en constituerait l’objectif ultime.
Ici encore, l’héritage antique pèse de tout son poids.
Selon certains penseurs grecs, la science cherche ce qui est à
l’origine des phénomènes naturels.
Le mot grec pour cette origine est aitia, une racine que l’on retrouve aujourd’hui dans le terme « étiologie », une terminologie employée surtout en médecine pour désigner ce qui déclenche une maladie.
Il existe
deux termes plus courants pour désigner cette origine : « cause » ou « raison ».
Si l’on privilégie le premier, on dira qu’un phénomène est connu scientifiquement si l’on est en mesure d’en indiquer la cause.
Du coup, le but de la science est la
recherche des causes.
Si l’on insiste plutôt sur le mot « raison », on dira, par exemple, que la science tente surtout d’expliquer les phénomènes naturels.
Bien sûr, si l’on confond « cause » et « raison », il n’y a plus grande différence entre ces deux
approches.
Mais alors que la connaissance de la cause d’un effet permet d’en donner une raison, l’inverse pose quelques problèmes car toute raison n’est pas une cause : il serait pour le moins bizarre de dire que la raison pour laquelle le nombre 7 est
un nombre premier est la cause du fait que le nombre 7 est un nombre premier.
4.2. 1 Controverse sur les causes
Certains soutiennent que la recherche des causes des phénomènes naturels constitue bien le fond de l’activité scientifique.
Déjà, des mathématiciens pourraient ne pas être d’accord.
Mais on peut aussi objecter que la notion de cause, bien qu’utile et
d’un usage très banal, est foncièrement obscure.
Le philosophe écossais David Hume (1711-1776) prétend ainsi qu’il est impossible de clarifier en quoi consiste la « production » dont il est question dans une expression comme « la cause produit
l’effet ».
Selon lui, le rapport de cause à effet se réduit, en tout et pour tout, à une « conjonction constante ».
Autrement dit, l’association cause-effet n’est pas l’expression d’une quelconque relation naturelle, mais le simple résultat d’une habitude.
En réduisant ainsi la causalité à l’habitude, Hume en fait une caractéristique anthropologique, ou sociale, de la connaissance humaine.
Cette critique a pour conséquence de déplacer l’objectif des sciences de la nature.
Il ne s’agit alors plus de mettre en évidence des causes inconnues, voire même fantomatiques, mais d’observer le monde et de relever tout particulièrement ce qui s’y
déroule de façon régulière.
Ce genre d’approche est au cœur des courants philosophiques plaçant la notion de loi au centre de toute enquête scientifique.
Le plus fameux d’entre eux est certainement le positivisme, une sensibilité caractéristique de la
science française de la fin du XVIII e et du début du XIX e siècle, et dont le représentant et le théoricien le plus célèbre est Auguste Comte.
Cette appellation reparaîtra au XXe siècle, avec le positivisme logique, un courant de pensée influencé par les
thèses du philosophe et physicien autrichien Ernst Mach.
La montée du nazisme entraînera l’émigration de représentants notoires de ce courant vers les États-Unis et l’Angleterre où leur doctrine s’épanouira au milieu du siècle.
Les positivistes ont en
commun une profonde défiance à l’encontre du concept de cause qui évoque pour eux les brumes d’arrière-mondes métaphysiques auxquels personne ne serait tenu de croire.
En revanche, ils privilégient le concept de loi, entendu comme simple
régularité constatée expérimentalement et permettant de relier certains phénomènes observables.
Cependant, tous les philosophes qui accordent une place centrale aux lois ne sont pas des positivistes dans la mesure où ils estiment qu’il s’agit
d’éléments constitutifs de la nature et indépendants des observations humaines.
4.2. 2 Réalisme et anti-réalisme
Autour de controverses, comme celle sur les causes, s’ordonne un clivage partageant les philosophes des sciences en deux tendances : les réalistes et les anti-réalistes.
La pomme de discorde n’est pas tellement les « phénomènes » — c’est-à-dire,
suivant l’étymologie du terme, ce qui apparaît aux yeux des hommes —, mais les entités « théoriques » — ce dernier terme ayant pour origine le mot grec theoria qui signifie « contemplation » ou « observation ».
Dans le vocabulaire scientifique,
certains termes renvoient à des objets visibles comme le Soleil ou une cellule vivante observée à l’aide d’un microscope.
D’autres termes se rapportent à des entités invisibles : l’électron, la force de gravitation, etc.
Le réaliste croit en l’existence des
entités théoriques (invisibles), alors que l’anti-réaliste n’y croit pas et estime, par exemple, qu’il ne s’agit que d’expressions commodes permettant de faciliter les échanges car elles seraient des résumés de constats trop longs à détailler.
4. 3 Que faire de la science ?
Certains philosophes pensent que la science a pour but principal de décrire le monde dans sa totalité : ils privilégient ainsi une attitude théorétique, contemplative.
On retrouve une attitude de ce genre surtout dans certains milieux universitaires ou
académiques, peu soucieux des interférences techniques ou industrielles et plutôt partisans de « la science pour la science » et de recherche fondamentale désintéressée.
À l’inverse, on peut privilégier surtout les aspects pratiques ou politiques de la science.
L’un des plus fervents partisans de cette attitude est le philosophe français Auguste Comte, inventeur du mot « sociologie » et d’un système philosophique censé
permettre de réorganiser la société française bouleversée par la Révolution.
L’une de ses plus fameuses devises était : « Science d’où prévoyance ; prévoyance d’où action ».
Un important courant philosophique apparu aux États-Unis à la fin du
XIX e siècle insiste lui aussi sur le caractère pratique et collectif de l’activité scientifique : il s’agit du pragmatisme, mouvement dont les pères fondateurs sont Charles Sanders Peirce, William James et John Dewey.
Plus que sur les notions de cause ou
de loi, les pragmatistes insistent sur l’efficacité croissante de la science pour résoudre des problèmes relatifs à la nature et sur le consensus sur lequel devrait déboucher le développement des sciences.
4. 4 Prédiction
Le pouvoir de prédiction des théories est un thème capital pour les philosophies privilégiant tout particulièrement l’action scientifique.
Il soulève toutefois des problèmes dépassant le seul domaine des applications de la science.
Ainsi, même quelqu’un
estimant que la science vise seulement une description vraie du monde valorisera au plus haut point la justesse des prédictions.
En effet, il y trouvera sans doute une confirmation indirecte de la justesse de la description conduisant à une telle
prédiction.
Mais quel que soit l’intérêt que l’on accorde aux prédictions, elles ne seront sans doute prises au sérieux que s’il s’agit d’extrapolations à partir de faits établis.
Ainsi, on attend d’une loi, ou d’une relation causale, qu’elle soit vraie dans d’autres
situations ou qu’elle s’applique à d’autres expériences que celles qui ont permis de l’établir.
Sous prétexte que l’on a fait bouillir de l’eau à 100 °C tous les dimanches de l’an 2000, on ne considère pas comme une loi l’énoncé suivant : « Tous les
dimanches de l’an 2000, l’eau est entrée en ébullition à 100 °C ».
Il serait plus fécond de dire : « Le dimanche, l’eau bout à 100 °C », ou encore mieux : « L’eau bout à 100 °C ».
Cette dernière formulation est jugée plus féconde dans la mesure où sa
généralité permet d’anticiper ou de prévoir ce qui va se passer lorsque la température de l’eau atteindra 100 °C.
En un sens, en étendant le pouvoir de la connaissance le caractère prédictif l’enrichit et la complète.
4. 5 Question de méthode
Avec la question de la prédiction, l’opposition entre réalistes et anti-réalistes déborde du domaine de l’abstraction et de la spéculation pour s’étendre à des préoccupations méthodologiques..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Philosophie des sciences : Qu'est-ce que la science ?
- LA SCIENCE ET LES SCIENCES (cours de philosophie)
- François BACON: SCIENCE ET PHILOSOPHIE (De la dignité et du progrès des sciences. Préface).
- "Il est évident que nous n'avons en vue, dans la philosophie, aucun intérêt étranger. Mais, de même que nous appelons homme libre celui qui est à lui-même sa propre fin et n'est pas la fin d'autrui, ainsi cette science est aussi la seule de toutes les sciences qui soit libre, car seule elle est sa propre fin." Aristote, Métaphysique. Commentez cette citation. ?
- LA PHILOSOPHIE ET LA LIBERTÉ "Il est évident que nous n'avons en vue, dans la philosophie, aucun intérêt étranger. Mais, de même que nous appelons homme libre celui qui est à lui-même sa propre fin et n'est pas la fin d'autrui, ainsi cette science est aussi la seule de toutes les sciences qui soit libre, car seule elle est sa propre fin." Aristote, Métaphysique, 384-322 av. J.C. Commentez cette citation.