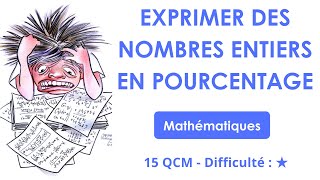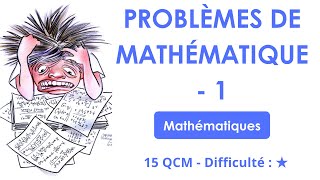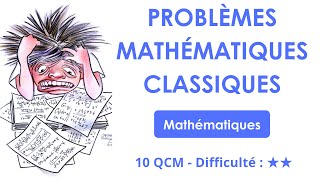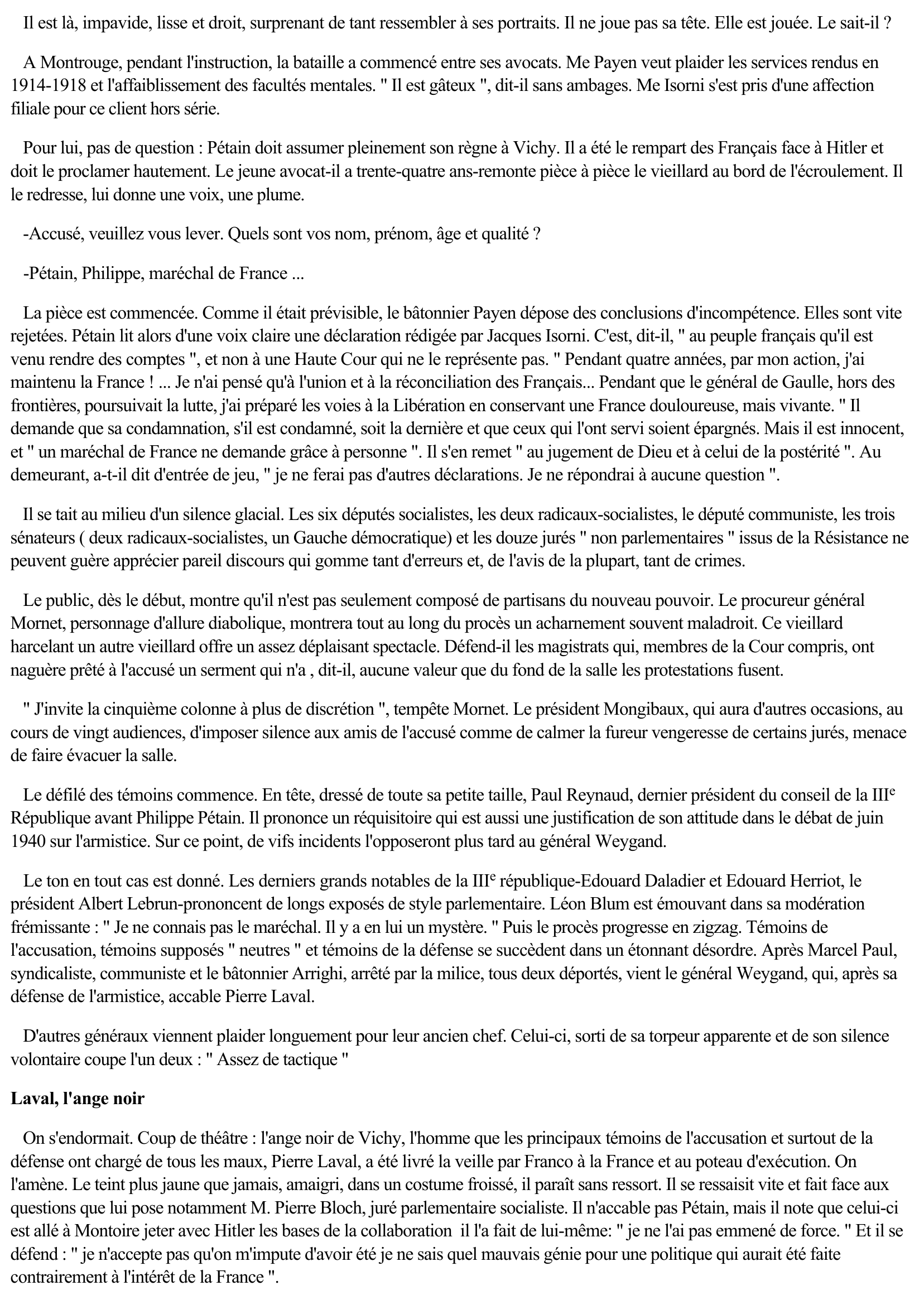Le procès de Pétain, Philippe, Maréchal de France
Publié le 22/02/2012
Extrait du document
«
Il est là, impavide, lisse et droit, surprenant de tant ressembler à ses portraits.
Il ne joue pas sa tête.
Elle est jouée.
Le sait-il ?
A Montrouge, pendant l'instruction, la bataille a commencé entre ses avocats.
Me Payen veut plaider les services rendus en1914-1918 et l'affaiblissement des facultés mentales.
" Il est gâteux ", dit-il sans ambages.
Me Isorni s'est pris d'une affectionfiliale pour ce client hors série.
Pour lui, pas de question : Pétain doit assumer pleinement son règne à Vichy.
Il a été le rempart des Français face à Hitler etdoit le proclamer hautement.
Le jeune avocat-il a trente-quatre ans-remonte pièce à pièce le vieillard au bord de l'écroulement.
Ille redresse, lui donne une voix, une plume.
-Accusé, veuillez vous lever.
Quels sont vos nom, prénom, âge et qualité ?
-Pétain, Philippe, maréchal de France ...
La pièce est commencée.
Comme il était prévisible, le bâtonnier Payen dépose des conclusions d'incompétence.
Elles sont viterejetées.
Pétain lit alors d'une voix claire une déclaration rédigée par Jacques Isorni.
C'est, dit-il, " au peuple français qu'il estvenu rendre des comptes ", et non à une Haute Cour qui ne le représente pas.
" Pendant quatre années, par mon action, j'aimaintenu la France ! ...
Je n'ai pensé qu'à l'union et à la réconciliation des Français...
Pendant que le général de Gaulle, hors desfrontières, poursuivait la lutte, j'ai préparé les voies à la Libération en conservant une France douloureuse, mais vivante.
" Ildemande que sa condamnation, s'il est condamné, soit la dernière et que ceux qui l'ont servi soient épargnés.
Mais il est innocent,et " un maréchal de France ne demande grâce à personne ".
Il s'en remet " au jugement de Dieu et à celui de la postérité ".
Audemeurant, a-t-il dit d'entrée de jeu, " je ne ferai pas d'autres déclarations.
Je ne répondrai à aucune question ".
Il se tait au milieu d'un silence glacial.
Les six députés socialistes, les deux radicaux-socialistes, le député communiste, les troissénateurs ( deux radicaux-socialistes, un Gauche démocratique) et les douze jurés " non parlementaires " issus de la Résistance nepeuvent guère apprécier pareil discours qui gomme tant d'erreurs et, de l'avis de la plupart, tant de crimes.
Le public, dès le début, montre qu'il n'est pas seulement composé de partisans du nouveau pouvoir.
Le procureur généralMornet, personnage d'allure diabolique, montrera tout au long du procès un acharnement souvent maladroit.
Ce vieillardharcelant un autre vieillard offre un assez déplaisant spectacle.
Défend-il les magistrats qui, membres de la Cour compris, ontnaguère prêté à l'accusé un serment qui n'a , dit-il, aucune valeur que du fond de la salle les protestations fusent.
" J'invite la cinquième colonne à plus de discrétion ", tempête Mornet.
Le président Mongibaux, qui aura d'autres occasions, aucours de vingt audiences, d'imposer silence aux amis de l'accusé comme de calmer la fureur vengeresse de certains jurés, menacede faire évacuer la salle.
Le défilé des témoins commence.
En tête, dressé de toute sa petite taille, Paul Reynaud, dernier président du conseil de la III e
République avant Philippe Pétain.
Il prononce un réquisitoire qui est aussi une justification de son attitude dans le débat de juin1940 sur l'armistice.
Sur ce point, de vifs incidents l'opposeront plus tard au général Weygand.
Le ton en tout cas est donné.
Les derniers grands notables de la III e république-Edouard Daladier et Edouard Herriot, le président Albert Lebrun-prononcent de longs exposés de style parlementaire.
Léon Blum est émouvant dans sa modérationfrémissante : " Je ne connais pas le maréchal.
Il y a en lui un mystère.
" Puis le procès progresse en zigzag.
Témoins del'accusation, témoins supposés " neutres " et témoins de la défense se succèdent dans un étonnant désordre.
Après Marcel Paul,syndicaliste, communiste et le bâtonnier Arrighi, arrêté par la milice, tous deux déportés, vient le général Weygand, qui, après sadéfense de l'armistice, accable Pierre Laval.
D'autres généraux viennent plaider longuement pour leur ancien chef.
Celui-ci, sorti de sa torpeur apparente et de son silencevolontaire coupe l'un deux : " Assez de tactique "
Laval, l'ange noir
On s'endormait.
Coup de théâtre : l'ange noir de Vichy, l'homme que les principaux témoins de l'accusation et surtout de ladéfense ont chargé de tous les maux, Pierre Laval, a été livré la veille par Franco à la France et au poteau d'exécution.
Onl'amène.
Le teint plus jaune que jamais, amaigri, dans un costume froissé, il paraît sans ressort.
Il se ressaisit vite et fait face auxquestions que lui pose notamment M.
Pierre Bloch, juré parlementaire socialiste.
Il n'accable pas Pétain, mais il note que celui-ciest allé à Montoire jeter avec Hitler les bases de la collaboration il l'a fait de lui-même: " je ne l'ai pas emmené de force.
" Et il sedéfend : " je n'accepte pas qu'on m'impute d'avoir été je ne sais quel mauvais génie pour une politique qui aurait été faitecontrairement à l'intérêt de la France "..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Pétain Philippe Maréchal de France et homme d'Etat français
- PETAIN Philippe (1856-1951) Maréchal de France, chef de l'Etat français (1940-1944) Né dans une modeste famille de paysans, après des études à Saint-Cyr, dont il sort en 1878, il enseigne à l'Ecole de guerre de 1901 à 191O.
- PETAIN, Henri Philippe Omer (24 avril 1856-23 juillet 1951) Maréchal de France, chef de l'Etat français (1940-1944) Né dans une modeste famille de paysans, après des études à Saint-Cyr, dont il sort en 1878, il enseigne à l'Ecole de guerre de 1901 à 1910.
- PETAIN, Henri Philippe Omer (24 avril 1856-23 juillet 1951) Maréchal de France, chef de l'Etat français (1940-1944) Né dans une modeste famille de paysans, après des études à Saint-Cyr, dont il sort en 1878, il enseigne à l'Ecole de guerre de 1901 à 1910.
- PETAIN, Henri Philippe Omer (24 avril 1856-23 juillet 1951) Maréchal de France, chef de l'Etat français (1940-1944) Né dans une modeste famille de paysans, après des études à Saint-Cyr, dont il sort en 1878, il enseigne à l'Ecole de guerre de 1901 à 1910.